La partition intérieure de Beethoven ou Comment la déchiffrer ?
Texte revu 25-28 avril 2020, 19-20 janvier 2022
par Elisabeth Brisson
Die Psychoanalyse « ist gewöhnt, aus gering geschätzen oder nicht beachten Zügen, aus bem Abhub – dem « refuse » – der Beobachtung, Geheimes und Verborgenes zu erraten. »
(La psychanalyse « est habituée à deviner par des traits dédaignés ou inobservés, par le rebut de l’observation, des choses secrètes ou cachées »).
Sigmund Freud
Le Moïse de Michel-Ange (II, S.185)
La cérémonie de l’obscur est la fatalité de toute œuvre
Yves Bonnefoy
L’autre et le lieu de la poésie (1958) – III
Impossible de dire je suis sourd !
« […] und doch war’s mir noch nicht möglich den Menschen zu sagen : sprecht lauter, schreyt, denn ich bin Taub, ach wie wäre es möglich dass ich die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bey mir in einem Vollkommenern Grade als bey andern seyn sollte, einen Sinn denn ich einst in der grösten Vollkommenheit besass, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiss haben noch gehabt haben – o ich kann es nicht, drum verzeiht, wenn ihr mich da zurückweichen sehen werdet […]“
(« Il ne m’était pas encore possible de dire aux autres : Parlez plus fort, crier, car je suis sourd, ah comment était-il possible de devoir faire savoir la faiblesse d’un sens qui chez moi devait être à un degré de perfection absolue, plus que chez les autres, d’un sens que je possédais autrefois dans la plus grande perfection, et que peu de ceux qui ont le même métier n’ont jamais eue – o je ne le peux pas, aussi pardonnez-moi, si vous me voyez me tenir à l’écart. »)
Ce cri de détresse lancé au cœur du Testament d’Heiligenstadt rédigé en octobre 1802 a ému plus d’un lecteur, plus d’un admirateur de Beethoven… chacun s’interrogeant secrètement sur l’origine de cette surdité survenue alors que Ludwig n’avait pas encore trente ans… (né en 1770) infirmité restée énigmatique, aujourd’hui encore.
Pourtant les recherches ne manquent pas… mais il ne semble pas que le détour par le déchiffrage de la « partition intérieure » de Beethoven ait été effectué.
Qu’est-ce à dire ? Comment est-il possible de déchiffrer la « partition intérieure » de Beethoven ?
Et d’abord qu’entendons-nous par cette expression de « partition intérieure » ? Tout simplement ce qui s’est joué au tréfonds de Beethoven, à son insu, et qui émerge dans les documents variés dont nous disposons à condition de les lire, de les examiner directement, de les ressentir à la manière de Stefan Zweig (1881-1942) qui a éprouvé le besoin de collectionner objets et partitions autographes : il adorait contempler une feuille d’esquisse de Beethoven dans laquelle il voyait un univers émerger d’un sombre chaos, du tréfonds de l’inconscient pour être traduit dans nos mots et nos signes (« gleichsam noch taumeld aus der Urgrund des Unbewussten in unsere Welt der Worte und Zeichen niedersteigt » (7 novembre 1923) [1] ; ce qu’il écrit dans Le Monde d’hier, à deux reprises. Dans le chapitre intitulé « Détours sur le chemin qui me ramène à moi », il parle de l’effet que produit sur lui la vue des esquisses de Beethoven :
« je souscris à la parole de Goethe, que pour comprendre pleinement les grandes créations, il ne suffit pas de les voir dans leur état d’achèvement, mais il faut les avoir surprises dans leur génération. C’est aussi un effet purement visuel que produit sur moi les premières esquisses de Beethoven, avec ses traits fougueux et impatients, son désordre confus de motifs ébauchés et abandonnés, avec la fureur créatrice qui s’y condense en quelques coups de crayon, – de cette nature comblée d’une surabondance démoniaque, et qui me jette dans une sorte d’agitation physique, parce que son aspect excite tellement mon esprit. Je puis contempler une de ces pages barbouillées de hiéroglyphes dans l’enchantement de l’amoureux, comme d’autres un tableau parfait. »[2]
Le Monde d’hier, p.195
Plus loin, Stefan Zweig explique les raisons de son goût pour les autographes qu’il collectionne : saisir la création en acte, comprendre le mystère de la création[3] ; puis dans le chapitre « Coucher du soleil », Zweig raconte qu’il achète des souvenirs de plusieurs créateurs dont ce qu’il peut de Beethoven :
« sans compter le cahier des notes de jeunesse, le lied, Le Baiser, et des fragments de la musique d’Egmont, je réussis à représenter aux yeux un moment au moins de la vie, le plus tragique, d’une manière si complète qu’aucun musée du monde n’en pourrait offrir de semblable. Par une première chance je pus acquérir tout ce qui subsiste du mobilier de sa chambre, qui fut vendu aux enchères après sa mort (…), avant tout son immense bureau, dans les tiroirs duquel se trouvèrent cachés les deux portraits de ses bien-aimées, (…) , sa cassette (…), son petit pupitre sur lequel il avait encore écrit au lit ses dernières compositions et ses dernières lettres, une boucle de cheveux blancs coupés sur son lit de mort, la lettre de faire-part de ses funérailles (…). Et (…) j’eus l’occasion de m’enrichir encore de trois dessins de son lit de mort », ceux de Josef Teltscher, puis « de l’original de la lithographie devenue si célèbre de Danhauser et représentant Beethoven sur son lit de mort. Et ainsi, conclut Zweig, j’avais rassemblé tout ce qui s’était conservé, dans une forme parlante pour les yeux, de ces derniers instants si mémorables et dont le souvenir ne périra jamais. »[4]
Donc, pour parvenir à déchiffrer (au moins en partie) cette partition intérieure, le retour aux sources authentiques, authentifiées est indispensable – ce qui suppose la possibilité de se débarrasser de tous les clichés qui ont recouvert, si ce n’est qui ont englouti la vérité de Beethoven. Réinterroger les sources, certes, mais avec la préoccupation de relever les détails jusque-là négligés le plus souvent.
Trois ensembles de documents nous ont paru des voies royales pour mettre cet insu en évidence.
/ Une voie procède du récit que Beethoven aurait fait pour rendre compte de l’origine de sa surdité au jeune musicien anglais Charles Neate lors d’un séjour de quelques mois à Vienne en 1815 : le fait que ce récit ait été rapporté près d’un demi-siècle plus tard n’est pas sans importance pour ce que nous cherchons.
/ Une autre voie procède de l’analyse des jeux de mots que Beethoven adorait : ils émaillent sa correspondance, ses réflexions en marge d’esquisses ou de partitions, et ils trouvent des réalisations musicales proposées sous forme de canons énigmatiques.
/ Enfin, une autre voie procède des thèmes choisis pour la composition de Variations (un thème et ses modifications possibles, lieu où l’imagination créatrice se donne libre cours dans un cadre donné) : sa première œuvre composée et publiée en 1782 est un ensemble de Neuf Variations ; puis il en composa plusieurs ensembles auxquels il n’a pas choisi de donner de numéro d’opus, à quelques exceptions près, dont les 15 Variations Eroïca op.35 et les 33 Variations Diabelli (Veränderungen sur un thème de Diabelli), op.120.
I/ Le récit de Charles Neate
Ce récit offre une voie royale pour accéder aux représentations que Beethoven s’était forgées afin de se « raconter » l’origine de sa surdité.
Pourtant il s’agit d’un récit datant de 1861, donc bien postérieur à la mort de Beethoven survenue le 26 mars 1827. Fait par l’Anglais Charles Neate (1784-1877), il a été recueilli par l’américain Alexander Wheelock Thayer qui cherchait à établir une biographie « objective » en interrogeant ceux qui avaient connu Beethoven et qui étaient encore en vie. Inséré dans la Beethoven life, ce récit donnait ainsi publicité à une origine traumatique indéniable de la surdité de Beethoven : un choc physique lié à une exaspération émotionnelle insupportable.
Qui était Charles Neate ?
C’était un pianiste et compositeur anglais, un des membres fondateurs de la Société Philharmonique de Londres (1812), venu à Vienne en 1815 dans l’espoir de prendre des leçons de piano avec Beethoven. Tout en refusant de l’avoir comme élève, Beethoven accepta de discuter avec lui de ses compositions. Ainsi, l’estime réciproque et le plaisir pris à s’entretenir entre « connaisseurs » pourraient donner crédit au récit étonnant, voire délirant, fantasque rapporté par Neate à Thayer en 1861 – en tout cas cette version de l’origine de la surdité est unique parmi tous les témoignages et toutes les anecdotes concernant ce drame vécu par Beethoven : même dans ses lettres « d’aveu » de l’été 1801 à Wegeler, l’ami de Bonn, qui était médecin, et à Amenda, l’ami violoniste rencontré trop brièvement à Vienne en 1799, Beethoven ne donne pas d’origine à sa surdité, évoquant toutefois un lien avec ses dérangements intestinaux – mais en aucun cas il ne mentionne un événement traumatique du genre de celui rapporté par Charles Neate. Le récit tel qu’il a été publié est donc vraisemblablement le résultat d’une mise en forme par Neate de propos qu’il aurait « entendus » cinquante ans plus tôt : ce n’est en aucun cas un document de première main. Malgré tout, prêter attention sans préjugé à ce récit tel que Charles Neate l’a rapporté ne serait pas inutile pour tenter de dégager ce qui se serait joué au tréfonds de la psyché d’un Beethoven cherchant à s’expliquer sa surdité, et à en rendre compte : un enjeu niché dans les étapes d’un récit, enchaînement d’événements qui, métaphores du réel, constituent la vérité portée par la forme manifeste de ce récit (son ton, son rythme, ses images). Ainsi, même si ce texte ne provient pas directement de Beethoven, il est possible de partir de l’hypothèse qu’il serait analogue à un récit de rêve, et de l’analyser comme un « texte sacré », donc sans en changer une virgule : sa construction d’ensemble ainsi que chacun des termes (leurs significations possibles, leur place dans le récit, les connotations et associations) faisant de facto appel à autre chose et jouant donc le rôle de traduction-écran à l’expression du désir. Cette hypothèse est envisageable dans la mesure où Beethoven lui-même était attentif à ses rêves et semblait familier avec le processus de l’association d’idées, comme l’atteste sa lettre à Tobias Haslinger, du 10 septembre 1821 dans laquelle il raconte un rêve au cours duquel un canon (musical) lui est tombé dans l’esprit, mais l’ayant oublié au réveil, il a fallu qu’il se trouve dans les mêmes conditions de bercement d’un trajet en calèche pour que le canon lui revienne à l’esprit « conformément à la loi des associations d’idées » (« […] die gestrige Traumreise wieder jezt wachend fortsezte, siehe da, gemäss dem Gesetz der IdeenAssociation fiel mir wieder selber Canon ein, ich hielt ihn nun wachend fest […] »). (BGA 1439).
A/ Le récit dans le récit
Ce récit a été rapporté à Thayer, cet américain qui pour écrire une biographie crédible de Beethoven interrogea tous ceux qui l’avaient connu et qui étaient encore en vie vers 1860 : la conception d’une biographie reposait alors sur l’accumulation de témoignages et d’anecdotes, sans distance critique. Publié donc tel quel par Thayer, sans mise en doute, le récit de Neate est double : avec le récit de l’origine de la surdité, il y a celui de la rencontre avec Beethoven en 1815.
Je joins le texte publié dans Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen, in Tagebüchern, Briefen, Gedichten und Erinnerungen, Herausgegeben von Klaus Martin Kopitz und Rainer Cadenbach, G.Henle Verlag . München, 2009.
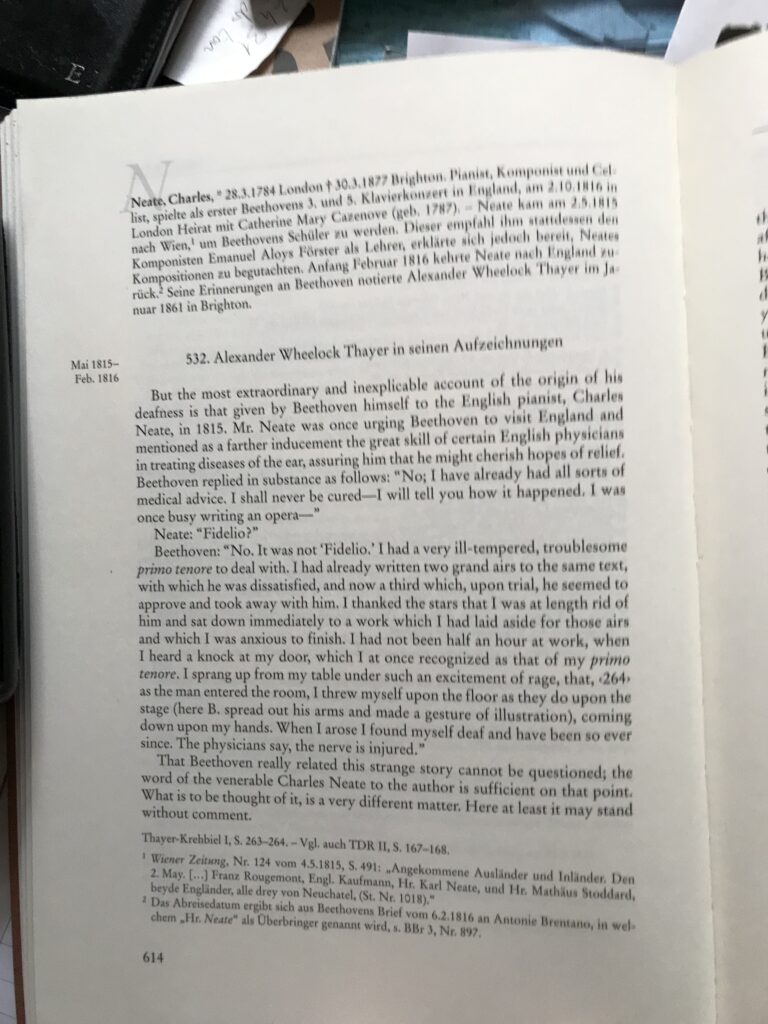
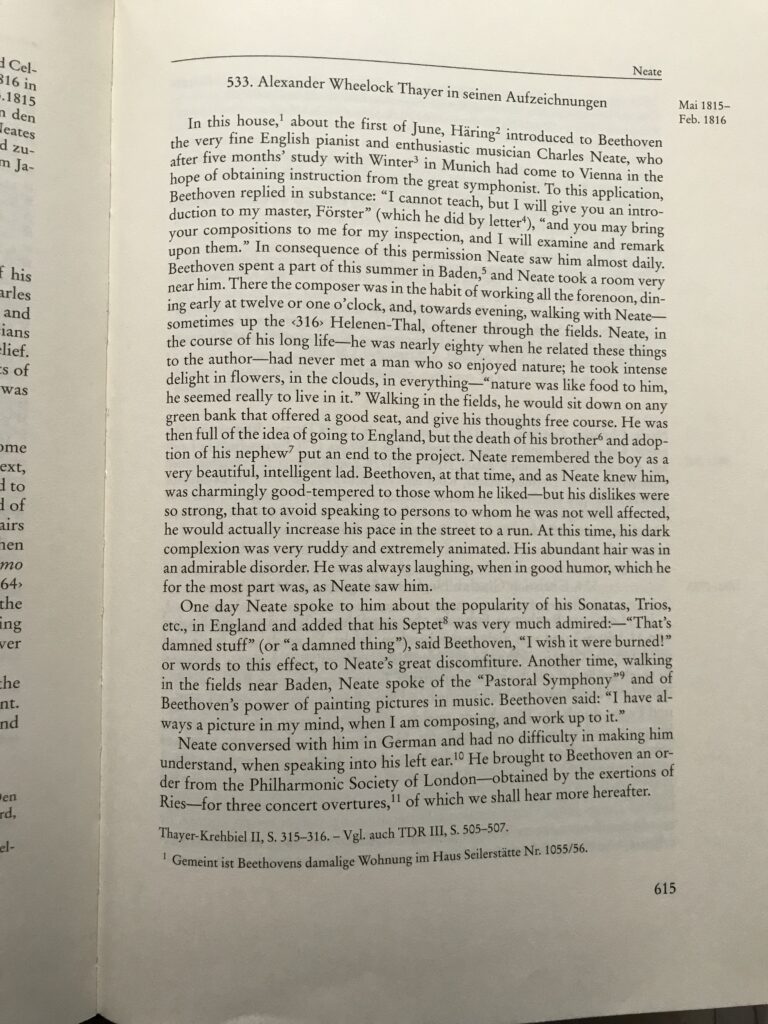

Avant d’analyser le récit sur l’origine de la surdité, rapporté en 1861, il est indispensable de reconstituer son double contexte : où en était Beethoven en 1815 ? et comment se présentaient la littérature et l’iconographie concernant Beethoven en 1860 ? Il s’agit donc de mettre en regard les éléments du double texte de Neate avec la correspondance de Beethoven en 1815, ainsi qu’avec son Tagebuch et ses compositions autour de 1815.
I/ Juin 1815 – Charles Neate rencontre Beethoven
Penchons-nous sur le moment et sur le temps de la rencontre de Charles Neate avec Beethoven à Vienne, entre le 1er juin 1815 et le 6 février 1816.
Charles Neate, pianiste, violoncelliste et compositeur est arrivé à Vienne le 2 mai 1815. Il vient de Munich où il a pris des cours de piano avec Winter. Il souhaite prendre des cours avec Beethoven dont il est un grand admirateur. Johann Häring, un homme d’affaires qui seconde Beethoven dans ses démarches auprès des Anglais, lui sert d’intermédiaire le 1er juin 1815. Beethoven qui n’a aucune envie de lui donner des cours de piano lui confie une lettre de recommandation pour Förster, mais se réjouit de parler avec lui de composition musicale.
/ La rencontre avec Beethoven – été 1815
Cette rencontre d’un jeune musicien anglais réjouit Beethoven à plus d’un titre.
Il est très content de pouvoir avoir de cette manière un lien direct avec la Société Philharmonique de Londres : Neate en est un des membres fondateurs, pressenti pour faire partie rapidement de la direction (ce qui fut le cas en 1817). Beethoven lui propose immédiatement de faire l’acquisition de trois Ouvertures (op.115, 117 et 115) pour la Société (sans lui dire que ce sont des œuvres de circonstance déjà composées), lui faisant promettre de ne pas divulguer cet achat… en les faisant parvenir à Londres. Que ce soit sous le sceau du secret est confirmé par un billet de Beethoven à son ami Gleichenstein en juin 1815… (BGA 815).
Et puis, ce jeune musicien anglais de 30 ans, qui parle un peu l’allemand et le français, devient un interlocuteur de choix à un moment où Beethoven se sent très seul : beaucoup de ses amis ne sont plus à Vienne, que ce soit le violoniste Schuppanzigh ou les Brentano, ou également Gleichenstein, et depuis longtemps Karl Amenda avec lequel il vient d’avoir justement un échange épistolaire, se plaignant de sa solitude, et du destin qui entrave ses projets ; il traduit d’ailleurs cette détresse intérieure dans la mise en musique d’un poème de Herder, Die laute Klage (La plainte à haute voix) WoO 135, dans lequel il a remplacé le terme « Gram » (chagrin) par le terme « Sinn » (sens), indice qu’il se sentait personnellement concerné par ce poème, dans lequel il retrouvait l’évocation de sa solitude affective associée à sa surdité irrémédiable. Il a réorganisé ce poème pour lui donner une structure qui insiste sur les mots et expressions qui désignent et connotent la souffrance psychique. Choisissant la tonalité d’ut mineur dans un tempo soutenu à 6/8, Beethoven a suivi le texte de très près, mettant certains termes en valeur par la violence des accents (sf, f/p), l’insistance des broderies, les tensions harmoniques, les répétitions de façon à souligner le cœur blessé (verwundetes Herz), la plainte (Jammer), la dureté (hartvertheilende) de ce qu’éprouve le sujet (mir) face à la condamnation d’un sens (qui normalement rend possible la relation avec les autres) (den verstummenden Sinn).
Et puis en 1815, son frère Karl très malade depuis plusieurs années (atteint par la tuberculose comme leur mère) est mourant : malgré le soutien financier de Beethoven, qui se préoccupe donc de son frère en lui prêtant de l’argent pour se soigner, Karl meurt le 15 novembre 1815, laissant un jeune garçon né le 4 septembre 1806 et une femme que Beethoven déteste et ne cesse de dénoncer comme malfaisante. Le 22 novembre 1815 (BGA 854), il écrivait à son ami et ancien élève Ferdinand Ries, alors à Londres, pour lui demander d’activer les publications envisagées car il avait besoin d’argent : son frère venait de mourir, ajoutant qu’il avait une mauvaise femme (« er hatte ein schlechtes Weib ») et il spécifiait qu’il l’avait soutenu financièrement : s’il regrettait sa perte, il avait la satisfaction de n’avoir rien à se reprocher…
Toutefois, une inscription de son Tagebuch (69) laisse supposer des relations conflictuelles avec son frère qui aurait été injuste avec lui, ce qui serait, à ses yeux, la raison de sa mort : s’il ne s’était pas éloigné de lui, il vivrait encore (« o sieh herab Bruder, ja ich habe dich beweint und beweine dich noch, o warum warst du nicht aufrichtiger gegen mich, du lebtest noch und wärst gewiss so elendiglich nicht umgekommen, hättest du dich früher – – – entfernt und mir ganz genaht.“)
Il se trouve que cette tension à mort entre deux frères retient au moins trois fois l’intérêt de Beethoven à cette époque de sa vie : en 1813, avant même la parution du texte de la pièce, il recopie dans son Tagebuch (7, 8, 9) des extraits de Die Schuld (La faute) de Müllner, représentée à Vienne au Burgtheater le 27 avril 1813 – son attention à la prosodie laisse supposer une intention de mise en musique – ; or cette « tragédie de destin » est centrée sur l’assassinat d’un frère… la vérité étant de toutes façons, dévoilée au moment du Jugement dernier… Peu de temps après, en 1814, un autre livret retient son attention : un Romulus et Remus… après des déboires liés à l’utilisation du livret par un autre compositeur, Beethoven finit par obtenir l’autorisation en décembre 1815 d’en composer la musique … Juste après la mort de son frère… et c’est peu après qu’il recopie dans son Tagebuch (118) les deux derniers vers de Die Braut von Messina oder die feindlichen Brüder (La fiancée de Messine ou les frères ennemis) de Schiller, tragédie sur le fratricide mêlé à de l’inceste (vis-à-vis d’une sœur, double d’une mère) : « Das Leben ist der Güter höchstes nicht/ Der Uebel grösstes aber ist die Schuld“. (La vie n’est pas le plus grand des biens, le plus grand mal en revanche est la faute).
Comme si, au moment de la mort de son frère, Beethoven était alors particulièrement taraudé par la question de la faute, plus spécifiquement d’une faute en lien avec un assassinat au sein d’une famille… meurtre lié à une rivalité amoureuse… Il recopie également des vers d’un poème de Herder (Tagebuch, 55), prière d’un mourant qui, en train d’être broyé par un lion remercie le très Haut de mourir de douleur et non dans la faute : « Dank dir, höchster, im Schmerz sterb ich, doch nicht in der Schuld“… Soit la douleur terrible à la place de la faute…
A signaler également une réflexion (Tagebuch, 44), recopiée de l’Odyssée d’Homère, qui porte sur l’importance du passé qui fait retour dans le présent, qui a engendré le présent („Um nur nächst vom vergangenen man was werden wollte, so hat das Vergangene doch das Gegenwärtige hervorgebracht), avec la conclusion : « vous êtres devenues terrestres – prophéties effroyables, et sauvées par la poésie et votre signification » (« Sie wurden irdisch – erschreckliche Weissagung und durch die Dichtungen, durch ihre – Bedeutenheit – gerettet“ (Odyssée, Le cyclope IX 14/15).
C’est-à-dire que les prophéties, les dires du passé, sont devenues réalité, et qu’ils ont pris sens, par l’intermédiaire de la poésie pour être supportables.
C’est dans ce contexte de solitude, de difficultés familiales, d’obsession de la faute, que Beethoven est ravi de rencontrer ce jeune musicien anglais, d’autant qu’il attend beaucoup du marché anglais : il confie les trois Ouvertures (op. 113, 115, 117) à Neate et discute de contacts possibles avec des éditeurs de Londres pour vendre d’autres œuvres (op.61, 72, 92, 95, 102, 112, 136) – et d’après les lettres ultérieures, ils évoquent l’éventualité de l’organisation d’un concert à son bénéfice à Londres. Neate semble confiant, assurant Beethoven qu’il va faire tout ce qu’il peut pour ouvrir le monde musical et mélomane de Londres à sa musique (qui est alors considérée comme trop difficile par les Anglais – ce qui est confirmé par les échanges avec Thomson, commanditaire des arrangements d’airs « populaires » avec un « cahier des charges » précis, exigeant la simplicité !).
Beethoven et Neate ont certainement eu de nombreuses occasions de discuter à un moment où, d’après le Tagebuch (36, 122), Beethoven est bien décidé à partager ses repas avec d’autres, de préférence des musiciens… pour ne pas être isolé et pour prendre des conseils auprès d’instrumentistes compétents.
En décembre 1815 (lettre BGA 867), sachant que contrairement à ce qu’il avait laissé entendre, Neate n’avait pas encore envoyé les trois Ouvertures à Londres, Beethoven lui demande la copie de l’une des trois pour y porter des corrections, tout en rassurant Neate, affirmant que lui Beethoven était un homme d’honneur qui tenait sa parole, c’est-à-dire qu’il allait lui rendre la partition le plus vite possible (sous-entendu qu’il n’avait pas l’intention de la faire copier pour l’offrir à un autre éditeur).
Ce temps du séjour de Neate à Vienne est aussi celui de la composition des deux Sonates pour piano et violoncelle op.102 par Beethoven qui les destine à Marie Erdödy (pianiste) et à Linke (violoncelliste), tout en promettant à Neate de les lui dédier, de façon à l’inciter à trouver un éditeur à Londres : une copie de l’op.102 n°1 comprend de fait une dédicace manuscrite de Beethoven : « Sonata / Pour le piano et le Vioncelle [sic] / composèe et dédièe / à [mon] son ami / Mr: Charles Neate / par / louis van Beethoven ».
Pourtant lors de l’édition de Simrock en 1817, il n’y a pas de dédicace ; et en 1819, à Vienne, les Sonates sont dédiées à Marie Erdödy… ce changement de dédicataire est le signe d’un désaveu ou tout au moins d’une modification de stratégie de la part de Beethoven… qui ne peut plus compter sur Neate… comme la suite de leurs relations l’atteste.
Que s’est-il passé ?
Au moment du retour de Neate à Londres en février 1816, Beethoven lui confie donc une grande quantité d’œuvres toujours sous le sceau du secret (lettre BGA 889) : il inscrit d’ailleurs un canon énigmatique dans l’Album de Neate, le 23 janvier 1816, sur les vers de Herder : Das Schweigen (se taire)… et il lui confie une lettre pour Antonie Brentano puisque la route de Neate passe par Francfort, ville dans laquelle elle résidait : dans cette lettre Beethoven chante les louanges de son ami anglais : « Neate einen ebenso vorzüglichen Englischen Künstler als liebenswürdigen Menschen » (il offrait également à Antonie son portrait gravé d’après un dessin de Letronne, et il lui disait qu’il venait de sauver un pauvre enfant des griffes d’une méchante mère, faisant ainsi allusion à l’adoption de son neveu Karl).
2/ La disgrâce de Neate – 1816
Beethoven espérait que Neate, dès son arrivée à Londres, ferait tout pour tenir ses promesses : or, il ne reçoit aucun retour, si bien qu’il s’en plaint (lettre du 3 avril 1816, BGA 923) à son ami Ferdinand Ries (à Londres depuis 1813, également influent au sein de la Société Philharmonique) : Neate doit être à Londres, je lui ai confié plusieurs œuvres et il m’a promis d’en faire le meilleur usage. Toujours sans nouvelles, Beethoven écrit à Neate le 15 mai 1816 (BGA 936) une lettre en français : il voudrait savoir où en sont les compositions qu’il lui a confiées ; puis le 18 mai 1816 (BGA 937), une lettre en anglais : il exprime son mécontentement et sa crainte de ne pas toucher les recettes des concerts donnés à Londres.
Toujours sans nouvelles, Beethoven finit par écrire le 7 octobre 1816 (BGA 983) à Sir George Smart (qui avait dirigé à Londres le 10 février 1815 la Bataille de Vittoria ou « Wellingtons Sieg » op.91 avec beaucoup de succès), une lettre dans laquelle il mettait le Prince régent et Neate dans le même sac pour leur manque de parole (le Prince régent Georg n’avait pas fait un geste pour le remercier de la dédicace de l’op.91, envoyé en 1814 !). Beethoven écrivait qu’il avait confié des partitions à Neate, ce dernier lui ayant promis de faire organiser un concert à son bénéfice à Londres par la Société Philharmonique : il n’en a eu aucune nouvelle, mais il a appris par un article du Morning Chronical (du 23 mars 1816) que la Symphonie en la avait été jouée. Demandant des explications à Neate, ce dernier lui aurait écrit une lettre qui ne témoignait pas en sa faveur [lettre non conservée], s’abritant derrière le fait qu’il était follement épris d’une jeune fille, mais que les parents s’opposaient à leur union… Dans sa longue lettre à Smart Beethoven estimait que Neate avait détruit sa réputation à Londres en ne donnant que les trois Ouvertures qui certes avaient été payées, tandis les autres partitions qu’il lui avait confiées, lui appartenaient encore à lui Beethoven. Il signalait que Neate comptait sur la dédicace des Sonates op.102 : la réalisation de cette attente ne dépendra que de lui…
Apprenant que Beethoven avait écrit à Smart pour dénoncer son comportement, Neate lui écrit le 29 octobre 1816 (BGA 987), totalement dépité : jamais il n’avait été considéré comme manquant à sa parole, jamais il n’avait été pris en flagrant délit de comportement déloyal – Neate cherche à justifier son silence : ayant eu des difficultés à propos de son mariage, il n’avait plus le cœur à rien. Mais toujours animé par son admiration pour Beethoven, il est outré qu’il ait eu l’idée de faire part de ses reproches à Sir Smart qui est un de ses bons amis : son honneur est donc mis en jeu, ce qui va grever tout le reste de sa vie. Pour prouver qu’il n’était pas capable de ce dont il était soupçonné, Neate fait remarquer qu’il avait gardé le silence comme le lui avait demandé Beethoven. (« that you have chosen Sir George Smart, to makes your complaints of me to, (…) might have been listened to, and I injured all the rest of my life. (…) I am sorry you say, that I did not even acknowledge my obligation to you, because I talked of nothing else in Vienna, as every one there who knew me, can testify. (…) : I must indeed be a Scoundrel, if I am capable of what you suspect me!”).
Les plaintes de Beethoven n’ont pas porté leurs fruits : le 19 avril 1817 (BGA 1116), il envoyait une nouvelle lettre pleine de fureur à Neate qui n’a toujours rien fait ! « Nichts ! nichts ! ».
Et entre temps, au début de l’été 1816, Beethoven compose un Lied intitulé Der Mann vom Wort (L’homme de parole) op.99, sur un poème de Friedrich August Kleinschmid (ce Lied est publié par S.A. Steiner à Vienne en novembre 1816) qui décrit ce qu’est un homme de parole, en répétant souvent les termes « Mann » et « Wort » (à la limite du bégaiement). Le Lied aux connotations sonores militaires se termine sur l’affirmation qu’il faut suivre cet exemple si « nous voulons être des hommes allemands », c’est-à- dire ne pas céder à une femme, demeurer incorruptible et respecter le serment juré.
/ Neate et ses vaines tentatives de réhabilitation
Malgré ses attentes fortement déçues, Beethoven réussit à obtenir la commande d’une nouvelle Symphonie par la Société Philharmonique de Londres en juin 1817. Puis, la Symphonie achevée (mais créée à Vienne le 7 mai 1824 alors qu’elle a été commandée et payée par Londres !), Neate qui depuis 1817 fait partie de la direction de la Société Philharmonique essaye de faire venir Beethoven à Londres, pour qu’il diriger sa Neuvième ; puis comme Beethoven ne vient pas en 1824, il réussit à lui faire la commande d’une nouvelle Symphonie et d’un Concertant (?) … mais en 1825 (lettre du 15 janvier, BGA 1924) les conditions et exigences de Beethoven sont telles que la Société refuse (lettre du 1er février 1825, BGA 1930)… Beethoven était tenté par cette invitation (le rêve ou tout au moins le projet d’un voyage à Londres date de 1793 : il aurait bien aimé accompagner Haydn lors de son second voyage en 1794), il espérait ainsi avoir l’occasion de revoir sa belle patrie, la route du voyage passant par Bonn… (cf. le Tagebuch, 50) – peut-être inconsciemment a-t-il eu peur de revenir sur le lieux du crime (dont il se croit coupable ?).
3/ La revanche de Neate un demi-siècle plus tard
Neate n’a donc pas pu se racheter aux yeux de Beethoven : il garde sa blessure d’amour-propre jusqu’au moment où enfin il peut s’en débarrasser grâce à Thayer…
Le biographe américain vient l’interroger à Brighton en 1861 : Neate peut donc reconstruire un récit, a posteriori, personne ne pouvant le contredire !
Il raconte donc sa rencontre et le récit que Beethoven lui aurait fait sur l’origine de sa surdité. Il ne spécifie pas qu’il venait d’avoir 30 ans, l’âge même qu’avait Beethoven au moment où il s’est rendu compte qu’il devenait sourd ; qu’il y a donc une situation d’empathie… qui l’autoriserait à prendre des libertés avec ses souvenirs ! L’analyse du double récit, tel que Thayer l’a publié, atteste un mélange d’erreurs, de clichés et de vérités.
// Les erreurs
Neate dit avoir loué une chambre à Baden pour être près de Beethoven, or aucun document n’atteste que Beethoven ait certainement séjourné à Baden durant l’été 1815 (contrairement à l’été 1814 ou à l’été 1816 !). Donc il est préférable de douter des promenades dans l’Helenetal : Neate s’est inspiré de récits postérieurs qu’il avait certainement lus (en particulier celui de Seyfried sur l’origine du canon « Kühl nicht lau » WoO 191, publié dans son ouvrage sur Beethoven en 1832, qui raconte une de ces joyeuses promenades de Beethoven faite en compagnie de compositeurs et d’éditeurs).
Et puis, Neate évoque la chevelure en désordre, ce qui n’était pas le cas à ce moment de la vie de Beethoven comme l’atteste le dessin de Letronne, souvent diffusé : la chevelure abondante est postérieure comme en témoignent le dessin de Kloeber en 1818 et le tableau de Stieler en 1820.
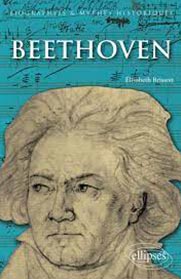
Blasius Höfel d’après un dessin de Louis Letronne, Vienne 1814
Le désordre d’une chevelure abondante n’apparaît que plus tard !

Kloeber 1818 Stieler 1820
// Les clichés
La violence éruptive de Beethoven, surtout quand il était dérangé ; les chaises qui volaient…
Ses esquives, ses tours de passe-passe pour ne pas être importuné par des visiteurs indésirables, ce qui a été largement diffusé par Wagner : il publia en 1840 dans la Revue et Gazette musicale de Paris une nouvelle qui mettait en scène un compositeur anglais essayant mordicus de se faire recevoir par Beethoven, ce qui empêchait le narrateur (Wagner) d’accéder au grand compositeur, jusqu’au jour où enfin Beethoven comprit qui il était ; le narrateur fut alors admis, ce qui permit à Wagner de faire savoir qu’il avait discuté avec Beethoven de Fidelio et de l’opéra à venir que ce dernier prévoyait, tout en sachant qu’il dépassait largement l’horizon d’écoute de ses contemporains…
// Les indices de vérité
Premier indice : que Beethoven entendait quand on lui parlait dans l’oreille gauche.
Neate a raconté dans le récit inséré par Thayer qu’il parlait en allemand dans l’oreille gauche et que Beethoven entendait – cette particularité est soulignée par Beethoven lui-même dans un brouillon – donc inconnu de Neate – destiné à une liste de fautes de la Sonate op.109 publiée par Martin Schlesinger; ce brouillon de lettre du 14/11/1821 (BGA 1447) consiste en une feuille double, avec trois pages écrites comportant des corrections – et sur le haut de la première page est inscrit, sans lien avec le reste : « Hauptsächlich alles auf’s linke ohr zu – da die stärker ist ».
Autre indice de vérité :
que Beethoven composait un opéra. Peu avant le départ de Neate, Beethoven reçut l’autorisation des théâtres de composer la musique d’un Romulus sur un livret de Treitschke : un article du journal de Vienne Der Sammler daté du 16 décembre 1815 annonçait cette « bonne nouvelle pour les amateurs » et un billet de Beethoven à Treitschke datable de mi-décembre 1815 (BGA 863) l’attestent : « J’écris Romulus, et je vais commencer ces jours-ci, je viendrai moi-même vous en parler. »
Ces détails du double récit publié par Thayer mettent sur la voie d’une reconstruction de la réalité, condensant, à l’insu de Neate, donc sans qu’il l’ait délibéré, plusieurs strates :
- ce qu’il a vécu lors de sa rencontre, son enthousiasme pour ce compositeur tant admiré, avec lequel il s’est promené et s’est entretenu de musique, de problèmes quotidiens et de souvenirs ; il était là quand Beethoven s’est décidé à composer un nouvel opéra (il sait pourtant, quand il produit son récit, que Beethoven n’en a rien fait !) ;
- son ébranlement émotionnel : l’humiliation de la disgrâce, son honneur mis en jeu, son rejet par un Beethoven furieux qu’il ne tienne pas sa parole… alors qu’il a failli être le dédicataire des Sonates op.102 ;
- tout ce qui a été dit et montré sur Beethoven depuis sa mort, tant son amour de la nature et ses promenades dans l’Helenental, vallée boisée près de Baden, son impatience et sa phobie d’être dérangé, que sa grande chevelure ou sa façon de presser le pas pour ne pas avoir à rencontrer des gens dans la rue.
Hegi 1838 Lyser 1833


Böhm 1820-1825
Johann Nepomuk Höchle, Beethoven beim Spaziergang Aquarelle 1820-1825 (reste inconnue) Photo
Il faut souligner que la reconstruction du témoignage de Neate concerne les deux récits : celui de la rencontre et des moments passés avec Beethoven, et celui qui met en scène Beethoven racontant l’origine de sa surdité, soit ce dernier qui est donc un récit dans le récit, or la mise en abîme est toujours le mode d’expression d’une vérité (cf. Hamlet et le théâtre dans le théâtre). Amalgame de nombreuses sources et de nombreuses impressions, ces deux récits par-delà leurs erreurs sont malgré tout porteurs de vérité, dans leur intention : Neate a cherché à transmettre quelque chose qui a eu lieu entre lui et Beethoven, qu’il a « entendu » à son insu… avec un processus d’identification qui peut aussi passer par l’âge qu’avait alors Neate au moment où il a rencontré Beethoven, et qui était celui qu’avait Beethoven au moment où la surdité s’est imposée : en 1861 Neate avait lu la lettre de 1801 adressée à Wegeler, ainsi que le Testament de 1802, documents publiés dès octobre 1827 et repris dans les biographies éditées ensuite (Seyfried e, 1832, Wegeler et Ries en 1838, Schindler en 1840, 1845, 1860).
Dans le contexte des années 1860 marqué par la compétition entre biographes (chacun prétendant être dans le vrai), Neate pensait apporter une issue définitive à une aporie : il pouvait dire quelle était la raison de la surdité de Beethoven… il occultait ou oubliait par là-même le récit publié par Aloys Weissenbach en décembre 1815 dans son Voyage à Vienne au temps du Congrès de Vienne (Meine Reise zum Congress. Wahrheit und Dichtung) – lors de cette publication, Neate se trouvait encore à Vienne : il a donc pu lire le portrait dithyrambique de Beethoven dressé par Weissenbach qui le présentait comme un génie qui avait eu le typhus ce qui avait affaibli son système nerveux et lui avait fait perdre l‘ouïe. Aloys Weissenbach ajoutait qu’il avait longtemps parlé avec Beethoven, constatant que sa surdité était un malheur plus pour lui que pour le monde (« es ist mehr ein Unglück für ihn als für die Welt »), tant son sens du son lui permet de se passer du « Gehörsinn » – et alors qu’Aloys Weissenbach ne connaissait pas le Testament, il a certainement entendu Beethoven lui dire que son ouïe était très fine avant sa maladie, qu’il souffrait de ce qui était trop fort et que sa surdité l’isolait des autres.
Il est possible de supposer ce cette occultation des explications antérieures était indispensable à Neate pour qu’il puisse se réhabiliter à ses propres yeux, qu’il puisse guérir sa blessure d’amour-propre. A la suite de tous ceux qui cherchaient les raisons de la surdité de Beethoven, c’est lui qui détenait le secret, il avait la réponse apportée par ce récit que Beethoven lui aurait transmis : il pouvait livrer une vérité dont certainement il ignorait le sens… mais qui pouvait enfin de faire entendre. « Moi la vérité je parle » et cela plus d’un demi-siècle après…
La blessure de sa disgrâce a sans doute rendu Neate sensible à la blessure que Beethoven se serait infligée à la suite d’un geste d’impatience ? Dans l’après-coup, Neate a entendu qu’au cours des conversations qu’il a eues avec Beethoven, sa surdité avait à voir avec quelque chose d’enfoui, d’indicible, impossible à transmettre si ce n’est au moyen d’un scénario fantasque, exprimant la façon dont il se serait expliqué sa surdité.
D’où ce récit étonnant qui procède d’une humiliation personnelle génératrice de haine, comme l’atteste le fait de ridiculiser Beethoven : ce génie devenu fou… selon le jugement définitif d’un certain nombre de critiques, soutenu et illustré par les gravures montrant Beethoven accablé, assailli par ses fantasmes… Toutes ses dernières œuvres témoignent d’un esprit dérangé : les commentaires sont nombreux qui soutiennent cette affirmation, en particulier dans la presse musicale française.
B/ L’analyse du récit sur l’origine de la surdité rapporté par Charles Neate
« Moi la Vérité je parle »
Ce récit dans le récit énonce donc une vérité qui ne pouvait pas se dire autrement…. Reste à entendre cette vérité, à décrypter son propos.
Après avoir pris en compte les conditions de production de ce récit fantasque, son décryptage à l’instar d’un récit de rêve considéré comme « sacré » par Freud devrait nous permettre d’entendre cette « vérité » …
En l’occurrence, quel est le texte de ce récit livré par Neate ? Lisons-le, écoutons-le avant d’en analyser les composantes dans leurs multiples dimensions.
Ce texte en anglais, qui avait été inséré dans la biographie de Thayer a été publié, isolé, récemment dans Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen, München, Henle Verlag, 2009.
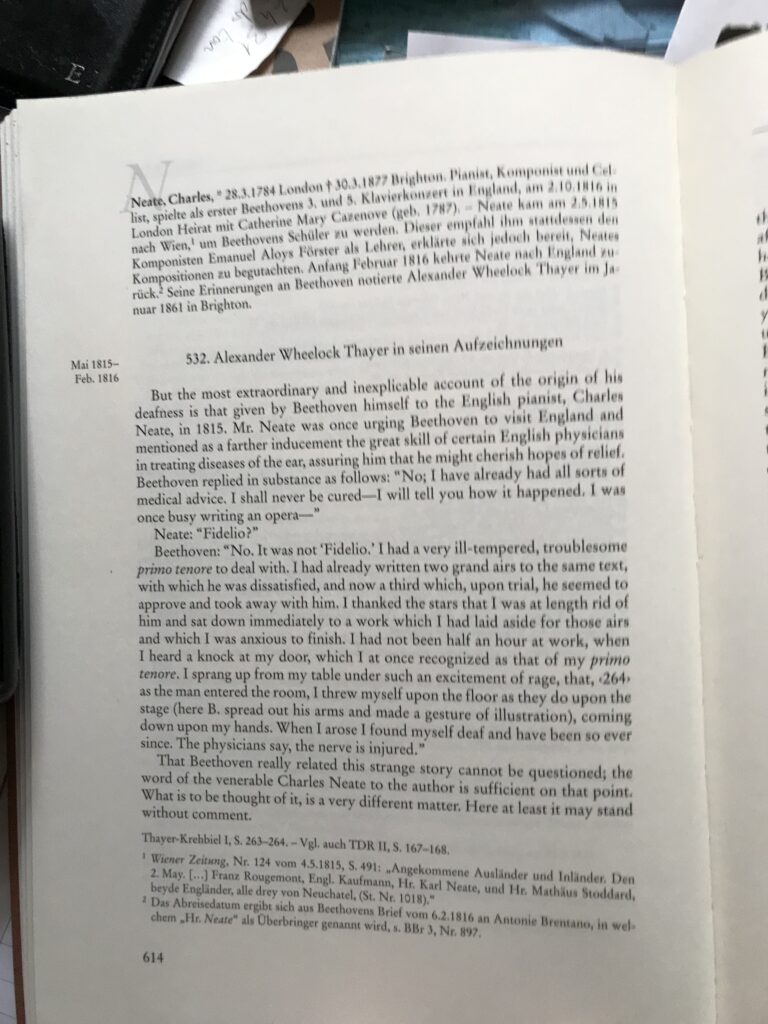
Alors qu’en 1815 Charles Neate exhortait Beethoven, déjà très sourd, à se rendre en Angleterre pour se faire soigner, il aurait reçu cette réponse :
« Beethoven – Non. J’ai eu déjà toutes sortes de conseils médicaux. Je ne serai jamais guéri. Je vais vous raconter comment j’en suis arrivé là. J’étais alors occupé à écrire un opéra…
- Fidelio ?
- Non. Ce n’était pas Fidelio. J’avais affaire à un primo tenore très désagréable et pénible. J’avais déjà écrit deux grands airs sur les mêmes paroles dont il n’était pas content, puis un troisième, qu’après essai il sembla approuver et qu’il emporta avec lui. Je me mis aussitôt à l’œuvre que j’avais abandonnée pour ces airs et que j’avais à cœur de finir. Je n’étais pas au travail depuis une demi-heure que j’entendis frapper à ma porte. Je sus aussitôt que c’était mon primo tenore. Je bondis de ma table avec une telle violence et une telle rage qu’au moment où l’homme entra dans la pièce, je me jetai sur le plancher comme au théâtre, et je tombai sur les deux mains. Lorsque je me relevai, je me trouvai sourd et je le suis resté. Les médecins disent qu’il y eut lésion du nerf. »
La scène tourne donc autour d’un « primo tenore » mécontent et insatisfait ! Qui gêne Beethoven dans son travail…au point de devenir fou de rage ; mais, alors qu’il s’apprêtait à se jeter sur l’importun, sans doute pour le frapper… quelque chose l’en empêche, détourne son geste : il préfère alors tomber au risque d’endommager ses mains si précieuses, ses mains de pianiste virtuose…car il n’est pas que compositeur… Et il se relève, sourd : le choc ayant endommagé le nerf auditif et non les mains !
Sourd.
Bien sûr, ceci est imaginaire. Mais Beethoven l’a peut-être formulé, pensé, au moins un instant… pour couper court aux admonestations de ceux qui prétendaient savoir comment il devait se soigner, ayant des chances de guérir…. Il en aurait fait le récit à un homme estimable, qui était l’interprète de ses œuvres, qu’il n’était pas appelé à revoir souvent. Un visiteur de passage sur les services duquel il comptait pour faire éditer ses œuvres en Angleterre. Il peut donc s’agir d’un récit essentiel, comme il arrive que l’on en fasse à ceux que l’on ne reverra plus.
Pourquoi Neate a-t-il pu prêter ce scénario imaginaire à Beethoven ? Que signifie cet affrontement, et l’évitement de cet affrontement ? Qui est ce primo tenore ou qui représente-t-il ? Pourquoi ce conflit aurait-il une conséquence aussi épouvantable, affectant le sens le plus nécessaire à l’accomplissement d’un destin hors norme ? Conflit avec le primo tenore mais aussi conflit dans le conflit, puisque Beethoven prend le risque de se blesser plutôt que de l’agresser, alors qu’il n’était pas homme, mais alors pas du tout, à se laisser importuner et surtout quand il composait. Quel est au juste ce théâtre dont il parle, quel drame s’y joue, quelle partition intérieure s’y est écrite à l’insu du grand homme ? partition qui lie un conflit avec un primo tenore, détourné sur lui-même, retourné contre lui-même, et la surdité, cette conséquence abominable…
Neate aurait-il « entendu » que Beethoven aurait pensé qu’il s’était infligé la surdité, ce mal absolu pour lui, ce châtiment suprême ? mais pour se punir de quoi ? Ou que le primo tenore le lui aurait envoyé cette souffrance pour se venger ? Un châtiment d’une totale cruauté pour lui, le plus redoutable, menaçant ce qu’il avait de plus précieux ? Mais pourquoi ? Pour quelle faute ? Quel tort avait-il bien pu lui faire ?
Selon certains spécialistes, la surdité de Beethoven serait la conséquence d’une syphilis, pour d’autres, il aurait souffert d’une labyrinthite aigüe, un mal associé à une inflammation digestive chronique. Suivons ces derniers. Le labyrinthe est une métaphore plus exaltante pour approcher une vie intérieure qui produisit une œuvre resplendissant de considérations si profondément humaines.
1/ La figure du père
D’après le récit de Neate, à la porte de ce labyrinthe se dresse la figure du « primo tenore » : l’association avec son père, Johann van Beethoven, ténor de la cour s’impose. Cet homme qui fut le premier ténor dans la vie de Beethoven. Comment est-il présenté dans ce récit ? – Rappelons-le : ce récit est raconté, reconstruit, par un tiers après la publication des premières biographies de Beethoven (celle de Seyfried, 1832 ; celle de Wegeler et Ries, 1838 ; celle de Schindler 1840, complétée en 1842, puis 1845 et 1860 ; puis celle de Lenz entre 1855 et 1860, celle de Ulibischeff et celle de A.B. Marx en 1859) – Ce « primo tenore » qui exige (ce qui était une pratique courante) que le compositeur adapte sa musique à ses capacités et à ce qui peut le mettre en valeur, est donc montré comme quelqu’un d’insatisfait, d’exigeant voire prétentieux, harceleur, importun, osant faire irruption et déranger le compositeur en train de composer une nouvelle œuvre, destinée à une autre scène. Est-on ainsi en présence de la représentation qu’il se faisait de son père ? ou plutôt, Neate ne reprend-il pas les clichés qui circulent depuis plus de trente ans sur Johann, père de Beethoven, qui aurait perdu sa voix à cause de son alcoolisme ? Le qualificatif de « primo tenore » étant en fait péjoratif, employé expressément pour rabaisser les capacités du père, puisqu’alors le primo tenore était souvent confondu avec le primo uomo, le castrat vedette des operas serias au XVIIIe siècle, connu pour ses caprices, son arbitraire, et qui selon les dires de Mozart n’était pas tout à fait un « uomo » !
Il est difficile de brosser un portrait de Johann et difficile de savoir quel père il a été, sauf par déduction en partant des réactions de Beethoven, de son impensé et des rejeux de ce qu’il a vécu, car il n’existe que peu de documents authentiques concernant son rôle de père.
1/ Il reste la mention de Johann sur l’acte de baptême de Beethoven du 17 décembre 1770 :
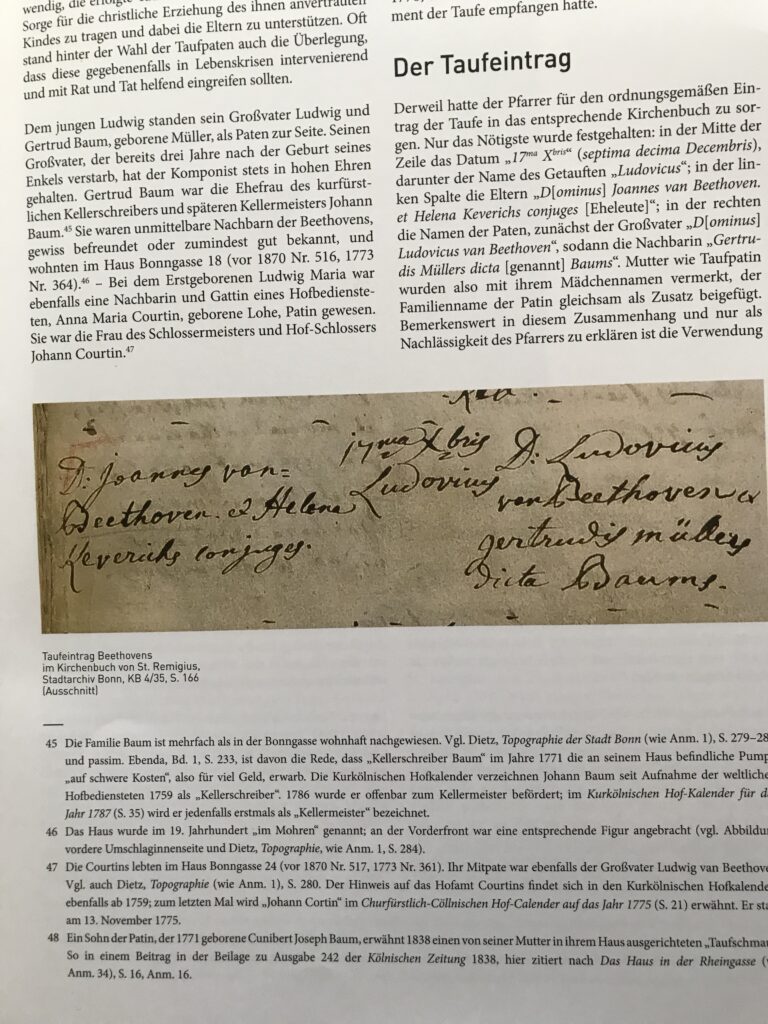
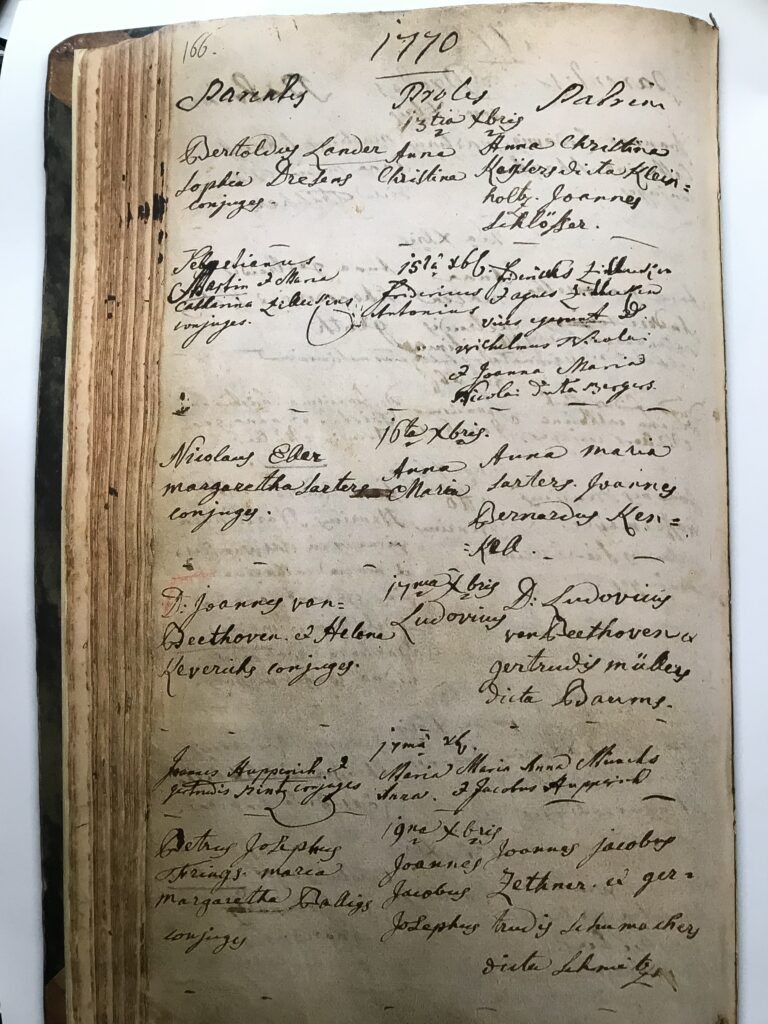
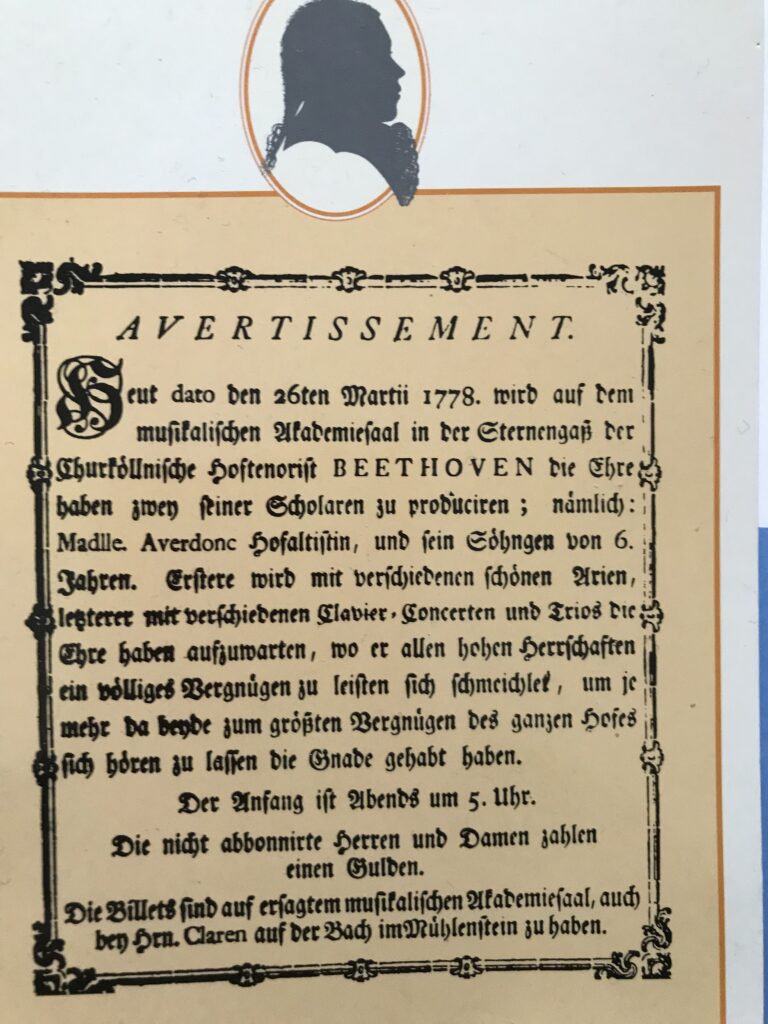
2/ Il reste une photo (l’original a brûlé en 1945) de l’Avertissement de 1778 annonçant le concert à Cologne de son Söhngen
3/ Demeure également le récapitulatif des membres de l’orchestre de la cour de 1784 (date du changement de prince électeur, après la mort de Maximilian-Friedrich) : Johann y est mentionné comme ténor dont la voix se perd (« hat eine granz abständige stimm »), depuis longtemps en service, très pauvre, d’une conduite convenable (von zimlicher Aufführung) et marié – son fils, Ludwig, n’a pas de traitement, a tenu l’orgue et a de bonnes capacités, encore jeune, d’une bonne conduite calme et pauvre (« von guter fähigkeit, noch jung, von guter stiller Aufführung und arm »).
4/ La copie d’une partition de CPE Bach (que Beethoven a précieusement conservée et sur laquelle il a mentionné « von meinem Theuren Vater geschrieben »).
Partition d’orchestre de l’Oratorio Morgengesang de CPE Bach sur un poème de Klopstock, recopiée par Johann van Beethoven (11 feuilles, 22 pages) – sans doute une partition dans laquelle il brillait quand il la chantait.
A partir de ces rares documents authentiques, il est difficile de se faire une idée des sentiments que Beethoven avait pour son père. Face à cette aporie, ce qui interroge, c’est qu’il s’est volontairement abstenu de parler de lui et de sa famille comme il le déclare à son ami Wegeler dans une lettre datée du 7 décembre 1826 (BGA 2236) :
« je me suis fait un principe de ne jamais parler de moi-même et de ne pas répondre à ce qui est écrit sur moi. Je te laisse le soin de faire connaître au monde la droiture de mes parents et en particulier de ma mère ».
Il laissait donc à son ami le soin de démentir ce qui avait été publié dès 1814 dans le Conversations-Lexikon de Friedrich Arnold Brockhaus, faisant courir le bruit qu’il serait le fils naturel de Frédéric-Guillaume II de Prusse… Ainsi, à part la partition manuscrite pieusement conservée qui comporte la mention qu’il faut considérée comme très convenue de « mon cher père », un indice de sa relation à ses parents émerge des reproches qu’il fait en 1825 à son neveu Karl de ne pas s’occuper de lui comme lui l’avait fait pour ses propres parents : « j’étais heureux de pouvoir aider mes pauvres parents. Quelle différence en comparaison de toi à mon égard », lui écrivait-il le 15 juillet 1825 (BGA 2008). Existe aussi un autre indice des sentiments positifs qu’il a éprouvés pour ses parents dans la lettre datée du 17 septembre 1795, adressée à son ami de Bonn Heinrich von Struve (1772-1851) qui venait de perdre sa mère. La lettre comprend quatre pages sur un tout petit format (possible à cacher dans une poche) :
« den Schmerz, den dir der Tod deiner Mutter verursacht hat, habe ich auch sehr gut fühlen können, da ich fast zweimal in dem nemlichen fall bey dem Tode meiner Mutter und meines vaters gewesen bin; wahrlich, wem sollte es nicht wehe thuen, wenn er ein Glied aus einem so selten anzutreffenden Harmonischen Ganzen wegreissen sieht – man kann nur noch hiebey vom Tode nicht ungünstig reden, wenn man sich ihn unter einem lächelnden sanft hinüberträumenden Bilde vorstellt, wobey der Abtretende nur gewinnt.“
(« La douleur provoquée par la mort de ta mère, je sais ce que c’est : je l’ai ressentie déjà deux fois lors de la mort de ma mère et de celle de mon père. Vraiment, à qui cela ne fait pas mal de se voir arracher un membre d’un tout harmonieux si rarement trouvé – en l’occurrence on ne peut parler de la mort non sans bienveillance, quand on se la représente sous l’image souriante et planante rêveuse, à l’occasion de quoi celui qui s’est retiré seulement gagne. »)
Le rappel de cette douleur provoquée par la mort de sa mère et par celle de son père, ainsi que cette évocation d’un tout harmonieux à laquelle s’ajoute cette image souriante de la mort flottant tel un rêve, laissent supposer que Beethoven n’avait pas (ou s’interdisait d’avoir) d’animosité envers son père et que, bien au contraire, il donne (il aspire à donner ?) à Johann sa place et sa fonction de père au sein d’une famille aimante normale. Est-il là encore dans le convenu ? peut-être…, mais sans doute pas – cette réponse s’impose vu le contexte de la lettre qui s’adresse à un ami proche avec lequel il partage la même culture humaniste, comme en témoignent deux occurrences : Heinrich von Struve a inscrit dans le Stammbuch de Beethoven le 30 octobre 1792 une citation de Moses Mendelssohn :
« Betimmung des Menschen.
Wahrheit erkennen, schönheit lieben,
Gutes wollen, das Beste thun. »
(« Vocation de l’homme. / Reconnaître la vérité, aimer la beauté / vouloir le bien, faire ce qui est le mieux »)
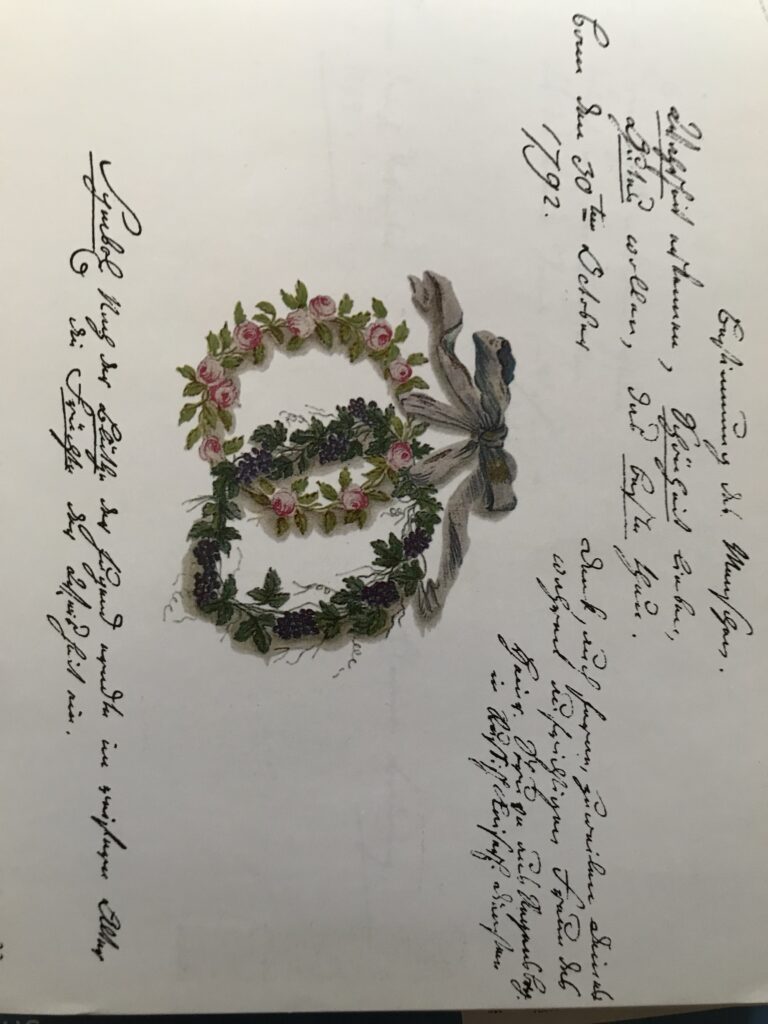
Et Beethoven fait écho à cette profession de foi humaniste lorsqu’il écrit dans sa lettre de 1795 :
« wann wird auch der Zeitpunkt kommen wo es nur Menschen geben wird, wir werden wohl diesen Glücklichen Zeitpunkt nur an einigen Orten heran nahen sehen, aber allgemein – das werden wir nicht sehen, da werden wohl noch Jahrhunderte vorübergehen.“ (« Quand arrivera le moment où il n’y aura plus que des hommes, on verra cela pointer dans quelques lieux, mais pas partout – cela avant plusieurs siècles. »)
Autre indice de l’importance de la figure du père pour Beethoven : à plusieurs reprises au cours de sa vie il a montré qu’il attribuait une dimension essentielle au rôle du père (ce qui lui a peut-être manqué ?).
Tout d’abord, après la mort de sa mère le 17 juillet 1787, il semble qu’il seconda son père de plus en plus désemparé, d’autant que depuis quelques années il perdait sa voix de ténor, pour élever ses deux frères plus jeunes, la plus jeune sœur étant morte très vite. En quelque sorte chargé de famille, Beethoven a voué une reconnaissance éternelle à Franz Ries (1755-1846), collègue violoniste de l’orchestre de la cour électorale, qui les a soutenus financièrement à ce moment ; puis, le 20 novembre 1789, suite à sa requête, le prince électeur Maximilian Franz accepte de lui verser la moitié des émoluments de son père pour faire face aux frais de la maison ; et après la mort de son père le 18 décembre 1792, Beethoven prend soin de ses frères, qui choisissent de venir l’un après l’autre le retrouver à Vienne en 1794. Une lettre de 1796 datée de Prague le 19 février à son plus jeune frère Nilokaus (Johann), alors à Vienne, atteste l’attention qu’il lui porte : il lui dit que s’il a besoin d’argent, il lui suffit d’en demander au prince Lichnowsky de sa part, et il lui souhaite de vivre toujours plus heureux, espérant y contribuer, signant « leb wohl lieber Bruder, und denke zuweilen an deinen wahren treuen Bruder / L Beethowen. » (BGA 20) – le ton si libre et enjoué de la lettre lui donne un cachet de sentiments non travestis, donc authentiques.
Puis, avant même la captation de son neveu (à partir de la fin de l’année 1815), la composition de la musique pour l’Oratorio Christus am Ölberg dévoile l’attente que Beethoven a du rôle du père : la confiance et la protection. Il confère ainsi un récitatif et air déchirant au Christ qui, dans sa détresse, se sent abandonné par son père. Cette œuvre de circonstance composée pour Pâques 1803, très rapidement (Beethoven a répété à plusieurs reprises, non sans fierté, qu’il avait composé en 15 jours cette œuvre à laquelle il tenait particulièrement même si la qualité du texte était contestable) suit de près la certitude qu’il est atteint d’une surdité irrémédiable. Dans la détresse la plus radicale, un père n’abandonne pas son fils… ce qui peut être aussi l’expression du contraire : un fils ne peut abandonner son père en détresse, sans qu’il en découle des conséquences tragiques, qui se déclinent en mort du père et punition du fils…
Enfin, un indice décisif de sa représentation du rôle d’un père : le comportement de Beethoven vis-à-vis de son neveu Karl. Si en élevant Karl, il a voulu mettre en pratique la conception dont il avait hérité et qui était partagée par ses amies, Marie Erdödy ou Antonie Brentano ou par son ami-mentor Wegeler auquel il dit qu’il est un « père sans femme » : un père est un père aimant, attentif à l’éducation, soucieux de transmettre un héritage symbolique (sa lettre du 9 juin 1825 à Karl déplore le fait d’avoir dépensé tant d’argent pour élever un homme ordinaire, BGA 1988). Cette captation de son neveu a révélé en même temps et à son insu, la détresse occasionnée par sa relation à son père et à sa mère : son acharnement désespéré à posséder seul son neveu, à l’arracher à sa mère trahit une profonde souffrance – « ce qui ne peut pas se symboliser fait retour dans le réel » dit Lacan ; ou selon Marie Balmary : « Nous ne pouvons savoir ce qui nous est arrivé qu’au moment où nous nous apprêtons à le refaire ».
// Ce que révèle la captation de Karl, son neveu
Ayant obtenu en 1815 que son frère Karl mourant lui confie la tutelle de son jeune fils né le 4 septembre 1806, Beethoven s’est investi corps et âme dans l’éducation de son neveu également prénommé Karl, ne reculant devant aucun procès et rédigeant de longs plaidoyers pro domo dans lesquels il justifie sa position et il expose ses objectifs d’éducateur (les documents sont abondants pour une procédure qui a duré près de 5 ans). Dans ses lettres, plusieurs allusions de Beethoven (confirmées par Ferdinand Ries par exemple comme par des éditeurs) laissent entrevoir la grossièreté de ce frère Karl et sa brutalité : il n’aurait pas hésité à frapper son fils…
Cet acharnement de Beethoven à sauver son neveu manifeste certainement la dimension archaïque de sa haine comme de ses pulsions d’emprise, rejeu de ce qu’il a vécu ?
Quelles voies prend cette haine pour se manifester ?
En premier lieu la haine qui l’animait s’est cristallisée sur le signifiant « Johann », qui correspond au prénom de son père, à celui de son plus jeune frère et à celui de sa belle-sœur Johanna, femme de Karl et mère du neveu qu’il veut prendre en charge après la mort de son frère le 15 novembre 1815, estimant que cette femme est dangereuse, amorale…. Insinuant même que c’est elle qui aurait tué son frère par défaut de soins et parce qu’elle lui aurait fait honte du fait de ses malversations…
Les traces de cette haine sont nombreuses.
Dès 1802, le prénom de Johann est laissé en blanc en tête du Testament dit de Heiligenstadt : certes, Beethoven ne savait pas comment ce frère voulait être désigné à Vienne, Johann ? ou Nikolaus comme à Bonn ? Mais, ce prétexte est révélateur de ce qui se joue en lui : l’impossibilité d’écrire le prénom qui est aussi celui de son père, préférant laisser une absence symbolique qui est du ressort du montré-caché, puisqu’il y a l’espace d’un blanc… et cela trois fois dans le Testament !
Puis au moment de la rivalité avec la mère de Karl, de ses démêlés avec elle, Beethoven la désigne comme Reine de la nuit : il voit donc en elle cette force toute-puissante archaïque qui veut s’emparer totalement de son enfant et le contraindre à tuer son rival. Il la traite également de Médée… cette mère qui choisit de tuer ses enfants pour punir leur père Jason de son infidélité.
Dans toute cette affaire avec son neveu, Beethoven est sous l’emprise de forces archaïques qui le dépassent, craignant entre autres d’être victime d’une vengeance : la mère de Karl (comme la Reine de la Nuit) pourrait charger son fils de tuer l’oncle… Ce fantasme trahirait-il la culpabilité d’avoir lui-même tué père et mère en les abandonnant pour aller « vers lui » … ce qui ne saurait rester impuni. Aussi, pour se protéger Beethoven cherche à faire reconnaître, à légitimer par un procès la méchanceté de cette femme qui lui veut certainement du mal. Karl ne serait qu’un écran obligeant à détourner le regard de ce qui se joue véritablement : l’angoisse d’ordre métaphysique suscitée par le châtiment qu’il mérite de recevoir…
Le rapport au père est donc particulièrement dramatique : il entraîne les notions d’emprise, de captation, de vengeance, de meurtre, de mort.
D’autres indices appuient cette analyse d’un rapport dramatique au père mettant en jeu ce qu’il y a de plus archaïque en lui, d’irraisonné, d’en-de-ça du langage : ces indices émanent tant de sa référence au tableau Antiochus représentant la maladie mortelle du fils du roi qui se meurt d’amour pour la fiancée de son père, que de sa critique du livret du Don Giovanni de Mozart ou que de son aspiration à la protection d’un père bienveillant.
Comment et quand se manifeste cette allusion au tableau Antiochus de H. Füger (1751-1818), directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Vienne (cf. Sacre p.111) ?
En juillet 1801, vers la fin de la lettre à Wegeler dans laquelle il fait le point sur sa situation de musicien compositeur à Vienne et dans laquelle il fait l’aveu de sa surdité, Beethoven signale à son ami qu’en même temps que des partitions, il va récupérer « deinen Antiochum » reproduction du tableau représentant la maladie d’amour du fils pour la femme de son père : la scène représente le moment où le fils va se lever de son lit de douleur, guéri par le médecin qui ayant découvert l’origine du mal conseille au père de laisser sa place au fils auprès de sa femme, belle-mère du fils… Cette rivalité fils/père mortifère se termine à l’avantage du fils… issue qui ne peut générer qu’un sentiment de culpabilité entretenant la haine du père.
Ce sujet de tableau était très à la mode entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, comme l’attestent les quelques toiles :
Gérard de Lairesse (1671-1711) entre 1671 et 1675
David (1748-1825) qui obtient le Prix de Rome en 1774 avec ce thème
1840, Ingres (1780-1867)
D’autre part, qu’est-il possible de tirer de la critique supposée du livret du Don Giovanni de Mozart/Da Ponte ?
L’affirmation prêtée à Beethoven qu’il n’aurait jamais mis un tel livret en musique, trop frivole, immoral, manquant de profondeur, ne semble pas confirmée par l’intérêt qu’il a eu pour la partition de cet opéra de Mozart dont il a recopié plusieurs passages (six passages sont cités dans le Werkverzeichnis 2, S.644). Si cette réflexion était véridique, elle pourrait mettre sur la piste de ce que Jean-Pierre Winter a mis en évidence dans les Errants de la chair/ Etudes sur l’hystérie masculine (Calmann-Lévy, 1998) : ce qui anime Don Giovanni c’est l’amour brûlant pour le père.
« Ainsi apparaît clairement que son infidélité à chaque femme a pour toile de fond le souci de ne pas trahir la catégorie « toutes-les-femmes ». Infidèle par fidélité, il commet une erreur majeure qui est le noyau même de sa névrose : il confond l’inaccessible totalité avec l’inaccessible symbole. Cette erreur n’est pas innocente, car s’il ne la commettait pas, il lui faudrait reconnaître que ce qui se profile derrière La-femme-qui-n’existe-pas, c’est le Père en tant que Nom, c’est le Nom-du-Père. / L’homme hystérique, par son refus de reconnaître cette version du Père, transforme ainsi le « toutes-les-femmes », qui est une fonction, en un nombre. Ces hommes hystériques (…) que craignent-ils de rencontrer chez une femme, sinon celui justement devant le désir duquel ils reculent ?/ De cette confusion tragique, Don Juan n’aura la clef qu’à l’heure de l’ultime rencontre avec le Commandeur. C’est sa grandeur d’accepter à ce moment de ne pas fléchir – mais pourquoi fuirait-il puisque, à son insu, il atteint son but : se brûler d’amour pour le Père ? » (p.295, phrases conclusives de l’ouvrage).
La réaction de Beethoven qui aurait trouvé le livret immoral ne révèlerait-elle pas ce refoulement impossible d’une attraction incandescente pour le père (réel aussi bien que symbolique) ? Attraction masquée, détournée par l’attachement à la figure du grand-père paternel, maître de chapelle du prince électeur, notable considéré dont Beethoven possédait une représentation figurée : un tableau le montrant richement vêtu doté des attributs de sa fonction très honorifique – tableau que Beethoven emportait à chaque fois qu’il déménageait… (en même temps que le tableau de Mähler peint en 1804 le posant en digne héritier d’Apollon) : dans sa lettre de juin 1801, il demandait à Wegeler de lui faire parvenir « le plus vite possible » en échange d’une gravure le représentant lui (sans doute celle publiée par Artaria en automne 1801, gravure de Johann Joseph Neidl d’après un dessin de Gandolf Ernst Stainhauser von Treuberg).

Or, ce grand-père se prénommait également Ludwig et était le parrain de Beethoven ; il mourut en décembre 1773, alors que Beethoven avait tout juste 3 ans, ce qui lui assura l’aura d’une figure tutélaire servant de référence : toute sa vie Beethoven chercha à être nommé maître de chapelle comme son grand père…
Le rôle du père est également subsumé par la conception que Beethoven avait du divin : immatériel, mystérieux mais bienveillant comme l’attestent les nombreuses citations de son Tagebuch ainsi que son Glaubensbekenntnis (qui récuse de facto le dogme de la Trinité), et qui consiste en trois sentences
recopiées avec grand soin :
« Ich Bin, Was da ist »
« Ich bin alles, Was ist, Was / war, und Was seyn wird, / Kein sterblicher Mensch / hat meinen Schleyer / aufgehoben »
« Er ist einzig von ihm selbst, / u. diesem Einzigen sind / alle Dinge ihr Daseyn schuldig »[5]
Le Dieu de Beethoven est aussi ce Père bienveillant évoqué par les vers de Schiller, dont la mise en musique constitue le Finale de la Neuvième Symphonie dédiée à la célébration de la Joie. Ce Dieu qui lit au fond de son cœur qu’il invoque dans le Testament d’Heiligenstadt :
« Gottheit du siehst herab auf mein inneres, du kennst es, du weißt, dass menschenliebe und neigung zum Wohltun drin Hausen […]“….
Ce Dieu avec lequel Beethoven semble avoir un lien direct, tel un nouveau Moïse : le symbole du buisson ardent étant la référence implicite qui relie Beethoven à Don Giovanni tout autant qu’à ce qu’est la musique… car comme l’écrit George Steiner dans Fragments (un peu roussis) :
« Tel le Buisson ardent, la musique manifeste qu’elle est ce qu’elle est. A cette tautologie, au franchissement de cette limite, le langage se tait. »[6]
Toutes ces hypothèses concernant la représentation d’un père, de son rôle, de sa fonction, de son attirance, ne contredisent pas les intentions des premiers biographes qui, soucieux de découvrir le secret du génie de Beethoven et d’auréoler son destin de grand homme, lui attribuèrent un père violent, fantasque, lunatique, alcoolique au dernier degré (on n’en sait rien !) : cette image construite de toutes pièces (qui s’inspirait des romans d’artistes, genre alors à la mode) mettait en évidence, sans le chercher délibérément, la dimension essentielle du rapport au père dans la vie psychique de Beethoven. Comme pour tout un chacun, le rapport au père relève de l’ambivalence des sentiments humains, des liens inextricables entre l’attachement et la haine, comme des circonstances de la vie, tour à tour tendres ou menaçantes, puis des remaniements qu’une histoire infantile ne cesse de connaître à l’intérieur d’une psyché devenue adulte, à jamais marquée cependant des premières empreintes.
Johann aima son fils et Ludwig van Beethoven aima son père.
C’est un fait indéniable, même si l’autorité prêtée à ses premiers biographes, dont Wegeler, cet ami de Bonn témoin de son adolescence, a permis d’en douter. Pris dans les enjeux de mémoire et de pouvoir qu’ont été et la rédaction et la publication de la biographie de Beethoven au cours des années 1830, Wegeler en 1837 (donc dix ans après la mort de Beethoven) a laissé, en toute bonne foi certainement, cette affirmation à la postérité :
« Il parlait volontiers à ses amis d’enfance de son grand-père, et sa pieuse et douce mère, qu’il aimait beaucoup mieux que son père, lequel n’était que sévère, avait dû lui parler beaucoup de son aïeul ».
Cette affirmation est non vérifiable car on ne sait rien de sa mère, à l’exception de renseignements sur son lieu de naissance et sur ses parents, son veuvage très jeune, son mariage avec Johann, le nombre d’enfants qu’elle a eu avec Johann, sa mort précoce sans doute de phtisie (source fréquente de mortalité à cette époque) : les autres affirmations (« ma plus chère amie » évoquée par Beethoven dans sa lettre bien calligraphiée à von Schaden auquel il demandait un prêt d’argent en 1787) sont à replacer dans leur contexte, tout en témoignant de l’affection qui circulait dans la famille, ce qu’atteste l’expression employée par Beethoven dans sa lettre à Heinrich von Struve en 1795 qui souligne l’harmonie d’un tout. Reste étonnant, le mutisme, déjà souligné, revendiqué par Beethoven quand il s’agit de ses parents, s’étant fait une règle de ne jamais parler de sa famille, comme il l’écrivait à son ami Wegeler au moment où ce dernier lui conseillait de démentir la rumeur qui courait à propos de ses origines, faisant le lui le fils du roi de Prusse contre toute évidence logique de date de naissance et de lieu de rencontre …
Pourquoi ? ne s’agit-il pas ici de l’indice de la tendance à se vouloir une filiation imaginaire, relevant du roman familial ? « Je suis un roi » aurait affirmé Beethoven à Karl Holz au moment où il cherchait à diffuser la Missa solemnis auprès des têtes couronnées d’Europe (qui l’avaient applaudi en 1815 lors des concerts donnés dans le cadre du Congrès de Vienne) …
Se sachant un génie, il ne pouvait relever que d’une ascendance princière ? Il n’est donc pas le fils de son père et par conséquent sa mère est coupable d’adultère… ce qui ternit sa vertu ! Beethoven demande seulement à Wegeler de démentir cette rumeur pour protéger l’honneur de sa mère…
Ce père que l’état civil lui attribuait n’aurait donc pas été le vrai ? Ce fantasme n’aurait-il pas partie liée avec le refoulement de sentiments estimés coupables : refouler le désir de vouloir éliminer physiquement ce gêneur ? Comme le récit rapporté par Neate le montre et le souligne, au moment où à la fin de la scène Beethoven renonce à se jeter sur l’importun quitte à abîmer ce qui constitue les moyens d’expression de son génie, ses mains et son ouïe, préférant donc se punir durablement.
La notion d’expiation indissociable du renoncement, de la résignation, est au cœur des poèmes de Gellert que Beethoven a choisi de mettre en musique en 1802, donc peu après avoir acquis la certitude d’une surdité irrémédiable : le lied central strophique Vom Tode est consacré à la mort tandis que toutes les strophes du sixième et dernier Lied qui traite de la pénitence sont composées de part en part, signe de l’importance que Beethoven accordait à cette notion de punition pour un forfait et d’attente d’un repentir efficace.
2/ La mise en scène
Le forfait d’agression du primo tenore évité dans le récit, mais aux conséquences dramatiques pour Beethoven bien qu’il ait renoncé à le commettre, s’inscrit dans une mise en scène soigneusement organisée et décrite, au point que tout dessinateur de Bandes dessinées se ferait un plaisir de reproduire la scène en images successives, suggestives.
Première image : Beethoven au travail, très concentré, comme nombre de gravures ou de peintures du XIXe siècle (donc après sa mort) le représentent penché sur son bureau, par exemple sur le Triptychon de Moritz von Schwind (1804-1871) dessin à la plume de 1837, condensé de l’effet « Beethoven » produit par sa vie et sa création (inspirée de la nature, de la souffrance, de la mort, de la foi…).

Ou affalé sur son piano en proie à ses fantasmes….
Gravure de Aimé de Lemud (1817-1887) publiée en 1864, donc après le texte de Neate.
Deuxième image : on frappe à la porte (ce qui évoque la première scène de Fidelio, quand Jacquino prêt à déclarer son amour à Marzeline, est sans cesse dérangé par un livreur ! ce qui l’excède au plus haut point) – l’image montrerait les deux côtés de la porte : le primo tenore et sa partition frappant avec insistance / Beethoven concentré sur sa composition. Cette image des coups frappés à la porte évoque bien évidemment ce que Schindler a répandu dans sa Biographie de Beethoven qui lui aurait donné le sens de l’incipit de la Cinquième Symphonie : « le destin frappe à la porte » ! En fait, c’est une falsification de Schindler qui démarque le « saisir le destin à la gueule » écrit par Beethoven dans sa lettre du 16 novembre 1801 à Wegeler…
Troisième image : Beethoven se lève furieux d’être dérangé, hurlant qu’il a déjà refait trois fois l’air… c’est le cliché du dérangement que Wagner a popularisé dans sa nouvelle publiée à Paris dans la Gazette et Revue musicale en feuilleton en 1840 Une visite à Beethoven, et que des figurines, comme des représentations figurées ont propagé …
Beethoven-Statuette – Gipsabguß der Firma Gebrüder Micheli nach einem Original von Gustav Adolf Landgrebe
Ludwig van Beethoven; ganzfigurig, in eiligem Gang; in der Rechten einen Bleistift, auf dem Rücken sein Skizzenbuch haltend. – Gipsabguß der Firma Gebrüder Micheli, Berlin, nach einer Statuette von Gustav Adolf Landgrebe. Bezeichnet: Auf der Rückseite des Sockels: « G. Landgrebe Berlin. Eigenthum Gebrüder Micheli Berlin. »
Berlin, um 1889. – Plastik in Elfenbeinmasse; 21 cm
Quatrième image : Beethoven se jette par terre au lieu de défoncer ce primo tenore et il tombe sur les mains.
1905 Gustav Vigeland 1912
Ce comportement irascible, violent a été popularisé et a servi d’antidote au début du XXe siècle à la représentation divine de Beethoven.
Cinquième image : Beethoven hagard se relève mais n’entend plus ce qu’on lui dit – le choc lui a lésé le nerf auditif.
Cliché d’un Beethoven dans les nuages largement répandu à la fin du XIXe siècle …
Beethoven in den Wolken thronend; zu seinen Füßen eine Menschengruppe. – Aquatinta-Radierung von Joseph Adolf Lang nach einer eigenen Zeichnung. Metallschrank, Mappe 6/21 (1905?)
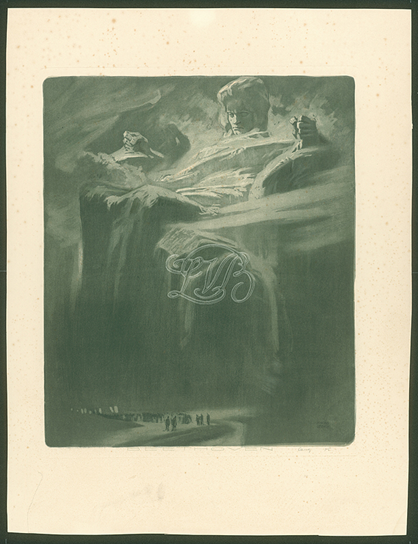
Que le récit rapporté par Neate soit authentique ou pas, peu importe, tant il s’avère que la mise en scène est le reflet d’un geste essentiel du processus créateur de Beethoven.
Beethoven a souvent eu recours à la mise en scène dans ses œuvres, de façon à dramatiser sa composition et à en maîtriser l‘agencement (à la manière d’un récit de rêve auquel le rêveur cherche à conférer une grande cohérence en imaginant un scénario) : c’est lui qui décide de ce qui peut être montré et comment le montrer, ce qui relève souvent d’ailleurs d’un rude combat avec la matière de son inspiration, car la plupart du temps l’œuvre « lui échappe » comme il l’écrit à son éditeur Hoffmeister le 15 janvier 1801 (BGA 54) à propos de la Grande Sonate op.22 – c’est-à-dire que le travail d’élaboration ne cesse d’étoffer l’idée initiale (« diese Sonate hat sich gewaschen geliebtester Hr. Bruder ») – autre exemple évident : les derniers Quatuors à cordes (il ne sait pas que ce sont les derniers !) composés à partir de l’Urmotiv constitué par les lettres musicales du BACH, à peine un quatuor était en voie d’achèvement qu’il se mettait au suivant (sous prétexte de répondre à ses engagements vis-à-vis des éditeurs !).
/ Le Finale de la Neuvième Symphonie
Nombre de ses œuvres sont emblématiques de cette façon de procéder : c’est-à-dire de ce choix de mettre en scène ses idées et de les développer à la manière d’une pièce de théâtre. Ce qui est également une manière de conserver le souvenir du temps de l’élaboration, des modalités de la recherche pour faire avancer la composition. L’exemple paradigmatique en est le Finale de la Neuvième Symphonie. Dans la première partie instrumentale de ce Finale qui s’ouvre par une page stridente et « Presto » de tous les instruments à vent (sans les cordes, donc telle une fanfare déchirante) – que Boucourechliev comparait à un rideau de scène que l’on fait tomber -, une longue phrase interrogative des cordes basses « Selon les caractères d’un Récitatif, mais in tempo » spécifie Beethoven sur la partition, cherche et passe en revue le début de chacun des trois premiers mouvements : « Allegro, ma non troppo », « Vivace », puis « Adagio cantabile », tour à tour rejetés avant que ne s’impose, « Allegro assai », le thème d’abord murmuré par les bois sur tenue des cors, avant d’être repris par les cordes basses auxquelles se joignent les violons, puis les bassons et enfin tout l’orchestre, associant intensité forte et masse sonore. Le thème est donc trouvé ! Après un long déploiement, cette masse sonore se heurte à la reprise de la fanfare stridente « Presto » initiale (mes.208), quand intervient une voix de baryton basse qui interpelle l’auditoire (public et orchestre) sous forme d’un « Recitativo » : « O Freunde, nicht diese Töne ! sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Freude… ». Il chante alors sur le thème trouvé dans la première partie instrumentale la première strophe du poème de Schiller très connu de tous les contemporains d’alors, An die Freude (le poème avait été mis près de cinquante fois en musique dans des formations très variées) :
« Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt;
alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt. »
(« Joie, belle étincelle divine, / Fille de l’Elysée, / Nous pénétrons ivres de feu, / Céleste, dans ton lieu saint. / Tes enchantements unissent de nouveau / Ce que la convention a rigoureusement séparé, / Tous les hommes deviennent frères, / Là où ta douce aile plane. »)
Le chœur reprend les quatre derniers vers. Cette forme responsoriale est mise en œuvre pour la suite du mouvement qui se déroule telle la succession des scènes d’une pièce de théâtre, reprenant et combinant quelques strophes du poème initial avec les deux premiers vers. S’enchaînent ainsi des variations qui conservent l’identification du thème pour éclater dans une bacchanale finale, « Prestissimo ». Les étapes sont nombreuses : Allegro assai (mes.237), Allegro assai vivace / Alla marcia (mes. 331), Andante maestoso (mes.595), Adagio ma non troppo, ma divoto (mes.627), Allegro energico, sempre ben marcato (mes.655, double fugue), Allegro ma non tanto (mes.763), Tempo I (mes.813), Poco adagio (mes.831), Poco allegro, stringendo il tempo, sempre piu allegro (mes.842-850), Prestissimo (mes.851), Maestoso (mes.916), Prestissimo (mes.920-940).
Cette façon de mettre en scène se retrouve de manière évidente dans bien d’autres œuvres. Citons, le Quinze Variations pour piano op.35 (dites « Variations Eroïca ») composée en été 1802. Le thème original (de Beethoven) qui provient d’une de ses œuvres, le Finale de la musique du ballet Les Créatures de Prométhée op.43 composée en 1801, est présenté d’une manière insolite (ou pédagogique !) : Beethoven, tout au plaisir d’inventer « une nouvelle manière » commence par donner le cadre harmonique (Introduzione col Basso del Tema) dans une carrure tout à fait classique (4 mesures, et reprises), puis il ajoute successivement une voix : « a due », « a tre », « a quattro », avant d’énoncer la mélodie du thème entièrement harmonisée « Tema ». Suivent alors les quinze variations, auxquelles s’ajoutent une « Coda » et un « Finale alla fuga ». Beethoven a repris cette façon originale d’énoncer le thème dans le Finale de la Symphonie Héroïque op.55, développée sur ce même thème, celui de l’apothéose de Prométhée.
D’autres formes de mises en scène peuvent être citées. Par exemple dans le Lied Seufzer eines Ungeliebten/ Gegenliebe WoO 118 (composé en 1795), association de deux poèmes de Gottfried August Bürger, Beethoven introduit le second poème par une suspension harmonique de huit mesures qui porte les termes répétés de « Wüsst’ Ich ? » (« Si j’avais su ») que l’amour partagé existe (Beethoven a repris ce thème dans le Finale de la Neuvième Symphonie).
Autre exemple : à la fin de sa première série de Quatuors à cordes, les Six de l’op.18 composés autour de 1800, il intitule le dernier mouvement du sixième Quatuor op.18 n°6, La Malinconia. Adagio : alors qu’un Finale rapide est attendu, Beethoven fait précéder l’« Allegretto, quasi Allegro » par une page de musique erratique qui instaure le doute le plus radical. Ce geste quelque peu théâtral est polysémique : il déroute volontairement pour signifier que c’est lui le compositeur Beethoven qui décide de la forme, la mélancolie étant depuis l’Antiquité le signe du génie créateur. Puis, il insiste en brisant le développement de l’« Allegretto » par le retour de La Malinconia – processus qu’il a déjà utilisé dans la Sonate Pathétique op.13 composée en 1798 : le « Grave » initial revient deux fois dans l’« Allegro di molto e con brio ».
Bien d’autres Sonates attestent chacune à sa manière cette composante essentielle du processus créateur de Beethoven qu’est la mise en scène : la Sonate op.27 n°2 (baptisée plus tard, bien après la mort de Beethoven, « Sonate au clair de lune » ou « Clair de lune ») commence par un premier mouvement lent, « Adagio sostenuto », qui doit être joué le plus délicatement possible et avec la pédale (selon les injonctions portées sur la partition éditée), et qui associe mystère et improvisation, avant le déferlement de vitalité de l’« Allegretto » et la fébrilité du finale « Presto agitato ».
Également c’est le monde de l’opéra et de sa mise en scène qui structure les Sonates op.110 et op.111. L’op.110, composée en 1820, qui commence par un mouvement « Moderato cantabile molto espressivo », suivi d’un « Allegro molto » plein de suspens, se termine par un mouvement d’une grande complexité, constitué de sections juxtaposées et imbriquées (comme avec la Malinconia) : un « Adagio ma non troppo » d’où émerge un « Recitativo » qui précède un « Klagender Gesang / Arioso dolente » répondant à une suspension émotionnelle produite par la répétition de mêmes notes ; ce moment plaintif débouchant sur une « Fugue, Allegro ma non troppo », qui sera perturbée par le retour de la plainte, et une perte de force, à nouveau dépassée par la reprise de la fugue, inversée : « L’istesso tempo della Fuga po a poi di nuovo vivente / Nach und nach wieder auflebend » ; le mouvement se terminant sur un déploiement sonore d’une grande énergie. Cette référence à l’opéra se retrouve dans la Sonate suivante op.111 composée en 1821-1822 qui part d’un « Maestoso » précédant un « Allegro con brio ed appassionato » pour se terminer par un mouvement dénommé « Arietta. Adagio molto semplice e cantabile », suite de variations qui s’élèvent, s’épanouissent et s’évanouissent dans les vibrations de la matière sonore.
Cette mise en scène de la perte de forces et de leur retour se retrouve au cœur du Quatuor op.132 qui comprend un troisième mouvement intitulé « Chant de reconnaissance d’un convalescent à la divinité dans le mode lydien », formé de 5 sections (ABA’B’A’’), donc construit sur l’alternance d’une sorte de choral « Molto adagio » (A) et d’une sorte d’interlude instrumental « Andante » portant la mention « retrouvant de nouvelles forces » ; ce mouvement de grande ferveur est suivi d’un bref mouvement « Alla marcia » ; le quatuor se termine par un « Allegro appassionato » introduit par une sorte de récitatif fiévreux du premier violon.
Citons encore le Quatuor op.131 qui constitué d‘une succession ininterrompue de sept morceaux de durée variée (de très court à très long), fut envoyé au cours de l’été 1826 à l’éditeur Schott avec la mention « rabouté à partir de bribes volées de-ci de-là » : Beethoven répondant très rapidement à l’éditeur affolé que son Quatuor était flambant neuf (« nagelneu »), sorte de déroulement d’une pensée en action procédant par association d’idées pour aboutir à une affirmation d’une puissante vitalité. Cette pensée en acte est également mise en scène dans le Quatuor op.135 dont le dernier mouvement est placé sous le signe de l’exergue : « Muss es sein ? » – « Es muss sein ! » : n’oublions pas que Beethoven était un lecteur admirateur de Shakespeare et qu’il était souvent comparé au dramaturge anglais (tout autant qu’à Michel-Ange). Il y a certainement une référence implicite au célèbre « To be, or not to be ? », paradigme de la métonymie du théâtre et de la mise en scène.
Enfin, pensons au Finale initial du Quatuor op.130, cette Grande Fugue de près d’un quart d’heure qui entre en tension avec le mouvement qui la précède, la subtile « Cavatine. Adagio molto espressivo » (sachant que la Cavatine est du ressort de l’opéra) : Beethoven renouait ici avec les déchirures de la mélancolie.
Le théâtre et l’opéra président également à la succession des 33 Veränderungen op.120 sur un thème de Diabelli, comme permet de l’affirmer la métonymie de Don Giovanni qui constitue la XXIIe Variation : « Allegro molto alla « Notte e giorno faticar » di Mozart ».
Pour reprendre la métaphore initiale du labyrinthe, il est possible d’affirmer que c’est Beethoven qui tient le fil d’Ariane et nous emmène là où il veut, construisant ainsi avec minutie un parcours musical, équivalent d’un récit manifeste destiné à masquer un contenu latent en le déguisant, en lui conférant une configuration acceptable (faite de déplacements d’accent, de retournement en son contraire, de condensation, de délayage, conformément au travail du rêve). La mise en scène est donc le moyen de satisfaire son désir sans dévoiler son secret aux yeux de tous. Ainsi, dans le récit de Neate la succession de plusieurs tableaux, l’accélération du rythme jusqu’au choc final qui survient brutalement de manière imprévue est analogue au déroulement d’un drame musical entraîné par un tempo accéléré, évocation déguisée d’une scène originelle, donc qui pourrait être également la métaphore de la « scène primitive ». La forme et le rythme de ce récit établissent donc un lien entre le recours à la mise en scène et la façon de se raconter l’origine de sa surdité, située du côté d’un désir coupable concernant le rapport au père : prendre sa place, ou prendre la place de la mère dans la scène primitive.
3/ La déception : trait dominant de cette succession de tableaux
Le récit rapporté par Neate est dominé par le mécontentement du primo tenore : l’air que Beethoven lui compose ne lui convient pas. Cette réaction reflète celle suscitée par chacune des nouvelles compositions de Beethoven, sauf rares exceptions (pensons au Septuor op.20, à la Sonate pour piano op.90 ou encore au Liederkreis An die ferne Geliebte op.98) : en l’occurrence comme d’habitude, les compétences et l’horizon d’écoute de ses contemporains sont dépassés. Ce scénario signale que ce que compose Beethoven ne correspond décidément pas aux attentes des interprètes, pas plus qu’à celle des commanditaires ou du public, et peut-être inconsciemment aux figures d’autorité, en premier lieu à celle de son père. Pensons à la Messe op.86 qui a scandalisé son commanditaire le prince Esterhazy habitué aux Messes de Haydn. Ou pensons à la Cinquième Symphonie, op.67, qui n’a pas du tout intéressé le public le jour de sa création le 22 décembre 1808.
Comment Beethoven a-t-il vécu, a-t-il ressenti ce rejet quasi-permanent ? Plusieurs lettres à ses éditeurs attestent qu’il ne se sent pas atteint, constatant toutefois que ce genre de critiques pourrait désarçonner des débutants fragiles… A-t-il, malgré tout, l’impression qu’une volonté cherche à casser son originalité, à barrer son désir : une volonté de qui ? de son père ? du destin ? ce destin qu’il veut « saisir à la gueule » comme il le proclame à Wegeler dans sa lettre du 16 novembre 1801 ? ce « démon jaloux » évoqué dans sa lettre du 29 juin 1801, qui s’est mis en travers de sa route qu’il décide de combattre à mort ?
Il s’avère que Beethoven a souvent cherché à être aux prises avec cette figure du « démon jaloux », avec cette figure du tyran et que sa devise aurait pu être celle des Brigands de Schiller : « In Tyrannos », cette pièce qui l’a enthousiasmé dès sa création en 1782 à l’instar de ses contemporains (elle fut représentée à Bonn en 1783 sur la scène du Nationaltheater).
N’oublions pas qu’il transportait avec lui parmi les quelques objets auxquels il tenait[7], un petit buste de 15 cm (acheté dans le commerce) représentant le Brutus, celui qui a fait condamner ses fils à mort car ils avaient comploté contre la Res publica pour rétablir la monarchie.
La grande figure du tyran dans l’œuvre de Beethoven est celle de Pizarro personnage pivot de son opéra Fidelio : alors que dans le l’opéra-comique français initial dont il s’est inspiré, Léonore ou l’amour conjugal, livret de Jean-Nicolas Bouilly et musique de Pierre Gavaux (Paris, 1798), le personnage de Pizare n’a qu’un rôle parlé, Beethoven lui a conféré une voix de baryton basse et deux airs d’une fougue haineuse, vengeresse (outre un duo terrifiant et la participation à des ensembles générateurs d’angoisse). La musique campe un Pizarro se livrant entièrement à la jouissance de l’assassinat qu’il est sur le point de commettre comme l’attestent et le n°7 « Ha, welch’ ein Augenblick » (Ah ! quel instant !) et le début du quatuor vocal n°16 « Er sterbe ! » (Qu’il meure !) – mais, avant de perpétrer le meurtre, Pizarro veut augmenter sa jouissance vengeresse en dévoilant son identité : « Doch er soll erst wissen… »…la musique explose littéralement : « fournaise orchestrale », dissonances, accélération du tempo, jeu trépidant et intense de tous les instruments … jusqu’au moment où Leonore, déguisée en Fidelio, arrête le geste meurtrier : « Zurück ! », dévoilant à son tour son identité ; Pizarro après un moment de sidération, reprend ses esprits et décide de tuer Leonore et Florestan, mais le signal des trompettes annonce l’arrivée du Ministre salvateur… C’est donc la défaite de Pizarro, marquée par une sorte de cri de tout l’orchestre rendu par un intense accord dissonant en tremolos sur roulement de timbales, durant deux mesures : « Es schlägt die Rache Stunde » (« L’heure de la vengeance sonne ») s’écrient Leonore et Florestan, tandis que Pizarro rage : « Verflucht sei diese Stunde ! » (« Maudite soit cette heure »). Le dévoilement des intentions meurtrières de Pizarro déclenche la liesse générale, le soulagement de tous ceux qu’il opprimait (Florestan, prisonnier politique à abattre n’était pas seul dans cette prison). Pizarro incarne donc cette puissance agressive, animée par une volonté destructrice dirigée contre un ennemi spécifique : celui qui lui a tenu tête, qui a osé le défier et dénoncer son arbitraire. Figure de cette autorité aveugle, à l’image de toute pulsion meurtrière, Pizarro est bien celui qui structure cet opéra, suscitant les réactions véhémentes de Leonore et de Florestan attachés à dénoncer le tyran, à dévoiler son ignominie.
Szenenbild zur Oper « Fidelio » – Stich von Vincenz Raimund Grüner / Beethoven-Haus Bonn, Jf 43 WIEN / 1805 Wien
La métaphore du dévoilement de l’identité comme des intentions mortifères renvoie à une des phrases du texte recopié par Beethoven, trouvé dans un ouvrage de Schiller, Die Sendung Moses : « aucun mortel n’a soulevé mon voile » … Que cache ce voile ? une pulsion mortifère ? En tout cas un secret qui doit être protégé … La problématique du dévoilement est donc vraiment bien présente pour Beethoven : son but affiché semblant être de débusquer des forces hostiles incarnées par Pizarro …, alors qu’il s’efforce également de cacher les intentions comme les actions malfaisantes, les unes et les autres cristallisées par le cri – condensation de ce qui a fait traumatisme et reproduction de ce traumatisme.
D’autres œuvres de Beethoven portent cette référence au défi lancé à une autorité, que ce soit l’Ouverture op.62, destinée à redonner vie à la pièce de théâtre, Coriolan de Heinrich Joseph von Collin en 1807, ou que ce soit la musique de scène op.84 pour l’Egmont de Goethe en 1810. Le choix de composer la musique incitée par les didascalies de Goethe a de facto affaire à la confrontation avec la figure du tyran : la droiture d’Egmont et sa détermination à faire triompher la justice et la vérité symbolisant ce défi lancé au destin, défi qui précisément entretient la force créatrice de Beethoven.
La figure du tyran et la rage créatrice qui lui est associée se retrouvent également dans des œuvres instrumentales. Pensons à l’Orage de la Symphonie Pastorale op.68 en 1808 qui vient brusquement interrompre un moment d’euphorie collective et qui s’apaise dans un chant pastoral évocateur de l’Arcadie antique. Un autre exemple : la déchirure (ou violent dévoilement) que font entendre les treize accords dissonants identiques sur un rythme impétueux qui lient le deuxième mouvement, un « Andante con moto » à variations très lyrique, au Finale (« attaca l’Allegro ») de la Sonate pour piano op.57, dite Appassionata (ce n’est pas un titre de Beethoven) en 1805/1806.
4/ Une rage autodestructrice : un autre trait dominant du récit de Neate
Le récit rapporté par Neate se caractérise par une tension croissante tout au long de son déroulement. A l’instar de bien des œuvres de Beethoven. Peut-on y repérer une métaphore du temps de déploiement de l’acte sexuel ? En quelque sorte cette accélération du plaisir menant à la décharge, à l’orgasme ? En l’occurrence, dans ce récit, la décharge est détournée sur la personne propre, comme s’il y avait autopunition et renoncement à l’acte, considéré comme interdit par la morale et l’éducation ou interdit car incestueux ?
Il s’avère que l’injonction au renoncement est omniprésente chez Beethoven : héritage d’une éducation chrétienne, attentive à réprimer les pulsions ? A plusieurs reprises dans le Testament d’Heiligenstadt comme dans son Tagebuch, les pensées inscrites ou les citations recopiées sont des exhortations au « renoncement », à la « résignation » : renoncer à la vie commune avec A., se résigner à la surdité. Ainsi, la première mention du Tagebuch en 1812, sans doute en lien avec la lettre à l’Immortelle bien-aimée du 6 juillet 1812, est centrée sur le renoncement, le sacrifice exigé par son art, ce qui l’exclut du cercle des autres humains, implorant alors Dieu pour qu’il lui donne la force de se délier de ce qui le retient à la vie :
« 1 Ergebenheit, innigste Ergebenheit in dein Schicksal, nur diese kann dir die Opfer- – – zu dem Dienstgeschäft geben – o harter Kampf! […] Du darfst nicht Mensch seyn, für dich nicht, nur für andre; für dich gibt’s kein Glück mehr als in dir selbst in deiner Kunst – o Gott! Gib mir Kraft, mich zu besiegen, mich darf ja nichts an das Leben fesseln.- Auf diese Art mit A geht alles zu Grunde –„
Cette exhortation à la résignation semble un écho de celle du vieux Faust dans son monologue initial : renonce à la vie, à tes rêves, à la réalisation de ton désir – suicide-toi ! – quand l’apparition du feu-follet et des cloches de Pâques lui redonnent goût à la vie – le feu-follet pouvant être une métaphore de ce buisson ardent lui-même métaphore de la musique « qui est ce qu’elle est », présence là où elle est. Cet art auquel Beethoven a décidé de se consacrer ….
N’oublions pas que Beethoven a été enthousiasmé par Faust (le premier) de Goethe : dès la publication de la première partie de la tragédie en 1808, il veut en acquérir un exemplaire. Et s’il s’est amusé à composer un Lied avec le Flohlied, moyen de critiquer la société aristocratique hiérarchisée et courtisane, il n’a cessé d’être fasciné par le vieux savant, désireux de tout connaître, de découvrir le mystère de la vie, de sauver des vies (son père était médecin), et capable de se métamorphoser en beau jeune homme qui erre et qui est dans l’erreur tant qu’il aspire à autre chose, guidé par celui qui toujours nie (qui n’accepte pas les choses telles qu’on veut les lui présenter, les lui faire admettre).
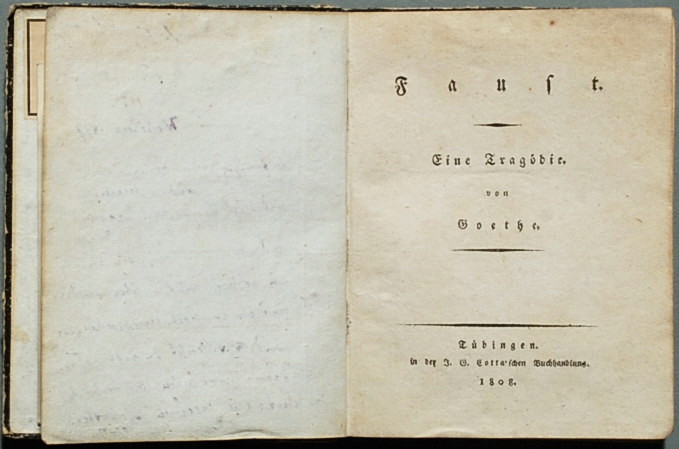
// Flohlied Op.75 N°3
Ce Lied a été publié dans un ensemble sous le titre de Aus Goethes Faust. Attiré par les Chants comiques à usage de sociabilité immédiate, Beethoven s’est intéressé dès 1790/92 au Chant de la puce chanté par Méphistophélès dans la cave d’Auerbach. Cette joyeuse réunion d’étudiants devait lui évoquer ce qu’il vivait au Zehrgarten, ce « Trinklokal » (cette « buvette » tenue par une amie de sa famille, Madame Koch, « buvette » qui faisait aussi office de librairie sur la Place du Marché à Bonn, tout près de l’Université).
| Mephistopheles (singt). | Méphistophélès (chante). |
| Es war einmal ein König, | Il était une fois un roi, |
| Der hatt’ einen großen Floh, | Qui avait un grand puçon. |
| Den liebt’ er gar nicht wenig, | Tendrement il l’aimait |
| Als wie seinen eignen Sohn. | Comme son propre fils. |
| Da rief er seinen Schneider, | Lors il appela son tailleur. |
| Der Schneider kam heran. | Vint le tailleur : |
| Da miss dem Junker Kleider, | Prends mesure au damoiseau pour un habit, |
| Und miss ihm Hosen an! | Prends-lui mesure pour une culotte. |
| In Sammet und in Seide | De velours et de soie |
| War er nun angethan, | Il était donc vêtu, |
| Hatte Bänder auf dem Kleide, | Portait rubans sur son habit, |
| Hatt’ auch ein Kreuz daran, | Portait aussi une croix dessus. |
| Und war sogleich Minister, | Il devint aussitôt ministre, |
| Und hatt’ einen großen Stern. | Et porta une grande plaque. |
| Da wurden seine Geschwister | Et tous ses frères et sœurs |
| Bei Hof’ auch großen Herrn. | Devinrent aussi des personnages. |
| Und Herrn und Frau’n am Hofe, | Messieurs et dames, à la cour, |
| Da waren sehr geplagt, | Furent alors très incommodés. |
| Die Königin und die Zofe | La reine et la camériste |
| Gestochen und genagt, | Etaient mordues, piquées ; |
| Und durften sie nicht knicken, | Et n’osaient pas les écraser |
| Und weg sie jucken nicht. | Ni mêmement se gratter. |
| Wir knicken und ersticken | Nous, nous grattons et écrasons |
| Doch gleich wenn einer sticht. | Sitôt que puce pique. |
| Chorus (jauchzend). | Le chœur (jubilant) |
| Wir knicken und ersticken | Nous, nous grattons et écrasons |
| Doch gleich, wenn einer sticht. | Sitôt que puce pique. |
Ce Chant a été écrit par Goethe « à la manière » des chansons populaires très prisées dans les milieux cultivés européens de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles : il s’agit d’une parodie de ballade de forme strophique, les strophes étant chantées par un chanteur devant des auditeurs qui, en chœur, reprennent ce qui fait fonction de refrain. Le thème satirique de ce Chant est en prise avec la réalité collective et politique, ici la critique du despotisme[8] et de la soumission des courtisans, critique exprimée par des métaphores faisant référence à une sorte de bestiaire rassemblant puce, porc et grenouille. Chez Goethe, il s’agit de métaphores appartenant au registre de la bestialité qui visent à mettre l’accent sur les pulsions et le débordement pulsionnel destructeur de toute société civilisée, et, paradoxalement, c’est Méphistophélès qui se fait le porte-parole de cette dénonciation.
Beethoven a conservé la forme de la ballade, évocatrice du chant populaire, voulue par Goethe : il n’a composé la musique que de la première strophe, mais l’autographe destiné à la gravure de la partition présente ce texte comme durchkomponiert (la musique est gravée pour toutes les strophes), le chœur final reprenant les deux derniers vers sur la musique du « refrain », qui sépare chacune des strophes, avant de conclure frénétiquement (par exemple en répétant avec la même note le « i » de « sticht » durant deux mesures sur quatre croches suivies d’une blanche), l’accompagnement soutenant et poursuivant cette frénésie (Beethoven exigeant que la dernière mesure soit jouée par le pouce qui glisse rapidement de note en note, par groupe de deux triples croches). Pour sa composition, Beethoven a cherché à transcrire le plus fidèlement possible le texte qui oscille entre récit et transcription sonore du geste : les onomatopées finales du chœur (transcription sonore des démangeaisons dues aux piqûres de puces) se transforment en agitation exaspérée tant du pianiste que des chanteurs. La combinaison de l’écriture figuraliste dans le style « ancien » baroque et de l’écriture harmonique « moderne » très simple accentue l’aspect humoristique de cette musique destinée à un moment très important de la tragédie de Goethe : il s’agit de la première sortie de Faust dans le « petit monde » …
La date établie des premières esquisses de ce Chant (après 1790) permet d’affirmer que Beethoven s’est intéressé à ce passage du Faust dès qu’il a lu l’œuvre de Goethe, Faust. Ein fragment, paru en 1790[9].
Beethoven, qui fut sans doute le premier compositeur à mettre en musique ces vers de Méphistophélès (vers qui devinrent très célèbres), esquissa une partition qu’il conserva pratiquement intacte lors de sa reprise en 1809 en vue d’une publication. Si la version publiée accentue le caractère scénique de ce Chant, dès 1790 Beethoven avait déjà pensé cette ballade comme une scène de Singspiel : Méphistophélès doit être autant acteur que chanteur ; il s’adresse à d’autres acteurs (le chœur des étudiants) ; et l’accompagnement musical a une simplicité telle qu’il peut être joué sur scène par un luth ou une guitare.
Pour ce Chant, Beethoven a choisi la tonalité de sol mineur et une métrique à 2/4. Chacun des vers correspond à deux mesures, la déclamation est syllabique et la ligne vocale est plus proche du parlé que du chanté. L’interprétation musicale de Beethoven redouble l’humour du texte de Goethe et joue sur la parodie liée à la mise en jeu de plusieurs scènes imbriquées : la scène sur laquelle Méphistophélès se produit devant Faust et le public des étudiants ; la scène grotesque racontée par le chant, ce roi qui honore sa puce ; la scène des étudiants piqués par les puces et la scène proprement musicale du Lied avec accompagnement pour piano.
La musique écrite par Beethoven respecte la structure voulue par Goethe. Beethoven a d’ailleurs fait très attention à ce que le copiste et l’éditeur respectent le texte des strophes : au moins à deux reprises[10], il a insisté auprès de son éditeur Breitkopf & Härtel pour qu’il lui soumette les « épreuves » afin de contrôler la disposition des paroles des trois strophes, paroles qui doivent être intégralement reproduites, et non évoquées sous forme d’abréviations comme c’est le cas sur le manuscrit qu’il a fourni pour la gravure : l’éditeur n’a qu’à se reporter au texte publié de Goethe…
Pour traduire la dimension critique et satirique de ce Chant, la musique combine plusieurs références musicales implicites. Tout d’abord, l’ensemble de la partition joue sur l’opposition des tonalités de sol mineur et de sol majeur (tonalités simples et populaires, Papageno chante son air de l’Oiseleur en sol majeur, par exemple), à 2/4 (métrique simple et carrée) dans un tempo noté Poco allegretto. Puis, le début est une ritournelle-refrain qui peut être qualifiée de figuraliste à la manière des musiques baroques : les notes rapides, nerveuses et piquées procèdent par sauts de larges intervalles montants et descendants de manière cohérente sur un dessin rythmique identique durant trois mesures, avant qu’une quatrième mesure formée de la montée diatonique (en notes conjointes) de quatre croches à l’unisson, solennelles, n’installent le sol mineur et n’annoncent l’entrée de la voix par la suspension sur la note ré (dominante du ton de sol). Enfin, un récit – à l’imparfait, « Il était une fois un roi » – commence par une énonciation qui s’inscrit dans le registre des musiques d’entrées „royales“ (toujours à connotation baroque, c’est-à-dire d’ancien régime), par le rythme et l’aspect monocorde de la ligne vocale qui se déroule sur la tonique et est soutenue par un accompagnement constitué d’accords solides ancrant un sol mineur sans ambiguïté. Les modulations qui suivent (fa majeur, puis ut mineur) soulignent l’amour insolite du roi : un puçon qu’il n’aime pas moins que son fils ! Le style rappelle alors celui d’un choral harmonisé avec simplicité (autre allusion à une musique d’ancien régime) : huit mesures qui sont relayées par quatre mesures figuralistes (rapides et agitées du fait des appogiatures successives) pour assurer une transition avec le refrain. La deuxième et la troisième strophes sont identiques. L’ensemble se termine par le chœur, fortissimo, qui joue sur les sonorités des mots choisis par Goethe et sur la rapidité de leur énonciation en notes répétées et conjointes (« knicken und ersticken » [« grattons et écrasons »]), combinaison de figuralisme musical (attaques des puces) et d’implication physique des chanteurs et du pianiste que les notes et accords rapides et répétés obligent à s’agiter (comme s’ils tentaient de calmer des démangeaisons !).
Malgré les références aux différentes musiques caractéristiques de l’ancien régime, l’ensemble de la composition, par son jeu harmonique et tonal (dimension verticale qui l’emporte sur la mélodie, oscillation majeur/mineur, modulations), et par sa carrure reposant sur une succession de groupes de quatre mesures, est bien inscrite dans son siècle « classique ». Cette musique « moderne », et parodique, est à l’image de la ballade de Goethe : elle sert une critique politique et sociale de l’ancien régime, et d’exutoire à la limite du scatologique pour Beethoven.
Ainsi, sous couvert de s’emparer d’une situation pleine humour critique, Beethoven donne consistance à une rage dont la composante scatologique et bestiale atteste l’ancrage archaïque.
Dès le début de ce récit rapporté par Neate qui a trait à l’origine de la surdité de Beethoven, la référence à Fidelio est écartée : « Pas Fidelio ». Beethoven qui, dans le scénario du récit, était en train d’écrire un opéra, ne composait pas Fidelio ! De quoi s’agit-il si ce n’est pas Fidelio ? sachant qu’il n’a jamais écrit d’autre opéra que celui-ci, qu’il avait conçu certes sous le titre de Leonore acceptant difficilement de l’inscrire sous le titre de Fidelio. Nous avons déjà mentionné son intention de composer la musique d’un Romulus juste au moment de la présence de Neate à Vienne, mais aussi juste au moment où il a décidé de prendre en charge son « pauvre petit neveu » (BGA 894). Et il est vrai que toute sa vie il a été à la recherche d’un livret[11], mais il ne reste que très peu de traces de composition à l’exception de la première scène de Vesta’s Feuer sur un livret de Schikaneder esquissé en 1803 (Unv 15), une feuille d’esquisse pour un Macbeth sur un livret de Heinrich Joseph von Collin (1771-1811) (Unv 16) auquel il a pensé entre 1808 et 1811, et quelques esquisses de 1815 pour un opéra sur un thème antique (sans plus de précisions). S’il y a peu de traces de composition, il existe de nombreuses mentions de projets jamais mis en œuvre : Faust de Goethe dès 1808, le mélodrame historique Les ruines de Babylone sur un livret de Pixerécourt (1773-1844) en 1811, Le retour d’Ulysse de Theodor Körner (1791-1813) en 1812, Die Schuld (La faute) de AGA Müllner (1774-1829) semble l’avoir intéressé en 1813, le Romulus et Remus sur un livret de Georg Friedrich Treitschke (1776-1842) en fin 1814, puis en fin 1815, un opéra lyrique Bacchus sur un livret de Rudolf vom Berge (1775-1821) envoyé par son ami Amenda en 1815, le Macbeth de Shakespeare d’après les souvenirs de l’acteur Heinrich Anschütz en été 1822, une Melusine sur un livret de Franz Grillparzer (1791-1872) en 1823-1826, un Orest envisagé avec Ludwig Rellstab (1799-1860) en1825. Et Beethoven suggérait un Attila à August Kotzebue (1761-1819) en 1812… (BGA 546), insistant sur l’atmosphère de temps sombres…
Donc l’opéra pourrait être Romulus, livret de Treitschke que Beethoven était sur le point de mettre en musique au moment où Neate allait repartir à Londres au début de 1816, retardant sans cesse ce départ, comme nous le savons par une remarque de Beethoven (BGA 896) : ce qui témoigne de leur proximité à ce moment, Beethoven était d’ailleurs prêt à l’aider s’il voulait organiser un concert avant son départ.
Mais, est-il vraiment nécessaire vu la fiction du récit de se demander sur quel opéra il travaillait ? L’important est la métonymie implicite : il écrivait une œuvre pour la scène… mais quelle scène ? Et il s’avère que Beethoven ne veut pas mêler Fidelio à ce choc à l’origine de sa surdité : pourquoi ?
Est-ce une indication du moment où ce primo tenore est venu l’importuner ? avant Fidelio ? après ? De toutes façons, il y a une indication temporelle : Fidelio servant de césure, avec un avant et un après… et il y a une intense charge émotionnelle dans l’évocation de cet opéra, vu la réaction immédiate et radicale que comporte la réplique.
Cette façon d’écarter, d’épargner Fidelio ne laisse-t-elle pas supposer qu’il s’agit d’un autre registre. Fidelio se situerait sur une autre scène : celle rêvée de la rencontre avec l’aimée, ce qui lui est interdit dans la réalité, son désir étant barré par un ennemi mortel. Il a lu Goethe et sait ce que sont les « affinités électives », si l’on se réfère au journal intime d’Antonie Brentano qui évoque le roman de Goethe tandis qu’elle écrit à sa cousine Bettina le 11 mars 1811 que Beethoven vient presque tous les jours chez elle pour la réconforter en lui jouant du piano.
Nous avons vu que Fidelio qui met en scène l’ennemi mortel, est structuré autour de cet ennemi mortel. Or, l’ombre de l’ennemi mortel est familière à Beethoven : dès sa première lettre envoyée de Vienne le 2 novembre 1793 à Eleonore, il mentionne ses « ennemis mortels » qui cherchent à lui voler ses idées et à briller à sa place :
« P.S. les V.[ariations] seront un peu difficiles à jouer, surtout les trilles dans la coda, mais que cela ne vous effraye pas, tout est arrangé pour que vous n’ayez pas à utiliser les trilles, que vous laissiez les notes qui restent, parce qu’elles sont également jouées par le violon. Je n’aurais jamais procédé de cette manière, si je n’avais souvent remarqué que çà et là à V.[ienne] plus d’un reproduisait le lendemain ce que j’avais improvisé la veille, et qu’il plastronnait en s’appropriant ce qui était de mon invention ; à partir du moment où je soupçonnais que de telles choses allaient être prochainement publiées, je pris la précaution de les devancer. Une autre raison s’ajouta en outre : mettre dans l’embarras ceux d’ici qui se prétendent les maîtres du clavier, parmi lesquels plus d’un sont mes ennemis mortels, et je voulais ainsi me venger d’eux, parce que je savais d’avance qu’on leur montrerait mes V.[ariations] ici ou là, et qu’alors ces messieurs feraient la preuve de leur incapacité. »
Toute sa vie l’hostilité des autres sera d’actualité. Ainsi le récit du grand concert du 22 décembre 1808 au cours duquel furent créées plusieurs œuvres majeures : la Cinquième Symphonie, la Sixième Symphonie, le Quatrième Concerto pour piano, la Fantaisie pour piano op.77, des Hymnes de la Messe op.86, et qui fut couronné par la Fantaisie pour piano, orchestre et chœur op.80 – ce jour-là, Beethoven a improvisé l’introduction confiée au piano, puis, peu après le début du Finale, comme les instruments à vent (qui n’avaient pas eu beaucoup de répétitions !) s’étaient trompés dans leurs entrées, il a exigé que l’orchestre reprenne depuis le début. Beethoven donna sa version des faits dans une lettre adressée à Breitkopf & Härtel, le 7 janvier 1809 [BGA 350] :
„ sans tenir compte des quelques fautes commises auxquelles je ne pouvais rien, le public fut enthousiaste pour tout – malgré cela des scribes d’ici n’ont pas hésité à livrer à la Musikalische Zeitung à nouveau un minable argument contre moi – Principalement, les musiciens furent dans tous leurs états, quand, par manque d’attention pour une chose des plus simples et des plus claires au monde, une faute fut commise, je me suis arrêté tout d’un coup imposant le silence et j’ai crié encore une fois – ce qui ne leur était jamais encore arrivé, et ce que le public approuva – »
Beethoven n’est pas le seul à mentionner ses ennemis : son ami Stefan von Breuning à plusieurs reprises signale la cabale qui existe contre Beethoven en particulier à la suite des premières représentations de Fidelio (en novembre 1805 et avril 1806). Ainsi dans le récit qu’il fait, le 2 juin 1806, aux amis de Bonn (lettre publiée par Wegeler dans les Notices biographiques, p.62-64, que Neate avait donc sans doute lue), il fait référence à la cabale et aux ennemis qu’il a au théâtre, tandis que dans sa lettre d’octobre 1806 toujours adressée à Wegeler, il décrit la situation tendue qui rend Beethoven mélancolique : à la campagne chez Lichnowky, il est mécontent et va bientôt rentrer, ses ennemis ne désarmant pas… [12]
Les ennemis ne sortent donc pas seulement de l’imagination de Beethoven. Autre témoignage : au moment où, en été 1827, Rochlitz, écrivain et rédacteur en chef de l’Allgemeine musikalische Zeitung, a été pressenti pour rédiger sa biographie, il a refusé pour ne pas avoir à compromettre trop de gens aux aguets et sur leurs gardes… La vie musicale à Vienne n’était donc pas facile pour un Beethoven qui refusait de céder sur son désir… quitte à déplaire et à se faire des ennemis…
Que veut-il alors préserver en écartant Fidelio ? Cet opéra qui lui a valu tant d’ennemis autour de 1805-1806 ? Les raisons de cette cabale sont encore très obscures … sans doute liées à ses exigences musicales, tant pour les chanteurs que pour les instrumentistes, et peut-être à ses volontés impérieuses concernant la mise en scène, et plus encore tenant aux gains qu’il espérait ? Pourtant, les obstacles semblent levés quand en 1814 des acteurs-chanteurs du Kärntnertortheater demandent à Beethoven, alors compositeur très en vue sur la scène viennoise, s’ils peuvent remonter son opéra : il accepte à condition de remanier son opéra ; la reprise remporte un très grand succès, confirmé en 1822, toujours à Vienne, par le triomphe de Wilhelmine Schröder dans le rôle de Leonore, succès immortalisé par une célèbre gravu
re.
La figure de l’ennemi condensée par Pizarro y est donc confiée à une voix de basse, pas à un primo tenore : le ténor, c’est Florestan, la victime … Or, dans la réalité, la voix de ténor était celle de Johann le père. Ainsi, la distribution des voix dans Fidelio est peut-être une des raisons pour lesquelles Beethoven aurait écarté cet opéra au moment où il cherche à raconter comment il a été importuné par un primo tenore qui n’a rien à voir avec Florestan. Ce rejet, « Pas Fidelio ! » confirmerait que ce primo tenore, qui donc n’a rien à voir avec Florestan, est plutôt, en l’occurrence dans le récit rapporté par Neate, du côté d’une représentation de Johann. Florestan appartient au registre du sacré ! Contrairement à ce primo tenore… qui ne sait qu’être importun et poussant à la haine…
Autre source de sacré dans Fidelio : la figure de la justice et du droit incarnée par don Fernando qui pourtant, comme le tyran Pizarro, a une voix de basse ; mais dans ce cas, ce serait plutôt un souvenir de la voix de son grand-père Ludwig, que Beethoven se représentait sans doute comme un homme bon plein de bienveillance, veillant sur lui (en permanence) par l’intermédiaire de son portrait peint qu’il transportait lors de chacun de ses déménagements, comme nous l’avons déjà souligné.
Enfin, une autre source de sacré : la figure de Leonore, qui contrebalance celle du tyran, l’ennemi-à-mort. Leonore est le paradigme de la femme aimante, intrépide, décidée à sauver son mari ainsi que toutes les victimes d’injustice quoi qu’il arrive. Or cette femme est ambivalente : elle est d’abord appréhendée comme un jeune homme – ce que rêve être la Klärchen amoureuse d’Egmont dans la pièce de Goethe : porter un pantalon et aller à la guerre pour être avec son bien-aimé (thème de son premier Lied « Die Trommel gerühret »). Ces figures de femmes travesties sont en quelque sorte une condensation du féminin et du masculin… mère-père, association à l’origine de la vie. Condensation…
Ce travestissement, alors à la mode certes au théâtre et à l’opéra, a sans doute déterminé le choix de Beethoven pour ce livret dans lequel la femme est d’une activité exemplaire (à l’exemple même de l’homme), livret qu’il qualifie de « vieux livret français » alors qu’il s’agit d’une production récente directement issue du bouleversement des mentalités propre à la France révolutionnaire. Pourquoi emploie-t-il le qualificatif de « altes » pour parler de ce livret français ? Parce qu’il a déjà été mis en musique ? Ou parce qu’il a trait à des valeurs fondamentales, de l’ordre de l’archaïque ? Outre le fait qu’en 1803 ce choix de Beethoven pouvait lui ouvrir le chemin de Paris, il ancrait son attention dans le réel, puisqu’il s’agissait d’un « fait historique » qui avait vraiment eu lieu, tout récemment (le contraire de « vieux »). Or, il se trouve que depuis une vingtaine d’année le goût du public européen mélomane se tournait vers le thème du sauvetage : Beethoven était donc directement en prise avec l’actualité. Séduit par cette dimension du connu (du secrètement familier, cet Unheimlich étudié par Freud), il abandonne le livret antiquisant de Vesta’s Feuer et compose son opéra, alors que justement il est stimulé par son amour partagé avec Josephine, jeune veuve (comme sa propre mère !).
Fidelio condense donc des références intimes de l’ordre du « sacré » pour Beethoven : il ne faut pas l’exposer à la trivialité insupportable, voire mortifère du primo tenore tel qu’il est présenté dans le récit rapporté par Neate. Cette dimension « sacrée » s’inscrit également dans la musique suscitée par le personnage de Leonore, qui est d’une modernité remarquable, que ce soit le quatuor vocal n°3 ou le récitatif et air n°9, le mélodrame n°12, le Finale n°16… dans lequel Leonore reprend la mélodie confiée à l’ange, le n°3 de la Cantate de 1790 sur la mort de Joseph II (cette Cantate ne fut jamais exécutée du vivant de Beethoven). Cette mélodie, qualifiée de Humanitätsmelodie, établit un lien entre le temps de Bonn et celui de la composition de Fidelio à Vienne entre 1803 et 1805 ; or, ce n’est pas le seul emprunt, de Fidelio à la Cantate : la musique du chœur de déploration initial, suscité par la mort, est reprise pour introduire la détresse de Florestan au moment de son apparition au début du second acte de l’opéra, moribond enchaîné dans le fond d’un cachot sombre et humide. Or, le temps de Bonn, c’est celui de l’émancipation de Beethoven devenu ce jeune homme libre, considéré comme un génie prometteur, ainsi que celui de ses premiers émois amoureux, qui sont fortement attachés à la personne d’Eleonore von Breuning… émois troublés par une « dispute », par « un faux-pas » fatal… dont il ne se remet que difficilement comme l’attestent ses lettres adressées à Eleonore… l’une de Bonn au cours de l’été 1792, et l’autre de Vienne, le 2 novembre 1793, lettre dans laquelle il fait allusion à la « fatale Zwist » (fatale dispute) qui a failli lui faire perdre son amitié.
Il y a vraiment de l’Unheimlich, du « secrètement familier », dans Fidelio ! ce qui fait sans doute qu’il est de l’ordre de l’intouchable ! du sacré !
L’image de l’apothéose de Beethoven dans la veine populaire du XIXe siècle, insérée dans un journal de Vienne en 1843 en prévision de la cérémonie de 1845 à Bonn organisée autour de l’inauguration de la statue monumentale, traduit cette dimension : Beethoven est élu des dieux ! Or, cette apothéose est représentée au-dessus de la scène centrale de Fidelio : celle du cachot souterrain, Leonore repoussant le geste mortifère de Pizarro. Ce lien, par juxtaposition, entre Fidelio et le sacré est donc devenu une sorte de cliché, avant même que Neate ne rapporte la scène relatant l’origine de la surdité… Si ce rejet de Fidelio a été conservé dans le récit, c’est bien que du sens caché se niche dans le décor émotionnel de ce moment de bascule de la vie de Beethoven.
6/ Le dénouement tragique du récit de Neate
Enfin le récit de Neate se termine sur le choc fatal qui entraîne une rupture brutale, un changement d’état radical et définitif : la lésion du nerf auditif. Ce dénouement tragique et impitoyable ne correspond pas à la réalité : la surdité s’est imposée progressivement, mais il révèle la puissance du souvenir d’un traumatisme originel réactivé par la dimension inéluctable de l’action d’un « démon jaloux », selon l’expression employée par Beethoven dans sa lettre « d’aveu » adressée à son ami Wegeler le 29 juin 1801, comme nous l’avons déjà souligné. A ce moment douloureux où il s’est décidé à avouer sa surdité, Beethoven évoque donc ce „démon jaloux“ en utilisant l’image d’une entrave posée sur son chemin : « nur hat der neidische Dämon, meine schlimme Gesundheit, mir einen schlechten Stein ins Brett geworfen nemlich ». Pourquoi a-t-il recours à cette image, qui est en somme la condensation d’une mise en scène ? La pierre jetée sur son chemin par un démon jaloux qui entrave son avancée… Ce qui est frappant c’est que cette image semble condenser également le récit rapporté par Neate qui est une mise en scène certes plus développée : ainsi le « démon jaloux » correspondrait à la figure du primo tenore qui s’est mis en travers de son chemin, or cette figure ne peut qu’être le « représentant » de son père dans cette transposition psychique. Donc dès 1801, dès les premiers soupçons d’une surdité inéluctable, Beethoven aurait posé les éléments qui lui permettaient de s’expliquer les raisons de ce mal touchant à ce que son être possédait de plus précieux : la rivalité imposée par le père, situation qui renvoie autant à la jalousie et à l’hostilité, voire l’agressivité, paternelles supposées (indispensables à son économie psychique ?) qu’à la déception du fils face à un père défectueux, incapable d’accepter le génie de son fils – déception retournée contre lui-même, et transformée en culpabilité d’avoir été la cause de la mort de son père par son départ en début novembre 1792 (son père est mort le 18 décembre 1792, donc moins de deux mois plus tard) comme il avait causé la mort de sa mère à la suite de son premier séjour à Vienne en 1787, dans l’un et l’autre cas, chaque fois appelé par son « destin » de compositeur. Comme le souligne la psychanalyste Monette Vacquin : un fils part – un père meurt !
La référence à un traumatisme inconscient s’impose d’autant plus qu’une des caractéristiques de la constitution psychique de Beethoven est son goût pour les jeux de mots, reflet de la possibilité d’exprimer de manière détournée et inconsciente ce qui devrait rester totalement refoulé, mais dont la pression est si intense qu’elle ne peut pas être entièrement contenue.
II/ Wortspiel et Witze
Une voie royale pour déchiffrer la partition intérieure de Beethoven
Outre l’analyse, le décryptage du récit rapporté par Neate, une autre voie est offerte pour déchiffrer la partition intérieure de Beethoven : son goût pour les jeux de mots, car comme le fait remarquer Freud dans son étude publiée en 1905, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (p.158) une certaine disposition psychique est nécessaire pour s’adonner à cette pratique ; cette disposition est à chercher du côté de la tendance à l’exhibition pour montrer son esprit et du côté de la tendance à l’agressivité, mais également du côté du goût pour le partage avec d’autres (le Witz suppose toujours un tiers – on ne rit pas tout seul de ses bons mots – et il s’adresse toujours à quelqu’un). Le pianiste et compositeur Carl Czerny qui a été très proche de Beethoven a souligné cette particularité de Beethoven dans ses Anecdoten und Notizen über Beethoven publiées en 1852 : « Überall wusste er ein Wortspiel anzubringen. »[13].
Ainsi, que peuvent nous apprendre les jeux de mots de Beethoven ?
Remarquons tout d’abord que la plupart des jeux de mots inscrits par Beethoven dans ses lettres (ou parfois dans des compositions musicales) s’ancrent dans le sonore, dans ce qui est entendu, dans qu’il veut faire entendre : il ne les a transcrits qu’après-coup dans les codes de l’écriture (à l’instar du rêve qui doit être transcrit dans un « récit » constitué de scènes et d’un scénario, de mouvements, d’images pour être communiqué) ; mais, avec quels mots ? avec quelle façon de transcrire les sons ? quelles allusions et associations implicites portées par le déplacement ou la substitution de lettres : par exemple, le « r » et le « d » de « Tor/Tod » dans le canon WoO 189 composé sur un texte de Beethoven lui-même, en mai 1825, Doktor sperrt das Tor dem Tod (Docteur ferme la porte à la mort) – cette substitution correspond à l’exemple proposé par Freud de « tête-à-bête », Witz qui met en évidence les intentions inconscientes de l’auteur du jeu de mots choqué par la bestialité de son interlocuteur, ou autre exemple, le découpage de mots en différentes syllabes tel « Freiherr / Frei Herr », type de jeu de mots souligné par Freud qui prend l’exemple de la réponse : « O na nie », faite à une question posée sur la masturbation éventuelle de la personne interrogée, stupéfaite !
Chez Beethoven les occurrences de jeux de mots abondent.
/ Par ajout d’une lettre
Tel « Erziehung / Verziehung » (Education / mauvaise éducation).
Ou très fréquent, le jeu entre les mots « Not“ et „Note » (détresse / notes de musique) : par exemple dans une lettre à Ferdinand Ries en février 1825 dans laquelle il dit espérer sortir de ses besoins au moyen de ses notes ; ou ce qu’il écrivait dans le cahier de conversation, début mai 1825 : « Mein Arzt half mir denn ich konte kein[e] Note me[hr] schreiben, nun aber schreibe ich notten, welche mir aus den Noethen helfen“ (BKh 7, S.256) (Mon médecin m’a aidé car je ne pouvais plus écrire de note, maintenant je peux donc écrire des notes qui m’aident à sortir de la misère) – cette remarque est contemporaine du Canon envoyé le 13 mai 1825 depuis Baden au Dr Anton Braunhofer (BGA 1967) qui le soignait, „Doktor sperrt das Tor dem Tod“ (11 mai 1825), WoO 189 (Docteur ferme la porte à la mort).
/ Par substitution de lettres
Tel „Tor / Tod“ dans ce Canon WoO 189 qui joue entre le portail et la mort, soit entre le passage, l’ouverture et la clôture, la fin : il espère être guéri.
Ou, très souvent le jeu de mot entre « Diabelli » et « Diabolus », pour nommer Anton Diabelli, qui fut employé chez Steiner comme correcteur d’épreuves à partir de 1816 avant d’être lui-même éditeur de musique : Beethoven se plaignait toujours des fautes laissées par les éditeurs…
Également très fréquent : le contraste « Leer / gelehrt » (Vide / savant) entre autres dans des lettres à l’éditeur Schott le 17 février 1824, le 13 août 1825, ou encore janvier 1825.
/ Par modification du mot
Le mot « Verleger“ (éditeur) est associé à „Verlegenheit » (Embarras): par exemple dans une lettre à Steiner de janvier 1817 ou dans une lettre à Simrock du 15 février 1817.
Ou le nom de l’éditeur « Steiner » est associé au mot « Stein » qui signifie « pierre », quand, dans une lettre du 10 septembre 1821, Beethoven veut signifier que Steiner est âpre au gain… qu’il a un cœur de pierre…
/ Par découpage du mot en syllabes
Ainsi « Kühl nicht lau » correspond à une plaisanterie à partir du nom du compositeur Kuhlau auquel Beethoven a offert un Canon WoO 191, le 3 sept 1825, avec le commentaire « Frais mais pas tiède » … c’est ainsi que doit se boire le champagne.
Egalement le nom de « Hoffmann“ (Hof = cour, et Mann= homme) est un sujet de plaisanterie dans le Canon „Hoffmann, sei kein Hof Mann » („Hoffmann, qu’il ne soit pas un courtisan ») WoO 180 composé en mars 1820 (et publié en 1825) sur un texte établi par Beethoven « Auf einen, welcher Hoffmann geheißen » („Sur quelqu’un qui s’appelle Hoffmann“).
L’analyse de ces jeux de mots (leur nature, leur contexte) permettrait-elle d’approcher le secret que Beethoven désigne comme « ein innerer Gram » (affliction intime) qui lui a longtemps dérobé son ressort (« Spannkraft ») habituel, expression utilisée dans sa lettre à Josephine Deym (en mars/avril 1805, BGA 216) ? N’oublions pas qu’en 1819 il a recopié la sentence de Saïs, citée par Schiller dans Die Sendung Moses, qui affirme : « aucun mortel n’a soulevé mon voile », soit : personne ne s’est aventuré à dévoiler ce que je cache…
1/ Personne ne doit découvrir mon secret
« Ich bin alles, Was ist, Was
war, und Was seyn wird,
Kein sterblicher Mensch
hat meinen Schleyer
aufgehoben“
„Er ist einzig [und] von ihm selbst,
u. diesem Einzigen sind
alle Dinge ihr Daseyn schuldig“
Cette sentence soigneusement recopiée par Beethoven en 1819, et qui d’après Schindler était encadrée sous verre et placée sur son bureau, est désignée comme Beethovens Glaubensbekenntnis, soit « profession de foi » : interprétée donc comme l‘expression de la pensée religieuse de Beethoven, une attitude monothéiste dans la lignée de Spinoza (« Deus sive Natura »), ne serait-elle pas aussi, même d’abord, par déplacement d’accent, l’expression du souhait fondamental de Beethoven : que personne de découvre son secret !
Il est frappant de voir la place importante de la notion de secret attachée à Beethoven. Ses contemporains, obsédés par la recherche du secret (Geheimnis) de son génie, ont recueilli nombre d’anecdotes plus ou moins véridiques et ont scruté les partitions autographes : ainsi, en 1838 l’éditeur Anton Diabelli a osé publier une partition pour piano (à 2 et à 4 mains) intitulée « Ludw. van Beethoven’s letzter musikalischer Gedanke » (Dernières pensées musicales), arrangement établi à partir d’un manuscrit original inachevé de 1826 destiné à un Quintette à cordes (WoO 62). Ils ont également étudié ses exercices d’apprentissage que Ignaz von Seyfried a publiés en partie en 1832 sous le titre de Ludwig van Beethovens Studien im Generalbasse, Contrapuncte und in der Compositionslehre. Ils ont interrogé ses esquisses, quand elles n’avaient pas encore fait l’objet de cadeaux à des admirateurs en demande de « reliques », et ils ont collecté les partitions recopiées par Beethoven ainsi que les ouvrages de théorie musicale qu’il avait consultés dont les auteurs sont Fux, Kirnberger, Marpurg, Mattheson, Sulzer, Türk.
Beethoven avait donc un secret… qu’il a d’ailleurs pris bien soin de protéger comme l’atteste la présence d’un tiroir dérobé dans son bureau[14]…
tiroir dans lequel il déposa plusieurs documents qui ne seront découverts qu’après sa mort : la lettre à ses deux frères, désigné comme Testament d’Heiligenstadt (1802) ; la lettre de plusieurs pages écrite au crayon à papier à son Unsterbliche Geliebte (Immortelle bien-aimée) les 6 et 7 juillet 1812 ; et deux médaillons avec des portraits de femmes (objets courants représentatifs d’une coutume fréquente alors)… ainsi que des titres de rente cachés dans une petite boîte en bois, oblongue et très abîmée[15]. Ces lettres et objets conservés secrètement relèvent d’une façon ou d’une autre du registre de la survie : testament, amour, argent.
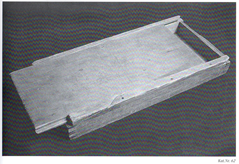
Si les destinataires du « Testament » sont identifiés : c’est une lettre qui est adressée à ses frères (même si un des prénoms est laissé en blanc trois fois, soit à chaque fois qu’il désigne ses deux frères), l’Immortelle bien-aimée n’est pas nommée…, pas plus que les femmes des portraits médaillons : secret bien gardé… qui relève pourtant du caché-montré, car si ces documents n’ont pas été détruits par Beethoven, c’est qu’il souhaitait (à son insu, sans que ce soit délibéré ?) poser une énigme à la postérité avec l’espoir que son secret soit décrypté comme le laisse supposer l’interpellation qui ouvre son Testament : « o ihr Menschen (…) ihr wisst nicht die geheime ursache von dem » (« o vous les Hommes (…) vous ne connaissez par la cause secrète de cela») …
Donc, si secret il y a, ce n’est pas seulement celui de son génie… ou peut-être est-ce ce secret qui anime son génie, en attisant et en entretenant son désir face à l’intensité duquel il ne cède pas, donc qu’il accepte d’affronter, de « prendre à la gueule » selon sa propre expression : « je veux saisir le destin à la gueule, il ne doit certainement pas m’abattre totalement » (« ich will dem schicksaal in den rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht », 16 novembre 1801, BGA 70) … Son secret concerne bien une question vitale pour lui : il s’agit de vie ou de mort.
2/ Comment approcher ce secret qui attise son désir ?
Dans son texte Beethoven liest « musiktheorethische Fachliteratur » (p.29-30, in Beethoven liest, Beethoven-Haus, Bonn, 2016), Julia Ronge rappelle que Beethoven passionné par la résolution de canons énigmatiques a tenu à trouver la solution musicale d’un canon énigmatique pour quatre voix, donné en exemple par le théoricien Johann Philipp Kirnberger dans son ouvrage Die Kunst des reinen Satzes in der Musik (1774) : le thème du canon provient, non sans humour vu la difficulté de la solution, d’un cantique intitulé « Aus tiefer Not, ruf ich zu Dir“ (du fond de ma détresse, je t’appelle). Il a fallu 12 pages de brouillon à Beethoven pour résoudre l’énigme, trouvant enfin la solution pour laquelle il a noté non sans fierté « le meilleur » (D-B, Mus. ms. autogr. Beethoven Artaria 153, S.35.). Soucieux de parfaire sa technique d’écriture et de mettre en évidence son intelligence (il ne savait pas faire de multiplications !), il adorait ce genre de défis et échangeait avec ses amis compositeurs au moyen de canons à résoudre (parfois énigmatiques !), comme en témoignent de nombreuses lettres (voir la liste d’une quarantaine de canons dans le Werkverzeichnis 2, Henle 2014).
Mais, par-delà ce goût pour la stimulation intellectuelle, s’intéresser à un texte qui comprend le terme « Not » n’est pas anodin pour Beethoven puisqu’il aimait l’associer, par jeu de mots, à « Note », c’est-à-dire qu’il établissait un lien, par sonorités interposées, entre « Not » et « Note », soit en traduction française, entre le besoin, la détresse et la composition musicale (les notes de musique). Ainsi, au moment où il composait l’immense Sonate pour piano op.106, la « révolutionnaire » Hammerklavier, il pouvait écrire à son ami Ferdinand Ries le 16 mars 1819 qu’il écrivait pour gagner son pain : « um des Brodes-willen zu schreiben ». Cette juxtaposition « Not/Note » relève du Witz et de la Witzarbeit mis en évidence par Freud, qui transposa en l’occurrence ce qu’il avait découvert avec la Traumarbeit, soit les procédés inconscients de condensation, de déplacement d’accent, de renversement en son contraire, de double sens, de légères modifications des mots ou des situations. Dans le Witz, se trouve en plus la dimension de l’instantané, du court-circuit – le sens qui n’est pas explicité, le non-dit, procède de l’effet produit par la juxtaposition fulgurante qui provoque le plus souvent le rire. En l’occurrence, que cache ce jeu de mots « Not/Note » ? Certes, qu’il faut travailler pour vivre, que le travail alimentaire est d’autant plus impérieux, plus impératif que Beethoven n’a pas de poste officiel (contrairement à son grand-père qui était maître de chapelle) … mais également que composer est de l’ordre de la survie, car il s’agit d’obtempérer à la tyrannie de son désir… de trouver une satisfaction coûte que coûte, de transformer ses symptômes physiques en œuvre. Ce jeu de mot établit donc un lien nécessaire entre pulsion (sexuelle, agressive) et création (artistique). Or la pulsion est ce que la société oblige à refouler… pas de civilisation sans refoulement préalable comme Freud le démontre dans son ouvrage Das Unbehagen in der Kultur (Malaise dans la civilisation) écrit en 1929.
Le sens de ce Witz n’en est pas pour autant épuisé ! d’accord pour « Not/Note » qui désigne l’étau pulsion/création, mais pourquoi Beethoven tient-il tant à résoudre l’énigme de la mise en musique du cri de détresse sous forme de canon proposé par Kirnberger : n’y a-t-il pas là encore déplacement d’accent de la détresse « Not » sur le « cri » (« ruf ich zu dir »), toujours en lien avec la pulsion ? Ne s’agit-il pas d’un cri énigmatique resté comme un traumatisme, inassimilable par la psyché d’un jeune enfant ? Un cri perçu comme un appel au secours, avec là encore déplacement d‘accent, car il s’agit plutôt d’un cri de jouissance (comment ne pas penser à la jouissance parentale énigmatique pour un jeune enfant) ?
Ainsi ce jeu de mots sur « Not » et « Note » mettrait en évidence un traumatisme de source auditive, lié à l’expression de la décharge d’une pulsion sexuelle sous forme de cri de jouissance : donc en lien avec la satisfaction d’une pulsion qui passe la barrière du refoulement et dont la dimension de réel serait réactualisée, percerait en se frayant un passage grâce au jeu de mots, l’aura énigmatique protégeant l’identification de ce qui est en jeu. La jouissance réelle peut donc se reproduire (et se répéter) grâce au Witz, tout en restant occultée ce qui en préserve l’insu tant pour lui que pour ses interlocuteurs.
Les autres jeux de mots de Beethoven peuvent-ils aider à cerner un traumatisme supposé ? Peut-être… d’autant plus qu’ils sont nombreux et qu’ils se retrouvent dans des sources variées : ils émaillent sa correspondance (en particulier avec ses amis Zmeskall, Gleichenstein, Tobias Haslinger, Karl Holz, et parfois avec ses éditeurs : Breitkopf & Härtel, Simrock, Steiner, Schott), émergent dans l’intitulé des nombreux canons (énigmatiques ou non), ou se glissent dans les annotations en marge de certaines partitions (« Lebe wohl » de la Sonate pour piano op.81a ; « La Malinconia », titre du dernier mouvement du sixième Quatuor de l’op.18 ; le « Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lidischen Tonart / Neue Kraft fühlend », titre du 3e mouvement du Quatuor op.132 ; le « Muss es sein ?/ Es muss sein ! », exergue du dernier mouvement du Quatuor op.135).
La mise en regard de cette tendance omniprésente au jeu de mot, au Witz, avec son refus de respecter les règles imposées par la société et en particulier par l’étiquette de la cour, n’offrirait-elle pas des perspectives de réponse à la question de la nature de ce traumatisme ? Souvenons-nous que Goethe (en été 1812, alors qu’à Teplitz Beethoven aurait refusé de s’incliner sur le passage de la famille impériale) a caractérisé Beethoven de personnalité tout à fait « ungebändigt » (indomptée, sans limites) – Freud utilise le terme de « Bändigung » pour nommer le refoulement. Et retenons ce que Beethoven a affirmé dans la rédaction d’un brouillon de réponse à un critique (en mêlant français et allemand) : « Il n’y a pas de regle qu’on d’est / peut blesser a cause de schöner – » (BKh 7, Heft 90, 8 juin-13 juillet 1825, 30r, S.315) au moment où il compose ses derniers Quatuors.
En « écoutant » et en passant en revue ce qui est dit, ce qui se joue dans les jeux de mots de Beethoven, il s’agit donc de repérer ce qui y est exprimé sans être dit explicitement, la censure étant contournée et le refoulement déjoué. Pour mener cette enquête, le recours à l’étude de Freud est indispensable : après avoir différencié des catégories de Witz (condensation, légère modification du mot, double sens, séparation des syllabes), Freud a mis en évidence le fait que tout jeu de mot servait un but de décharge sexuelle, agressive ou cynique, et que l’instantanéité, la rapidité éclair était comme un court-circuit entre des pensées antagonistes, celle réprimée réussissant à se faufiler, cryptée, dans ce qui occasionne le rire ou la sidération. L’analyse du Witz et de ses associations consiste donc à décrypter ce qui touche la personne qui le reçoit et à repérer le tiers (présent dans l’inconscient) auquel il s’adresse. Ainsi, par exemple, pour Beethoven le cri de détresse énigmatique qui retient son attention – ce qui émerge par le biais du jeu de mot « Not/Note » -, est sans doute en lien avec le père, comme pourraient le suggérer aussi bien l’appel au Père de Christus dans l’oratorio, Le Christ au mont des Oliviers : « Jehova ! Du ! Mein Vater ! » que le « Gott », ce cri plein de détresse, premier mot chanté sur un ré aigu par Florestan au début du second acte de Fidelio ; ou, autre exemple d’association autour de ce cri qui met sur la voie du père, l’invective « Abscheulicher » lancée par Leonore (n°9 de Fidelio) au moment où elle surprend les intentions meurtrières de Pizarro : la véhémence est à l’image de la haine mortifère portée par cette figure de l’agression arbitraire (figure du destin ? figure paternelle ?).
Plus directement, un exemple de jeu de mots impliquant un tiers repérable se trouve dans la formule finale qui précède la signature d’une lettre de Beethoven adressée au cours de l’été 1815 à Ludwig Freiherr von Türkheim, homme influent auquel il demandait d’aider son frère Johann qui voulait acquérir une pharmacie :
« Vergessen sie unsere alte Freundschaft nicht, und wenn Sie was für meinen Bruder thun können, ohne die österreichische Monarchie um zustoßen, so hoffe ich sie bereit zu finden. – leben sie wohl lieber Freiherr und lassen sie sich heute finden, bedenken sie, dass auch ich ein Freiherr bin, wenn auch nicht dem Nahmen nach!!!! » (BGA 816)
Par ce jeu avec le terme « Freiherr », Beethoven signifiait à son interlocuteur qu’il se situait sur le même terrain que lui, affirmant par-là même son indépendance, sa liberté, sens implicite de ce titre de noblesse qui signifie « homme libre » (frei Herr). Son titre de noblesse à lui Beethoven est donc d’être un homme libre : il revendique ainsi sa noblesse en tant qu’être humain, en séparant (sans l’écrire, mais en l’entendant) les syllabes du titre de noblesse – ce qui situe ce Witz dans la catégorie distinguée par Freud de « o na nie », signe de trouble de la personne quand on l’interroge sur la masturbation… Au temps de la Révolution, entre 1791 et 1795 donc à un moment qui se situe entre Bonn et Vienne, Beethoven a déjà affirmé sa détermination et sa fierté d’être un homme libre dans son Lied strophique et responsorial, Der freie Mann WoO 117 : ce Lied, sur un poème de Gottlieb Conrad Pfeffel (1736-1809), présente l’homme libre comme celui qui est capable d’être maître de sa vie et de sa mort, celui qui est conscient de son rôle social et qui se tient fermement à ce qu’il pense, celui qui n’obéit qu’à sa volonté et qui ne compte que sur lui-même, qui sacrifie volontairement ses passions personnelles au bonheur de la collectivité parce qu’il tient sans faillir à ses principes. Ces intentions politiques et humanistes affichées seraient-elles en quelque sorte une façade manifeste masquant un contenu latent d’une tout autre nature ? Une lutte intime pour contenir la pression du désir, pour assurer le refoulement ?
3/ Les jeux de mot révélateurs de l’archaïque, du retour du refoulé
La diversité des jeux de mots de Beethoven permet de repérer quelques éléments de son fonctionnement psychique.
En premier lieu, peut-être, la dimension sonore du jeu de mot : c’est ce qui est entendu qui prime. Les exemples sont nombreux : Not/Note ; leer/gelehrt ; Stein/Steiner ; Diabelli/Diabolus ; Streich/Streicher ; Amenda/Amende (in BGA 39)…
A cette dimension sonore se joint la dimension du rythme. L’exemple par excellence est celui du jeu avec la répétition rythmée du mot, titre nobiliaire de « Baron, Baron, etc. » dans des billets à son ami Zmeskall, billets le plus souvent non datés (BGA 35, 37, 39, vers 1798/1799), Beethoven jouant aussi avec le nom même de Zmeskall (qui en tchèque signifie traduit en allemand « versäumt », « verpasst » et traduit en français « manqué », « raté » – smetek signifiant « Herumlungener » de herumlungern : traîner, fainéanter, ainsi que « Zeitvertrödler » de « seine Zeit vertrödeln » : passer son temps dans l’inaction). Ces éléments de traduction sont indispensables pour apprécier les propos de Beethoven qui commence un billet à Zmeskall par cette formule quelque peu scatologique à charge scopique et voyeuriste :
« liebster Baron Dreckfahrer [conducteur de merde] je vous suis bien obligè pour votre faiblesse de vos yeux [en français]. (Sans doute allusion au Duo WoO 32 pour deux paires de lunettes obligées, pour viola (alto) et violoncelle, composé entre 1796 et 1797 pour lui et pour Zmeskall, qui tous deux avaient des problèmes de vue et devaient porter des lunettes).
Le billet se poursuit en allemand par des reproches faits à son ami qu’il qualifie de rabat-joie ; aussi pour échapper à la tristesse provoquée par la conversation-bavardage moralisatrice qu’il avait subie, la veille, Beethoven affirmait : « Kraft ist die Moral der Menschen, die sich von andern auszeichnen, und sie ist auch die meinige » (« La force est la morale des hommes qui se distinguent des autres, et c’est donc la mienne »), et il se disait déterminé à obliger Zmeskall à apprécier tout ce qu’il faisait. Il lui donne alors rendez-vous dans une auberge, au « cygne », mais il préférerait le « bœuf » : « zum schwanen, im Ochsen wärs mir zwar lieber », spécifie-t-il laissant le choix à Zmeskall… cette fois il s’agit d’un jeu de mot par substitution qui fait allusion à la rosserie, à la muflerie – le cygne contre le bœuf ! en toute innocence, puisque l’une et l’autre auberge étaient blanches, « Zum weissen Schwan » et « Zum weissen Ochsen ». Beethoven termine son billet par (en français) : « (réponse) adieu Baron Ba…..ron r o n nor I orn I rno I onr I
(voila quelque chose aus dem alten versatzAmt [)]. » (Versetzen signifie déplacer, transposer – c’est aussi une allusion au Mont-de-Piété, donc à un dépôt… après transit…, soit encore une allusion scatologique, portée aussi par le jeu d’inversion de la place des lettres). Cette dernière allusion signifie directement qu’il y a déplacement, passage d’un endroit à un autre : ce pourrait être la copie d’une partition (celle du Duo ?), peut-être, mais n’est-ce pas plutôt une insistance sur la bestialité de Zmeskall (conformément à l’exemple de Freud sur le « tête-à-bête »), son manque de délicatesse et de décence, son absence de refoulement… ce qui laisse supposer que la relation Beethoven / Zmeskall ne concerne pas que les questions policées (métaphorisées par le Schwan, le cygne), mais également les questions sexuelles (en-dessous de la ceinture, métaphorisé par la métonymie implicite du bœuf, Ochs). Ainsi dans ce billet le signifiant « Baron » se transforme en sonorités qui rappellent le grognement d’un cochon…, métaphore de ce qui est « cochon » (en français) … donc, sale et bestial… Ce billet de Beethoven laisse donc émerger un temps qui relève de l’archaïque (temps de la perversion polymorphe), ce temps où l’enfant aime jouer avec ses excréments autant qu’avec les sons, où il perçoit les mots d’abord comme des sons, ceux mêmes qu’il émet, qu’il reproduit, que les adultes l’incitent à imiter (quels que soient la langue, le lieu oubien l’époque ?) : « comment il fait le lion ? comment il fait l’âne ? comment elle fait la grenouille ? ».
Ce plaisir à faire ronronner le signifiant « baron » se retrouve dans un autre billet à Zmeskall (BGA 37) :
« mein liebster Baron barone, baron ! –
domanovitz
ich bitte sie, heute eine Freundschaft der andern aufzuopfern, und in den Schwanen zu kommen – sie werden dadurch sehr verbinden
ihren ExGrafen Bthwn.
baron ? baron ron aron ron – etc heil und Glück,
heil, heil, glück, etc.
baron
baron
baron
baron „
Et dans un autre billet (BGA 39), Beethoven donne la version musicale de ces grognements sur une triple croche (Ba) qui lance une blanche pointée (ron) : il donne le tempo « grave », et les trois voix : alto (sol-do/), tenore (sol-_mi), basso (sol-_do / do-do / do-doooo). Ces motifs inscrits sur des portées avec clés (ut3, ut4, fa4) sont placés en tête du billet, suit un texte qui commence par « mein wohlfeilster Baron ! », soit un qualificatif attaché au baron Zmeskall : « mon baron à très bon marché », pour lui demander qu’un « guitarist » vienne le voir, espérant que son ami Amenda s’en occupe – en citant Amenda dans ce billet à Zmeskall, Beethoven ne résiste pas à un bon mot : il associe Amanda à Amende spécifiant que son ami devrait payer une amende pour ne pas avoir respecter les silences (« für sein schlechtes pausiren »), faute de rythme ? ou soupirs mal placés ? plaintes de l’ordre du gémissement ? (la guitare pourrait être une allusion grivoise ?). Il termine son billet par (en français) « adieu mon ami à bon marché […la feuille est abimée] vieleicht sehen wir uns im schwanen. »
Ce qualificatif de « à bon marché » est un indice de sa complicité grivoise avec Zmeskall puisque Beethoven dénigre son appartenance à l’aristocratie… sous-entendu, de la vertu, et qu’il fait allusion à un tarif… (ce qui évoquerait les amours « tarifés » …).
Ainsi, avec Zmeskall (et non avec Amenda), Beethoven peut trahir et ressentir le plaisir archaïque de tout enfant, plaisir procuré par le jeu avec les mots et avec leurs sonorités ; les rythmes et les répétitions traduisant le plaisir sexuel produit par les mouvements du corps.
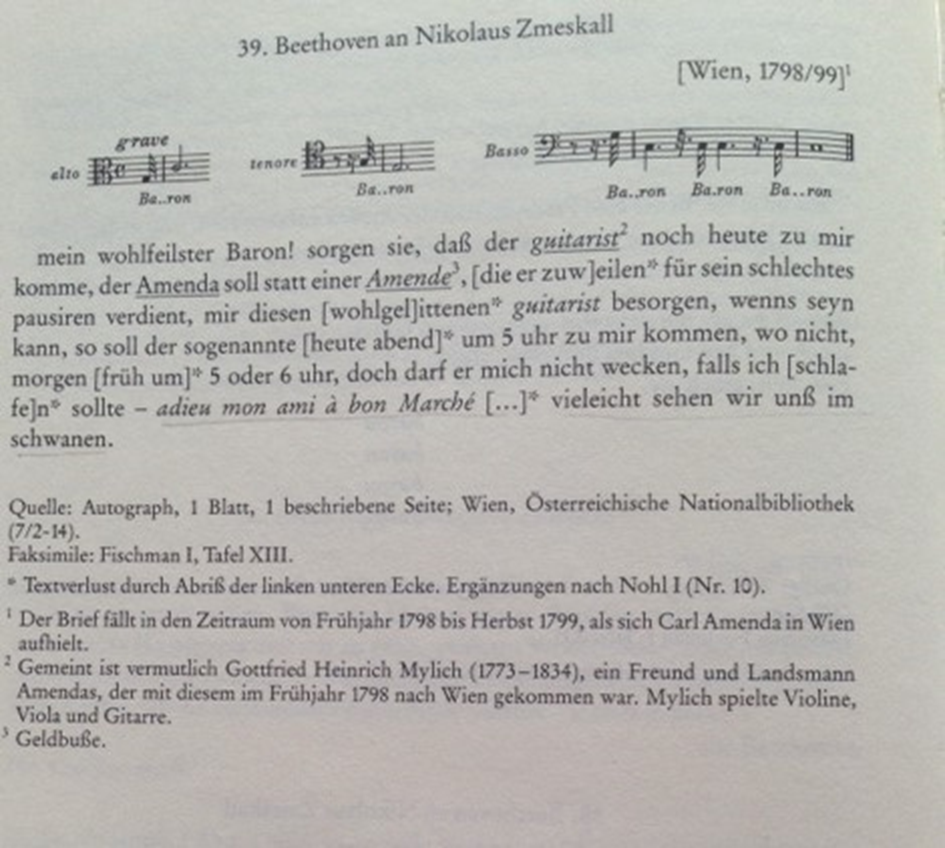
La joie éprouvée à faire des plaisanteries musicales n’est pas attachée seulement à la personne de Zmeskall : Beethoven la retrouve avec Tobias Haslinger (1787-1842), rencontré en 1813 chez Steiner avec lequel il ne cesse de plaisanter, lui envoyant souvent des canons (WoO 182, dans une lettre de septembre 1821, BGA 1439) ou des plaisanteries musicales sur son nom « Tobias » (WoO 205h, WoO 205i). Cette joie semble inhérente au tempérament de Beethoven comme l’attestent d’autres plaisanteries musicales : « Allein, allein », adagio (WoO 205b) adressée au comte Moritz von Lichnowky (dédicataire des Variations Eroïca op.35) le 21 septembre 1814 (BGA 740) ; ou « Wo ? wo ? » (WoO 205d) adressée à Nannette Streicher le 27 juillet 1817 car il était à la recherche de ses couvertures de lit…
La lettre de septembre 1821 à Tobias Haslinger dans laquelle Beethoven envoie le canon (WoO 182) est particulièrement intéressante car il y est question d’un rêve suscité par le bercement d’un voyage « en voiture (celle d’un pauvre musicien autrichien) » (« Fuhrwerk (eines armen österreichschen Musikanten) ») : le rêve qui promenait Beethoven en Orient (Syrie, Indes, Arabie, Jérusalem) l’a conduit vers les livres saints et vers Tobias, si bien qu’un canon lui est tombé dans la tête… dont il perd toutefois le fil à son réveil… ne le retrouvant qu’en reprenant le bercement de la voiture, le « Traumreise » revenant « conformément à la loi des associations d’idées » écrivait Beethoven. Cette description correspond en quelque sorte à ce que Freud a appelé le « travail du rêve », procédés de brouillage des repères utilisés par le rêve et processus de restitution de ce qui a surgi à votre insu de manière fulgurante : le bercement, la condensation, l’extension (du voyage), le déplacement d’accent, l’association d’idées, l’oubli… Dans le récit du rêve écrit à Tobias, Beethoven omettait toutefois de signaler que ce canon ne lui est pas tombé ainsi dans l’esprit comme l’atteste l’existence d’esquisses qui sont d’ailleurs contemporaines de la Sonate op.110.
Mouvements rythmés, voyage imaginaire et intérieur, accroche sur un nom qui induit des associations avec l’ange Raphaël, donc avec la confiance et la guérison comme avec l’inspiration : le récit que Beethoven fait de son rêve témoigne de son attention aux pensées qui échappent à la pleine conscience, révélées par le jeu des associations d’idées.
Cette importance du rythme inhérent au mot incitant à la création est illustrée par la Sonate op.81a en mib majeur, née du « Lebewohl », entendu, ressenti comme un rythme régulier, transcrit en un motif musical dès les deux premières mesures à 2/4 : trois noires successives conjointes descendantes sur trois accords sol/mib (tierce majeure), fa/sib (quinte), mib/sol/do (superposition d’une quinte et d’une sixte) qui doivent être jouées Adagio p espressivo. Ce motif initial sert de point de départ à l’ensemble de la Sonate.
Page de l’édition originale (Beethoven-Haus, Digitales Archiv) Sonate op.81a
Ces exemples de composition à partir d’un motif simple, canons et plaisanteries musicales, nous incitent donc à prendre en compte la dimension régressive des faits et gestes de Beethoven : bercement, sons, rêves du bon ange guérisseur…
D’autres jeux de mots confirment qu’il s’agit bien de retour du refoulé car ils évoquent tant la sexualité que l’agressivité et ils donnent la possibilité de se faufiler à des pensées qui devraient être tues, mais qui sont signifiées par et dans le court-circuit.
Ainsi « Not/Note » porte, entre autres significations, l’agressivité de Beethoven contre un père qui abandonne son fils dans la détresse, ou peut-être par retournement en son contraire la mauvaise conscience d’un fils qui abandonne son père ? Également, les jeux de mots avec le nom de son jeune ami Karl Holz (Holz = bois) : le 10 août 1825, Beethoven commence une lettre par « Bester Span ! / Bestes Holz Christi !» (« Excellent copeau ! excellent bois du Christ »), s’amusant à associer son ami à un déchet… Ou il se plaît à jouer dans des lettres à ses éditeurs sur la substitution des mots « Verleger » (éditeur), « verlegen » (le verbe = publier, l’adjectif = embarrassé, le participe passé = avarié à cause d’un magasinage trop prolongé), et « Verlegenheit » (mettre dans l’embarras) : par exemple une lettre à Steiner (BGA 1100, mars 1817) commence par „Wertheste Verlegenheiten!!!“ (« Très chers mis dans l’embarras !!!») pour demander un catalogue de ses Lieder ; ou une lettre à Peter Joseph Simrock, jeune éditeur de Bonn, fils du corniste collègue de Beethoven dans l’orchestre de Bonn (BGA 1084, 15 février 1817) comprend : « beym verlegen werden sie nie verlegen“ (« pour l’édition n’en soyez pas embarrassé »). Ce jeu de mot qui touche à l’embarras, au dérangement, au transfert, à la publication, au catalogue peut évoquer le registre scatologique… souvenons-nous que Beethoven était très fréquemment sujet à des dérangements intestinaux ; mais reconnaissons également que l’embarras connote ce qui est ressenti au moment où une personne est surprise en train de s’adonner à des gestes intimes… Et quoi de plus intime que le processus créateur ? sublimation de tous les autres gestes intimes… Mahler en fournit un exemple lui qui était furieux que quelqu’un le surprenne en train de composer, et qui refusait de montrer une composition en cours d’élaboration (sujet d’un des cinq Rückert Lieder, Blicke mir nicht in die Lieder).
D’autres jeux de mots portent délibérément un double sens tel celui de Wechsel (lettre de change) et Wechsel-Note (note de passage) qui porte l’idée de déplacement, si ce n’est d’esquive (ce qui n’est justement pas la note…). Ou cadere (tomber) lié à cadence (moment qui permet à un instrumentiste de briller) qui pointe l’idée d’échec, de déchet. Ou encore le nom du violoncelliste Linke, ami très proche de Marie Erdödy et en rivalité avec l’intendant Brauchle, porte l’indécision (gauche ou droite) et l’allusion au geste qui doit rester caché (masturbation) comme la liaison de Linke avec la comtesse…
Enfin, l’ajout d’une lettre, la modification du mot par jeu avec une lettre (selon l’exemple de « tête-à-bête »), tel Erziehung / Verziehung, qui, en l’occurrence, exprime l’idée que la bonne éducation (Erziehung) masque les pulsions sexuelles perverses polymorphes (Verziehung : mauvaise éducation, mot construit à partir de « verziehen » : faire une grimace, et « ein verzogenes Kind » : un enfant mal élevé, et mot proche de « verzeihen » : pardonner, « Verzeihung » : pardon). Ce mot « Verziehung » est donc de la même nature que l’exemple du « familionnär », jeu de mot de Heine repris par Freud comme exemple emblématique de ce qu’il voulait mettre en évidence dans son étude sur le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient. Autre exemple, Beethoven s’est amusé à contracter le nom de son ami chef d’orchestre Seyfried et le terme « friedlichkeit » (tranquillité, le mot Friede signifiant paix) dans le mot « Seyfriedlichkeit », inventé dans un billet à Tobias Haslinger (BGA 1919, Wien, Ende Dezember 1824/Anfang Januar1825[16]) : « übrigens alles Schöne an Seine Seyfriedlichkeit » – le billet dans lequel il lui demande de saluer Seyfried en lui disant plein de belles choses, commençait par « Bestes Caro oggetto amabile » : Beethoven traitait Tobias de « Meilleur cher objet aimable »… signe de familiarité grivoise partagée… ?
// Bthwn
Parfois, autre cas de figure, ce sont toutes les voyelles qui sont supprimées : ainsi dans certains cas Beethoven réduit sa signature à un simple « Bthwn ». Sur quoi ouvre cette condensation ?
La personne à laquelle la lettre est adressée peut donner un indice[17]. Il s’agit en général de personnes avec lesquelles Beethoven entretient une relation très proche, avec lesquelles il s’exprime sans contrainte, tel Zmeskall auquel il est lié par une grande complicité concernant leurs pratiques sexuelles (Zmeskall indiquait sans doute les prostituées possibles abordables sur les remparts), ou Wegeler, son mentor devenu franc-maçon, donc lié aux secrets et initiations maçonniques, ou son cher ami Amenda rencontré à Vienne, puis son ami Gleichenstein, conseiller aux affaires militaires envoyé en missions secrètes. Il faut également citer Josephine Deym, née Brunsvik : plusieurs de ses lettres dans lesquelles il parle de leur amour (secret) sont signées ainsi. Il y a aussi Marie et Paul Bigot au moment du faux-pas scandaleux de Beethoven…. Et puis, également des éditeurs : Hoffmeister (qu’il désigne comme « son frère » en art), Breitkopf & Härtel, Tobias Haslinger et Steiner avec lesquels fusaient plaisanteries et associations d’idées. Et le peintre Mähler qui, en 1804, a peint le tableau du jeune Beethoven portant une lyre dans un paysage antique. Enfin, il y a Maximiliane Brentano, jeune amie de 10 ans à laquelle il dédie en juin 1812 un Trio (WoO 39) en un mouvement pour l’encourager dans son apprentissage musical, comme il le spécifie dans sa dédicace signée : « lvBthwn » – Maximiliane était fille de Franz et d’Antonie Brentano, riches amis qui ont soutenu financièrement Beethoven en lui prêtant de l’argent ; ils avaient en outre une très grande proximité spirituelle avec lui, la musique étant un moyen d’échange émotionnel privilégié – Antonie éprouva un penchant secret pour Beethoven qui lui dédia plusieurs œuvres (les Drei Gesänge op.83, Christus am Ölberg op.85, les Sonates op.110 et op.111, les Variations Diabelli op.120, le Lied « So oder so » WoO 148). Il est assez remarquable de constater que chacun de ces destinataires a toujours un lien avec du secret…
Cette signature condensée connote certes la hâte : Beethoven n’aimait pas écrire des lettres, préférant « écrire 10000 notes » comme il le dit dans une lettre du 28 novembre 1820 à Nikolaus Simrock (BGA 1418) : « ich schreibe lieber 10000 Noten als einen Buchstaben, besonders wenn es sich um das so u. nicht so nehmen handelt. » ; mais certainement également autre chose : l’absence de voyelle renvoie à la désignation graphique de Dieu que l’on ne peut nommer, YWH, et elle évoque également la liberté d’interprétation des textes sacrés qui caractérise la pratique de la religion hébraïque.
Marc-Alain Ouaknin, rabbin et docteur en philosophie, a analysé le sens de quelques règles d’écriture fondamentales pour comprendre la lecture des livres dans la tradition juive ; entre autres, comme les voyelles ne sont pas écrites dans le texte hébreu, c’est la vocalisation de la lecture du texte liturgique qui en rend la communication possible. Pourquoi cette absence de voyelles ? A cette question, M-A Ouaknin formule cette réponse :
« L’absence de notation des voyelles permet d’échapper au poids massif de la présence du sens qui ne laisse aucun jeu à l’imaginaire. Cette absence permet d’éviter les pesanteurs du repos et l’inertie du désir… Le sens d’un mot, comme celui d’un être vivant, n’est jamais achevé, signifiance infinie où l’absence des voyelles, déroutante pour le lecteur, conjure la routine, laisse place à l’incertitude, à l’angoisse, à la curiosité. L’absence des voyelles est la source du désir qui permet au lecteur de dévoiler le secret, c’est-à-dire de dévoiler qu’il existe un secret, indévoilable. Explorer l’inconnu, sans le coloniser. Caresse et non prise ! »[18]
Cette condensation de son nom en « Bthwn » suggèrerait donc des associations avec du secret, du non-dit et avec l’ouverture à tous les possibles. Autrement dit, ce « Bthwn » pourrait être mis en relation avec le refus des barrières, donc avec ce qui ouvre l’accès à l’en-de ça du refoulement : cette association implique qu’il faisait attention à ce qui se jouait pour lui à son insu, à l’inattendu – soit, à ce qui se manifeste souvent sous la forme de l’inspiration ou qui s’exprime dans le Witz.
Comme le secret a affaire au divin, la dimension de l’élévation (Erhebung) divine serait apportée par l’association implicite entre ce « Bthwn » et « IHWH ». Ce tétragramme est indissociable de l’irradiation de la lumière divine jaillissant d’une couronne de nuages au centre de laquelle se trouve les consonnes qui constituent le nom hébraïque de Dieu, IHWH, un des éléments du décor somptueux de la Karlskirche au-dessus de son autel principal à Vienne.

Photo Paul Kujawski, Vienne 2017
Cette forme de présence divine irradiante se retrouve également dans les tablettes répandues par les Bernardins qui portent le nom de Jésus en trigramme (IHS) placé au centre d’un soleil d’or comportant douze rayons (le soleil est symbole de justice et d’illumination divine, les rayons symbolisant les 12 apôtres et les 12 articles de la foi).
Bernard de Sienne 1380-1444
Certes le nom de Dieu est imprononçable, mais son approche suscite l’émerveillement et implique des initiations secrètes : le caché est donc toujours bien présent.
Que signifie cette variété de jeux de mots ?
La variété de ces jeux de mots signifie qu’il y a, en force dans l’économie psychique, censure et refoulement : que quelque chose ne doit pas passer la barrière du tolérable, de la bienséance ? qu’il y a du secret à préserver ? Or il s’agit de quelque chose qui chez Beethoven revient sans cesse d’une manière ou d’une autre, son insistance indiquant que ça n’a pas pu être intégré dans le psychisme ? Donc, quelque chose qui a fait traumatisme, et qui en l’occurrence serait de l’ordre de l’entendu, du cri perçu comme un appel de détresse. En tout cas, quelque chose qu’il ne faut pas dévoiler… qu’il faut garder caché. Mais qui parasite sa concentration. Dès son adolescence, Beethoven était sujet à des « raptus », c’est-à-dire que son attention décrochait, qu’il se trouvait hors-circuit, happé par des pensées parasites inconscientes : en témoigne sa lettre du 29 juin 1801 (BGA 65) dans laquelle il fait l’aveu de sa surdité pour la première fois à son ami Wegeler, lui demandant, à la fin de sa lettre, de dire à leur amie commune de Bonn, Helene von Breuning, qu’il a encore parfois des «raptus » – or Beethoven venait de signaler à Wegeler que l’on mettait sur le compte de ses fréquentes distractions ce qui pour lui était le fait qu’il avait du mal à entendre – ce que justement il veut garder caché, et qu’il présente comme un « aveu » à son ami. L’aveu implique la honte : dire quelque chose d’inavouable…
L’impétuosité souvent soulignée de Beethoven avec ses proches comme avec les administrateurs de théâtre ou avec les instrumentistes – dans le récit de Neate, il ne sait pas se retenir, mais bondit, car il manque de patience – serait aussi le signe de ce court-circuit imposant le silence à ce qui veut surgir ?
4/ Quelles questions émergent de l’analyse des jeux de mots mis en regard avec d’autres sources ?
Si l’on se réfère aux analyses suggestives de Freud dans son ouvrage sur le « Witz » – Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (Witz et son rapport avec l’inconscient) -, les jeux de mots de Beethoven seraient révélateurs d’une sexualité refoulée, d’une agressivité vis-à-vis du père et d’une culpabilité inconsciente.
// La question de la sexualité
Les jeux de mots de Beethoven qui remplace « Schwan » par « Ochs », ou qui ajoute le « V » à « Erziehung » laissent supposer une sexualité refoulée (déviante ?), qu’il cache et dont il ne veut rien savoir, qu’il occulte. Et, ce qu’il écrit à son ami Wegeler laisse penser à une dissociation de sa sexualité avec la paternité : après avoir pris en charge son neveu, il signe une lettre à Wegeler dans laquelle il lui dit qu’il espère qu’il a reçu ses deux cadeaux, la gravure de son portrait (gravé par Blasius Höfel d’après un dessin de Louis Letronne, paru en 1814 chez Artaria à Vienne) et un verre de cristal de Bohême (BGA 979, 29 sept 1816) : « leb wohl du bist Mann vater ich auch doch ohne Frau » (« adieu tu es mari père moi aussi mais sans femme »).

Dessin de Letronne gravé par Blasius Höfel
L’arrivée d’un enfant chez lui s’est donc effectuée sans implication de sa propre sexualité. Comme s’il y avait eu déplacement, processus qui se retrouve dans ses relations amoureuses comme en témoigne la carte de vœux (datant sans doute de 1804/1805) envoyée à « l’espiègle comtesse » Charlotte Brunsvik, la plus jeune des sœurs Brunsvik (les autres étant Therese et Josephine), alors qu’il vivait un amour partagé mais secret avec Josephine. Cette carte montre un Cupidon muni d’une torche en train de réveiller Psyché endormie… avec de la main de Beethoven :

« Zum Neuen Jahre für die schelmische / Comtesse Charlotte Brunswick / Von / ihrem Freunde / Beethowen » – (BGA vol.1 p.242).
Cette carte de vœux quelque peu « coquine » est donc adressée à la sœur de Josephine au moment où Beethoven était en relation amoureuse avec cette dernière comme l’attestent plusieurs documents authentiques : aussi bien le Lied Andenken WoO 136 sur un poème de Friedrich von Matthisson qui commence par « Ich denke dein » envoyé à Josephine en janvier 1805, puis le Lied An die Hoffnung op.32 composé en mars 1805 et envoyé à Josephine, ainsi qu’une série de treize lettres retrouvées échangées entre lui et Josephine. Parmi ces lettres, il y a plusieurs brouillons de Josephine dont l’un rédigé au cours de l’hiver 1806-1807 (BGA 265) laisse supposer que la pression sexuelle de Beethoven ne lui convient pas. Ainsi, dans sa tentative d’explication, elle lui rappelle que sa musique l’enthousiasmait avant même de le connaître et elle poursuit :
« – Die Güte ihres Charakters. ihre Zuneigung vermehrte es – Dieser Vorzug, den Sie mir gewährten. das Vergnügen Ihres Umgangs, hätte das schönste Schmuck meines Lebens seyn können liebten Sie mich minder sinnlich – Dass ich diese Sinnliche Liebe, nicht befriedigen kann – zürnen Sie auf mich – Ich müsste heilige Bande verletzen, gäbe ich Ihrem Verlangen Gehör – Glauben Sie – dass ich, durch Erfüllung meiner Pflichten, am meisten leide – und dass gewiss, edler Bewegungsgründe meine Handlungen leiteten – „
(„La bonté de votre caractère, votre inclinaison y ajoutèrent – Ce privilège que vous m’accordiez, le plaisir de votre relation, aurait pu être le plus beau joyau de ma vie si vous m’aimiez moins sensuellement – De ce que je ne puisse satisfaire cet amour sensuel – vous m’en voulez. Je devrais porter atteinte à des liens sacrés, si je répondais à ce que vous désirez. – Soyez sûr – que je souffre au plus haut point pour accomplir mes devoirs – et que ce sont des motifs réels et nobles qui ont guidé ma conduite… »).
Josephine prend le prétexte de « liens sacrés », sans doute ses enfants, pour repousser les avances physiques de Beethoven qui ne veut pas se satisfaire d’un amour uniquement platonique, fondé sur l’estime et sur l’admiration…
Cette réaction propre à Josephine peut toutefois laisser supposer qu’il y a débordement de sensualité chez Beethoven, ce que cette dernière ressent comme un excès qu’elle déplore. Mis en regard de l’expression « père sans femme », ce débordement sensuel pourrait correspondre à l’idée proposée par Freud que pour certains, le mariage n’est pas une institution qui satisfait la sexualité de l’homme (p.122) : cette supposition est faite à propos du Witz « Eine Frau ist wie ein Regenschirm – man nimmt sich dann doch einen Komfortabel » (« Une épouse est comme un parapluie – On prend malgré tout un fiacre »), qui compare l’épouse à un parapluie, signifiant que si « on se marie pour s’assurer contre les tentations sexuelles, on s’aperçoit alors à l’usage que le mariage ne satisfait pourtant pas des besoins impérieux ; de même on prend un parapluie pour se protéger contre la pluie, et que malgré tout on se fait mouiller » (p.181, traduction Idées Gallimard), donc il est préférable de prendre une voiture plus vaste et confortable en temps de pluie…
Bien qu’aspirant à une vie conjugale – comme il l’exprime de manière sublimée, comme il le met en scène imaginairement dans l’exemple de Leonore et de Florestan -, Beethoven aurait-il eu une sexualité incompatible avec une vie de couple ?
// La question du père et la question de l’abandon (qui a abandonné qui ?)
Les jeux de mots témoignent également de l’agressivité de Beethoven contre les figures d’autorité, dont le paradigme est la figure de Pizarro, personnage auquel il a conféré un rôle chanté contrairement à la source dont il s’est inspiré, l’opéra-comique Léonore ou l’amour conjugal de P. Gaveaux sur un livret de J.-N. Bouilly datant de 1798.
Agressivité contre le père ? Beethoven était pourtant très sensible à l’harmonie familiale. Il aspirait à une entente entre les générations : son exemple favori était celui d’Ulysse (lecteur attentif des traductions d’Homère comme le montre ce qu’il a souligné dans son exemplaire, il se comparaît souvent à ce héros de l’Odyssée) retrouvant sa femme Pénélope, mais également son père Laërte et son fils Télémaque. Cependant, il faisait partie de ceux qui doutent de la part du père, de la place du père, comme l’atteste le passage qu’il a souligné dans son exemplaire de l’Odyssée, Chant 1 (aux alentours des vers 200) : le prudent Télémaque répond à Athéna qui lui trouve grande ressemblance avec son père :
« Ma mère affirme que je suis son fils ; mais, moi, comment le saurais-je ? Nul encore n’a pu vérifier en personne sa naissance. Certes, j’aimerais mieux être le fils d’un homme heureux, que la vieillesse atteint sur ses domaines ! Mais non ! Celui dont on me dit le fils, eut de tous les mortels la pire destinée. »
Odyssée, chant I
La captation de son neveu, les injonctions et les reproches qu’il ne cesse de lui adresser – Karl en est si excédé qu’il finit par faire une tentative de suicide le 6 août 1826 (pour liquider son oncle ?) -, témoignent de la violence et de la douleur, indissociables du statut de père dans l’imaginaire de Beethoven : il demande à Karl de ne « plus faire saigner son pauvre cœur » (« lass mein armes Herz nicht mehr Bluten. » lettre BGA 2075 non datée, mais située entre octobre 1825 et août 1826) … et il signe certaines de ces lettres « par malheur ton père ou plutôt celui qui n’est pas ton père » (« leider dein vater oder besser nicht dein vater », BGA 1980, 31 mai 1825) … revendiquant à d’autres moments le fait d’être son père, puisqu’il assurait la formation de son esprit et de sa personnalité – avec le désir avoué (il le formule à Karl Holz le 9 sept 1826, BGA 2197) de faire de Karl un double de lui-même : « je n’ai pas dépensé tant d’argent pour avoir mis au monde un homme ordinaire », écrivait-il le 9 juin 1825 à Karl (BGA 1988)… (« nichts so vieles mögte ich ausgewendet haben um der Welt einen gewöhnlichen Menschen gegeben zu haben“).
D’où provient le lien entre douleur et paternité ? et dans quel sens fonctionne-t-il ?
Le grand-père Ludwig (1712-1773), maître de chapelle à Bonn (à partir de 1761), semble avoir mésestimé son fils Johann (1740-1792) ; ce grand-père est mort alors que Beethoven n’avait que 3 ans : Beethoven endosse-t-il la douleur de son père privé de son propre père, tout en s’identifiant à son grand-père malheureux d’avoir un fils qu’il juge médiocre, médiocrité confirmée par les faits, puisque Johann n’a pas été choisi pour lui succéder ? La paternité n’est donc pas une sinécure ! Pourtant Beethoven s’est enorgueilli d’avoir sauvé un pauvre orphelin (ce qu’il écrit à l’archiduc Rodolphe, en février 1816) et d’être devenu père d’un charmant enfant (ce qu’il écrit à Neate, le 18 mai 1816), et il demande des conseils à ses amies Antonie Brentano (la première à laquelle il fait part de la nouvelle, le 6 février 1816) et à Marie Erdödy (le 13 mai 1816).
Dans les reproches formulés à l’encontre de son neveu, Beethoven revient souvent sur le constat que Karl ne prête pas attention à lui, qu’il ne se préoccupe pas de celui qui se pose comme son père, contrairement à lui, Beethoven, qui aurait tout fait pour soulager ses parents… Beethoven s’extrait ainsi de toute agressivité envers ses parents, mais charge Karl l’accusant d’être ingrat…. L’agressivité se joue donc entre celui qui se veut le père et celui qui ne veut pas être le fils, qui aimerait bien ne pas être le fils. Dans cette relation d’agressivité père/fils ou fils/père, il est remarquable que Beethoven occulte le signifiant « Johann » prénom de son père, quand il ne le charge pas d’une haine incontrôlable comme en témoigne l’acharnement contre Johanna la mère de Karl : Beethoven ne veut pas qu’elle élève son fils tant elle est dégénérée…, la qualifiant de Médée ou de Reine de la Nuit…
Que révèle, que reflète cette haine suscitée par le signifiant « Johann » ? Une culpabilité insupportable ? Celle d’être la cause de la mort de ses parents en ayant choisi son destin, loin d’eux, séparé ?
Quant au plus jeune frère qui se prénomme Nikolaus Johann, Beethoven le méprise : il parle de son « Caïn de frère » dans une lettre à Tobias Haslinger (« Kains Bruder », BGA 1891, 6 octobre 1824), de son « Pseudo-frère » dans une lettre à Karl (BGA 2025, 4 août 1825). Une anecdote (plus ou moins fiable !) rapporte un jeu de mots de Beethoven à propos de ce frère qui aurait signé une carte de Nouvel An « Gutbesitzer » (propriétaire foncier) et qui aurait reçu la réponse signée « Hirnbesitzer » (propriétaire d’un cerveau) ! Jeu de mot instantané par substitution de syllabe qui connote l’agressivité : Johann se pavane en étalant sa réussite matérielle, eh bien Beethoven rétorque en lui opposant sa supériorité intellectuelle, comme s’il s’agissait d’un duel ! Beethoven se sentait obligé de damner le pion à son frère ! Ce frère qui ne manquait pas de reprocher à Beethoven sa façon désordonnée de vivre : il fut d’ailleurs persuadé que si Beethoven avait eu des horaires plus réguliers, il ne serait pas mort prématurément ! (Comme le confirme son témoignage de 1827 après la mort de Beethoven, cité in Drei Begräbnisse, p.41: « Der öftere Wechsel seiner Diensleute brachte grosse Unordnung im Essen und allem Häuslichen hervor, war gewiss die Hauptursache seines öfteren Unwohlseins und gewisse Folge seines zu frühen Todtes. (…) »). Johann trouvait également que Beethoven ne savait pas qu’occuper de leur neveu…. Ce qui a poussé Beethoven à partir brusquement en novembre 1826, par mauvais temps, de chez son frère où il s’était réfugié avec Karl en attendant que ce dernier soit guéri de la blessure occasionnée par sa tentative de suicide : arrivé malade à Vienne, il ne se releva pas de sa pneumonie et mourut le 26 mars 1827.
Johann, le père, est donc méprisé : c’est un père qui fait défaut, qui abandonne – c’est la faillite d’un père. Comme le Christ au mont des Oliviers, Beethoven peut crier sa détresse : « Jehovah, du, mein Vater o sende Trost und Kraft und Stärke zu mir – sie nahet nun die Stunde meiner Leiden ». Soit, mon père pourquoi m’abandonnes-tu ? Il est à noter que Beethoven tenait particulièrement à la partition de cet Oratorio, composé en quinze jours, selon ses affirmations : la rapidité de la composition qu’il revendique fait penser à l’instantanéité d’un jeu de mots, comme si quelque chose d’essentiel s’était passée avec la composition de cet Oratorio qui met en scène l’abandon du Christ, sa détresse, et l’intervention de l’ange salvateur qui lui rappelle le sens de sa mort : sauver l’humanité. Cette intervention d’un ange accompagne Beethoven depuis ses premières œuvres : de la Cantate pour la mort de Joseph II en 1790 jusqu’à la Neuvième Symphonie en 1824, en passant par Egmont en 1810 (l’ange qui a les traits de Klärchen) et par Fidelio en 1814 (l’ange qui ressemble à Leonore) ainsi que par sa complicité amicale avec Tobias Haslinger à partir de 1813 (Tobie est guidé par un ange…) – et pourquoi ne pas évoquer l’ange qui retient le geste meurtrier d’Abraham, prêt à tuer son fils Isaac sur une injonction de Dieu ?
Signe d’un renversement dans le contraire – inversion de l’agressivité contre son père -, dans plusieurs de ses œuvres, Beethoven s’est efforcé de donner consistance à la figure du bon père, à commencer par la figure de Joseph II, celui qui, dans la Cantate, a chassé le monstre du fanatisme. Suivent Fernando, et dans une certaine mesure Rocco (qui aime sa fille et son futur gendre, et qui refuse de tuer), ainsi que la représentation de Dieu proposée par Schiller dans An die Freude : ce bon père qui veille sur les hommes (« übern Sternenzelt / Muss ein lieber Vater wohnen »). Il faut également mentionner le dieu bienveillant auquel s’adresse Beethoven dans les Gellertlieder, op.48 composés en 1802 : Six Lieder sur des poèmes de Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769), publiés à Vienne en août 1803 chez T. Mollo, dédiés au comte Johann Georg von Browne. Beethoven n’a composé que la musique de la première strophe de chacun des poèmes, sauf pour le dernier, celui de la pénitence.
N°1 „Bitten“, Feierlich und mit Andacht, C/, mi majeur – 45 mes. (4 strophes), qui s’adresse de manière solennelle à un Dieu bienveillant.
N°2 „Die Liebe des Nächsten“, Lebhaft, doch nicht zu sehr, C/, mi bémol majeur – 29 mes. (14 strophes), l’amour du prochain.
N°3 „Vom Tode“, Mäβig und eher langsam als geschwind, ¾, fa dièse mineur – 49 mes. (7 strophes), de la mort.
N°4 „Die Ehre Gottes aus der Natur“, Majestätisch und erhaben, C/, ut majeur – 42 mes. (6 strophes), la gloire de Dieu chantée par la nature.
N°5 „Gottes Macht und Vorsehung“, Mit Kraft und Feuer, C/, ut majeur – 18 mes. (15 strophes), la puissance de Dieu et la Providence.
N°6 „Buβlied“, Poco adagio, ¾, la mineur / Allegro ma non troppo, ¾, la majeur – 113 mes. (durchkomponiert). « Chant de pénitence », ce Lied (qui ne fut pas toujours pensé par Beethoven comme une conclusion de l’ensemble) est de structure plus complexe que les cinq autres : il couvre les six strophes du poème, ce qui représente 113 mesures, et est constitué de deux parties contrastées, la première Poco adagio, à 3/4 en la mineur pour les trois premières strophes, et la seconde partie, « attaca subito », Allegro ma non troppo, toujours à 3/4 mais en la majeur pour les trois dernières strophes, chacune des strophes étant différenciée par la musique qui, de bout en bout, est plus proche de l’air accompagné que du style déclamatoire – le tempo est indiqué de façon courante à l’époque de Beethoven, et non plus de manière « ancienne ».
La première partie concerne l’aveu de ses péchés par le pénitent, qui ose se présenter à Dieu pour l’implorer, le style est fidèle à la tradition rhétorique de la musique qui « figure » le sens des mots du texte, les dissonances soulignant, par exemple, les termes qui connotent la souffrance intérieure : « Jammer », « Seufzen », « Sünden », « meiner Schuld ».
La seconde partie, plus rapide et majeure, s’appuie sur une référence implicite à la musique du « Recordare » du Requiem de Mozart, et donc au « Dies irae » (dont les strophes 9 à 15 ont été utilisées par Mozart). La musique pour chacune des trois strophes est une variation du thème énoncé par le piano seul, sorte de double sujet de fugue, le sujet le plus proche de la déclamation étant repris par la voix pour les trois strophes, tandis que la densité sonore de la partie de piano s’amplifie et s’intensifie pour manifester la confiance du pénitent qui sait que Dieu est miséricordieux et aime à se réjouir (« Du bist ein Gott, der gern erfreut. »). La fin exulte sur le répétition des derniers vers, « Er hört mein Schrein, der Herr erhört mein Flehen und nimmt sich meiner Seelen an. » (« Il entend mon cri, le Seigneur entend ma supplication et il se charge de mon âme. »).
Pour ce Lied de pénitence (il s’agit de la prière du pécheur, qui se repend et qui espère le pardon divin), Beethoven a donc eu recours à une forme en deux parties différenciées par le tempo et le mode, ainsi qu’au principe de la variation (principe qui caractérise plutôt la musique instrumentale), geste de transgression par rapport au style traditionnel de la musique d’église. Or cet écart, ce transfert du profane dans le religieux, sert à donner un caractère personnel à cette prière dont le but est de demander à Dieu de lui pardonner ses péchés.
Un autre indice de ce rapport ambivalent au père est la mention, certes formule convenue de « Von meinem Theuren Vater geschrieben », que Beethoven a tenue à écrire sur la partition de CPE Bach recopiée par son père : l’oratorio Morgengesang sur un poème de Klopstock qui a sans doute été un morceau de parade de Johann, ténor. Pourtant Beethoven n’hésita pas à occulter la mention du père dans la citation des vers de Don Carlos (II, 2 – 1050) de Schiller inscrits le 22 mai 1793 sur l’album de Theodora Johanna Vocke : « Ich bin nicht schlimm [mein Vater], heisses Blut » (« Je ne suis pas mauvais, un sang chaud »).
// La question de la vertu
Dans la mesure où, selon Freud, les jeux de mots, le goût pour le Witz, révèlent une constitution psychique portée à l’exhibition de ses capacités, comment entendre les nombreuses protestations de Beethoven toujours enclin à mettre en avant sa « vertu » (« Tugend »). Certes, il s’agit d’une notion « antique » qui implique la force de caractère, mais l’association qu’il fait toujours avec l’enfance doit éveiller notre attention : ne s’agirait-il pas implicitement de refoulement de la perversion polymorphe de l’enfant ? et justement pour lui de la difficulté inconsciente de ce refoulement ?
Ainsi, dans le « Testament » rédigé en octobre 1802, dès la troisième phrase, Beethoven dénonce les mauvais jugements de ceux qui le qualifient de « Feindseelig störisch oder Misantropisch » (« Haineux entêté ou Misanthropique »), ignorant « die geheime ursache von dem » (« la raison secrète de cela »), en rappelant que « mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens, selbst grosse Handlungen zu verrichten dazu war ich immer aufgelegt“ (« mon cœur et ma sensibilité ont été depuis mon enfance mis au service du tendre sentiment de la bienveillance, toujours disposé à accomplir moi-même de grandes actions »). Puis après avoir parlé de la surdité irrémédiable qui l’atteint et de sa décision, face à cette injustice de la nature, de faire tout ce qu’il peut « pour accéder au rang des artistes et des hommes de valeur » (« um die Reihe würdiger Künstler und Menschen aufgenommen zu werden »), il conseille à ses frères d’enseigner la vertu à leurs enfants, car elle seule peut rendre heureux, pas l’argent, spécifiant que son conseil repose sur son expérience : la vertu lui a permis de sortir de la pauvreté, et il ajoute que c’est grâce à elle et à son art qu’il a renoncé au suicide (« emphelt euren Kindern Tugend, sie nur allein kann glücklich machen, nicht Geld, ich spreche aus Erfahrung, sie war es, die mich selbst im Elende gehoben, ihr danke ich nebst meiner Kunst, dass ich durch keinen selbstmord mein Leben endigte – lebt wohl und liebt euch (…)“).
Il affirme donc que les deux piliers de sa vie sont la vertu et l’art (ne peut-on pas entendre un déplacement de Not / Note ? soit de pulsion érotique et de création ? de Wunde et de Wunder dans la version d’Alban Berg ?). Il le revendique à nouveau dans la lettre d’excuses qu’il écrit à la pianiste Marie Bigot et à son mari (BGA 273, 6 mars 1807), après avoir fait le faux-pas considéré comme scandaleux d’avoir proposé à Marie (sans son mari) une promenade en calèche en ce début de printemps (la calèche protège mieux de la pluie, selon le Witz analysé par Freud !). Soutenant qu’il ne s’agit que d’amitié, „reinsten unschuldigsten Gefühle“, et qu’il a comme principe de ne pas désirer la femme d’un autre (ce qu’il souligne sur le papier), il rappelle qu’il a été très mal élevé (« dass ich zuweilen sehr ungezogen bin ») et qu’avec ses amis il se comporte avec naturel sans contrainte….
« Wie kann die gute Marie meinen Handlungen so eine Böse Wendung geben ? “, demande-t-il : « Comment la bonne Marie a-t-elle pu faire de telles suppositions ? » … Il insiste beaucoup sur le beau temps de début de printemps (se trahissant de ce fait car c’est un moment propice aux amours ?), et il s’offusque qu’ils le soupçonnent de « ça » (« dass ich wohl recht hatte, auch ohne an das zu denken, was sie sich dabey dachten »). Il poursuit sa longue lettre en insistant sur ce qu’il a appris dès son enfance : aimer la vertu, aussi leur mise en doute l’a énormément blessé :
“ lieber Bigot liebe Marie nie, nie werden sie mich unedel finden, von Kindheit an lernte ich die Tugend lieben – und alles was schön und gut ist – sie haben meinem Herzen sehr wehe gethan – (…).”
lettre à Bigot de Morogues
Ne pas convoiter la femme d’autrui, mais refouler ses pulsions sexuelles, les sublimer dans l’amitié et dans l’art qui associe éthique et esthétique. On est bien dans « Not » et « Note », pulsion et création… Cette association du beau et du bien relève même de l’impératif catégorique pour Beethoven, lui si sensible à Kant comme en témoigne cette phrase recopiée sur un cahier de conversation :
« Das moralische Gesetz in unss und der gestirnte Himmel über unss, Kant !!! » (in BKh 1. S.235, 22 janvier – 23 février 1820).
Le beau et le bien sont au cœur de l’Opferlied (1788), poème de Friedrich von Matthisson (1761-1831) op.121b (1822) pour lequel Beethoven a composé quatre versions (les trois premières entre 1794 et 1801), et de Andenken WoO 126 (1794-1795, retravaillé en 1798). Et c’est également le sujet de deux canons sur le dernier vers de cet Opferlied : le canon « Das Schöne zum Guten » WoO 202, inscrit le 27 septembre 1823 pour la pianiste Marie Pachler à l’issue de sa visite ; puis le canon WoO 203 “Das Schönste zu dem Guten” inscrit dans une lettre datée du 3 mai 1825 (BGA 1963) adressée à l’écrivain Rellstab qui de passage à Vienne lui avait rendu visite « nehmen Sie vorlieb mit diesem geringen Erinnerungszeichen an Ihren Freund Beethoven. »
Julia Ronge dans sa présentation des exercices musicaux de Beethoven signale que sur la dernière page d’un cahier d’extraits de basse fondamentale, il a inscrit :
« … ich hatte von Kindheit an ein solches Zartes Gefühl, dass ich es ausübte, ohne zu wissen, dass es so seyn müsse oder anders seyn könne ».
Donc il s‘agit encore du « zartes Gefühl » qu’il possède depuis son enfance qui lui permet de donner l’interprétation juste d’un morceau sans se poser de questions : cette vision idéalisée qu’il confère à son enfance ne serait-elle pas l’indice d’une conversion en son contraire. Gottfried Fischer dans ses souvenirs (certes bien tardifs ! rédigés au brouillon entre 1837 et 1857) fait allusion à un méfait inavouable…. (énurésie ou masturbation surprise en acte ?) qui aurait donc accablé le jeune Beethoven de honte, sans pour autant lui enlever le besoin de ruer dans les brancards, de refuser les règles, au nom de l’imagination… si l’on en croit ce qu’il aurait dit à Karl Holz : « Eine Fuge zu machen ist keine Kunst, ich habe deren zu Dutzenden in meiner Studienzeit gemacht. Aber die Phantasie will auch ihr Recht behaupten… »
Il déprécie les règles artisanales, qui ne conduisent qu’à des squelettes musicaux, et fait croire que dès l’enfance il était apte aux combinaisons du contrepoint, indice de ce besoin de montrer ses capacités hors du commun… Pourtant il aime bien souligner qu’il faut beaucoup travailler, beaucoup apprendre : aucun traité n’est trop savant pour lui comme il l’écrit dans une lettre à Breitkopf & Härtel, le 22 novembre 1809 (BGA 408) :
« Es gibt keine Abhandlung die sobald zu gelehrt für mich wäre, ohne auch im mindesten Anspruch auf eigentliche Gelehrsamkeit zu machen, habe ich mich doch bestrebt von Kindheit an, den Sinn der bessern und weisen jedes Zeitalters zu fassen, schande für einen Künstler, der es nicht für schuldigkeit hält, es hierin wenigstens so weit zu bringen – »
Les lectures, d’ouvrages littéraires ou théoriques, comme celles de partitions, l’incitent souvent à en recopier les passages qu’il veut méditer, car pour la musique copier c’est apprendre, intégrer une « Fachsprache » (langage technique) ; et noter les idées, entre autres les idées musicales qui lui passent par la tête, lui paraît une activité essentielle pour ne pas les oublier, pour les assimiler, et les travailler.
Recopier est donc un moyen privilégié de « Bildung », cet accroissement de l’être qu’il n’oppose jamais à l’inspiration, mais qu’il pose au contraire comme une exigence. Dans ce contexte dominé par l’effort intellectuel, comment interpréter son refus des règles, ce comportement indompté qui a frappé Goethe au point de qualifier Beethoven de personnalité « ungebändigt » ? En fait, comme la culture consiste justement dans l’intégration des règles – la civilisation commence avec le refoulement -, l’obsession de Beethoven pour la Bildung n’est-elle pas l’indice, par effet de renversement dans le contraire, de son malaise vis-à-vis des contraintes. Supposition appuyée par la fatigue stérilisante qu’il ressent après avoir donné une leçon à l’archiduc Rodolphe dans le contexte de l’étiquette de la cour : n’est-ce pas un autre indice de sa difficulté à refouler ses pulsions primaires ? ça lui coûte énormément, au point qu’il perd toute inspiration, qu’il ne peut plus travailler pendant plusieurs jours, ou qu’il tombe malade pour ne pas avoir à affronter cette atmosphère de contrainte… dans tous les cas, sa force de travail en est affectée.
L’insistance sur la vertu serait révélatrice de son économie psychique dominée par la pression de pulsions rétives à être contenues, et se manifestant dans de nombreux symptômes physiques avant de trouver leur sublimation dans la composition musicale.
III/ Variations, voie royale
En quoi l’analyse des séries de variations pour piano, et pour piano et un autre instrument (violon, flûte ou violoncelle) serait-elle une voie royale pour accéder à l’insu de Beethoven ? pour déchiffrer sa partition intérieure ?
Pour déchiffrer la partition intérieure de Beethoven, une attention particulière s’impose aux nombreuses œuvres constituées de variations sur un thème étant donné la nature de ce genre musical.
En quoi la variation peut-elle servir notre enquête ?
La variation représente l’essence même de l’écriture musicale, du déploiement de la musique dans le temps. Le paradigme en est l’alléluia et ses vocalises jubilatoires qui s’élèvent sans limites, au-delà de tout temps mesuré, ce jubilus tant prisé par Saint Augustin, aux sources mêmes du développement de la musique occidentale.
Au moment où Beethoven, né en 1770, commence à composer, la variation comme genre purement instrumental a reçu depuis peu ses lettres de noblesse avec J.-S. Bach et les Variations Goldberg publiées en 1741 à Nuremberg, constituées de 30 variations d’une Aria qui encadre l’ensemble.
Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, écrire des œuvres consistant à présenter un thème et les variations qui peuvent en découler, est devenu un genre à part entière (identifié comme tel en 1793 par Heinrich Christoph Koch, 1749-1816, dans Versuch einer Anleitung zur Composition), illustré entre autres par CPE Bach, Mozart, Haydn, Neefe le maître de Beethoven …. Ce genre fait donc partie de l’héritage musical de Beethoven comme l’atteste sa première œuvre publiée en 1782 à Mannheim, donc au cours de sa douzième année : un ensemble de Neuf Variations pour le clavecin sur une Marche de Dressler (WoO 63), un chanteur contemporain, auteur d’ouvrages sur la musique et sur le théâtre.
Cette démarche qui consiste à partir d’un thème, musicalement très construit (carrure, harmonie, rythmes, nombre de mesures), pour lui donner des configurations insoupçonnées sans sortir du cadre métrique et harmonique initial fait donc partie intégrante de la « seconde nature » de Beethoven, un acquis si fortement intégré qu’il est devenu révélateur de ce qu’il ne contrôle pas délibérément, de ce qui lui échappe au point de devenir lieu et moyen d’expression de ses pulsions. Ainsi, comme pour tout créateur, une partie du travail d’imagination de Beethoven s’est déployée, en l’occurrence, dans un cadre rigoureux, condition nécessaire pour permettre aux pulsions de se dire sans se dévoiler (une façon de forcer le refoulement de manière déguisée, en conservant de surcroît la dimension de la répétition) : les représentants des pulsions ont ainsi la possibilité de se faufiler en empruntant ce cadre qui peut être considéré comme l’équivalent du récit manifeste d’un rêve ou celui de la situation instantanée du Witz ; les configurations dans lesquelles ces représentants des pulsions se coulent résultent d’un travail psychique inconscient spécifique, comme nous l’avons déjà souligné, combinaison de condensation ou d’amplification des événements, de déplacement d’accent, de retournement d’un élément en son contraire, à l’instar du travail du rêve mis en évidence par Freud en 1900 dans son ouvrage intitulé Traumdeutung (soit « ce que signifient les rêves » et non « l’interprétation »).
/ Les détails à ne pas négliger
1./ Dans cette investigation des Variations en tant que voie royale pour déchiffrer la partition intérieure de Beethoven, un détail est à prendre en compte : à quelques exceptions certes significatives, les séries de Variations sur un thème donné (une vingtaine) ne comportent pas de numéro d’opus (Beethoven le signale lui-même à son éditeur en 1802 au moment de la publication des Variations op.35 auxquelles il tient à attribuer un numéro d’opus). Pourtant ces premières séries de Variations ont été publiées du vivant de Beethoven (rarement sans son accord, saut les Huit Variations à quatre mains – WoO 67 – sur un thème du comte Waldstein publiées par Simrock à Bonn en été 1794) dans la foulée de leur composition en général. Cette exclusion de l’ensemble des œuvres avec numéro d’opus semblerait signaler que Beethoven ne leur ait pas attaché une grande valeur : œuvres de circonstance elles relèveraient en quelque sorte du rebut ou, au moins, elles auraient été considérées comme de simples œuvres alimentaires, moyens de subsistance certes (relevant donc de ce qu’il appelait le Brotarbeit), mais également moyens de se faire connaître. Ainsi, à plusieurs reprises lors des premières publications à Vienne, le numéro d’opus conféré à des Variations a été transféré à des œuvres qui paraissaient à Beethoven plus dignes de lui, plus emblématiques de sa façon personnelle de composer, d’un genre plus noble. Ce fut le cas du WoO 40, soit des XII Variations pour clavecin ou piano-forte et violon sur le thème de la Cavatine « Se vuol ballare » de Figaro publiées en juillet 1793 par Artaria à Vienne, qui ont perdu le statut d’ « Œuvre I. » au profit des trois Trios pour piano, violon et violoncelle publiés en été 1795 par Artaria comme « Œuvre 1er ». Ce fut également le cas du WoO 69, soit des Neuf Variations pour piano sur « Quant’ è più bello » de La Molinara de Paisiello publiées en décembre 1795 par Traeg comme « Op. II. », puis comme N°2 quand le statut d’ « Œuvre II » est donné aux trois Sonates pour piano dédiées à Haydn publiées en mars 1796 par Artaria.
Que Beethoven ait considéré la composition de Variations comme un travail d’ordre alimentaire serait attesté par la composition, commanditée en 1817-1818 par le britannique Thomson, des Variations pour piano, flûte ou violon, sur des chants populaires, les Six de l’op.105, parues à Vienne, chez Artaria en septembre 1819, puis les Dix de l’op.107 parues à Bonn chez Simrock en août/septembre 1820. En fait, même si pour Beethoven répondre à cette commande était un moyen de trouver de quoi vivre pendant qu’il composait la gigantesque Sonate pour piano op.106, les raisons matérielles n’ont pas seules présidé à ce travail d’élaboration : il a accepté également parce que les chants populaires l’intéressaient (il en a harmonisé une grande quantité, certes sur l’injonction de Thomson), y voyant la possibilité de mettre à l’épreuve ses procédés d’écriture dans un genre libre et de s’interroger sur les façons de passer du chant à la musique instrumentale.
Ce travail d’écriture variée à partir d’un thème connu de tous entrait aussi dans ses préoccupations « didactiques » actualisée par la publication, qu’il souhaitait tant, de ses œuvres complètes : Beethoven aurait parlé de « Stückarbeit » (c’est-à-dire de modèle de composition) permettant d’aborder la catégorie du « naïf » (dans le sens de Schiller[19]), puisqu’il s’agissait de partir de thèmes simples (et connus) et de trouver des élaborations toujours renouvelées. Comme si Beethoven avait cherché à démontrer que le simple pouvait être source de grande inventivité, que les Kleinigkeiten[20] contenaient tout autant de musique que les grandes œuvres.
Ainsi, même publiées sans numéro d’opus pour la plupart, les séries de Variations ont une place de choix dans la production comme dans le processus créateur de Beethoven : inscrites sous le signe du travail alimentaire, elles sont en réalité des moyens d’investigation des richesses expressives inhérentes à l’écriture, soit au fait d’inventer, d’associer, d’être surpris, sans contrainte, sans intimidation liée à la forme « noble » de la Sonate. Elles sont donc le reflet d’une intense activité psychique dont elles révèlent les orientations comme les mécanismes propres à Beethoven.
2./ Autre détail de poids,
ces séries de Variations sans numéro d’opus ont été composées pour la plupart (à part les WoO 77 de l’été 1800, les Six Variations faciles sur un thème original, et les WoO 78 et 79 de l’été 1803 sur le « God save the King » et sur le « Rule Britannia ») en un temps où Beethoven n’était pas accablé par le drame de sa surdité irrémédiable : il n’avait alors rien à cacher, et il pouvait se livrer au plaisir pur de la composition, tout en visant à consolider son intégration dans la vie musicale viennoise en en adoptant les pratiques et les modes. Les Variations composées avant 1800 témoignent donc d’abord d’un trait de caractère bien affirmé chez Beethoven : son désir de se montrer et de séduire (comme nous l’avons vu dans la deuxième partie de cette enquête, une des dispositions psychiques propre à celui qui aime les jeux de mots et les Witze).
Puis avec la surdité, dans un contexte d’une solide intégration dans la vie musicale (Beethoven sait négocier avec les éditeurs pour obtenir des prix supérieurs aux autres compositeurs, il obtient des concerts publics et privés, il reçoit parfois des commandes), ce genre thème et variations se fait plus rare en tant qu’œuvre à part entière (mais varier est très souvent mis en pratique comme principe d’écriture d’un mouvement dans une œuvre instrumentale de plusieurs mouvements). Beethoven n’en compose que six ensembles, dont cinq sur des thèmes originaux : en 1800, les Variations très faciles sans doute « didactiques » WoO 77 (éditées en décembre 1800), puis en 1802 les Six Variations op.34 et les Quinze Variations op.35 sur des thèmes de la musique du ballet Les Créatures de Prométhée créé en 1801 (éditées en 1803) ; en 1806 les 32 Variations (WoO 80) sur un thème original de chacone (éditées en 1807 sans mention de dédicataire) ; en 1809/1810 les Six Variations burlesques pleines d’humour de l’op.76 (éditées en 1810) ; et enfin les 33 Veränderungen (Métamorphoses plus que Variations) op.120, composées sur un thème proposé par Diabelli, entre 1819 et 1823 (publiées en juin 1823).
/ « Wirklich ganz neue Manier »
Dans les nouvelles séries de Variations dérivées du thème de Prométhée, le but de Beethoven a été délibéré : démontrer ses capacités d’imagination, comme il cherche à l’expliquer à son éditeur au moment de la publication des Variations op. 34 et 35, insistant sur la « wirklich ganz neue Manier »[21] de composer qui l’incite à leur conférer un numéro d’opus – ce qu’il l’écrit spécifiquement le « 18 décembre (ou à peu près) » 1802 (BGA 123), dans une lettre qui accompagne l’envoi de ses manuscrits, priant l’éditeur d’insérer une note préliminaire qui souligne la nouveauté des variations, pour l’op.34 (« les plus petites ») comme pour l’op.35 (« les plus grandes »), qu’il voulait voir intégrer à ses œuvres désignées par un numéro d’opus car le titre était de lui. Malgré l’insistance de Beethoven, l’éditeur ne publia pas cette note préliminaire, ce « Vorbericht » (« Avertissement ») : il avait pourtant eu bien du mal à trouver la formulation qui lui paraissait correcte, la page de titre du manuscrit autographe de l’op.35 montre que les premières lignes ont été raturées et réécrites :
Page de titre : Ludwig van Beethoven, Variationen mit einer Fuge (Es-Dur) für Klavier op. 35, Autograph / Beethoven-Haus Bonn, Sammlung H. C. Bodmer, HCB Mh 6
Les ratures du brouillon autographe conservé témoignent donc de la difficulté qu’il a eue pour expliciter sa démarche, pourtant il tenait absolument à ce que l’éditeur inscrive un texte en tête de la publication : considérant finalement qu’à chacun son métier, il laissa à l’éditeur la responsabilité de la rédaction correcte du texte… ce que l’éditeur éluda … alors que la formule d’un texte possible était proposée dans sa lettre du 18 décembre 1802 (BGA 123), laissant toutefois le soin à l’éditeur d’en parfaire le style.
« – hier der Vorbericht selbst:
« da diese V. sich merklich von meinen frühern unterscheiden, so habe ich sie, anstatt wie die Vorhergehenden nur mit einer Nummer (nemlich z.B.: N° 1, 2, 3, u.s.w.) anzuzeigen, unter die Wirkliche Zahl meiner gröβern Musikalischen Werke aufgenommen, um so mehr, da auch die Themas von mir selbst sind.“
Der Verfasser“.
Près d’une vingtaine d’année plus tard, la réaction de Beethoven à la proposition de Diabelli est très significative des enjeux que représente la composition de Variations pour lui. Au début de l’année 1819, l’éditeur et compositeur Diabelli invitait chacun des compositeurs viennois à imaginer une Variation sur un thème de valse de son cru pour dresser une sorte de panorama de la vie musicale viennoise. On ne sait pas quand Beethoven a reçu cette proposition, mais il semble qu’il ait envisagé très tôt de composer non une variation comme tout un chacun, mais tout un cycle (comme sa correspondance et ses esquisses en témoignent – avant de commencer la Missa solemnis en mars-avril 1819), signe de sa volonté de se singulariser : les cahiers d’esquisses montrent l’avancée rapide de sa composition, puisqu’en juillet 1819, 23 variations étaient esquissées. Cette frénésie créatrice fut interrompue par le travail sur d’autres grandes œuvres : la Missa solemnis donc, mais également ses dernières Sonates pour piano op.109, 110 et 111 et l’Ouverture « Der Weihe des Hauses » op.124. N’ayant pas abandonné l’idée de parfaire ce cycle de « Grosse Veränderungen über einen bekannten Deutschen » comme il l’annonçait le 10 février 1820 à Nikolaus Simrock éditeur à Bonn (BGA 1365), il ne se remit au travail qu’à la fin de l’année 1822 pour terminer au printemps 1823. Les 33 Veränderungen sont alors publiées en un volume en juin 1823, avant le volume qui rassemblait les versions des cinquante autres compositeurs sous le titre de « Vaterländischer Künstlerverein Veränderungen », publié en juillet 1824 (Czerny avait pourtant été le premier à envoyer sa Variation, à la date du 7 mai 1819).
Ainsi, à partir d’un thème qu’il considérait comme très banal, Beethoven a donc créé une œuvre inouïe, monumentale, qui condense son univers musical, éclaire ses démarches de compositeur et met en évidence ses façons de procéder.
/ Les enjeux du genre thème et variations
Vu les traits spécifiques de ce genre pour Beethoven, l’interroger semble donc pertinent pour plusieurs raisons.
1/- Variation, métaphore, métonymie et métamorphose
En premier lieu, la composition chère à Beethoven pour le genre thème et variations révèle un goût accentué pour la métaphore et pour la métonymie, ces figures de style aux origines mêmes de la pensée, comme l’atteste son choix de thèmes provenant de Die Zauberflöte (La Flûte enchantée) ou des Nozze di Figaro ou de Don Giovanni, ou encore d’un oratorio de Haendel ou de la romance du Richard Cœur de Lion de Grétry.
La variation révèle également le goût de Beethoven pour la métamorphose d’une chose en une autre, ce que manifeste son plaisir à sauter d’une idée à une autre, par exemple à passer de la valse de Diabelli au premier air de Don Giovanni, celui de Leporello qui se plaint de son maître, Variation Diabelli XXII « alla ‘Notte e giorno faticar’ di Mozart » ; comme son plaisir à jouer avec les mots, attesté par le remplacement de Variationen par Veränderungen. Ces types de dispositions psychiques poussent le sujet à procéder à l’instar du travail du rêve en combinant condensation, amplification, multiplication, retournement, déplacement d’accent : autant de procédés mis en jeu par Beethoven pour déployer une variété de solutions, c’est-à-dire pour imaginer les variations possibles d’un thème banal.
Et au fur et à mesure de son investissement créatif dans la composition de Variations, Beethoven prend ses distances par rapport à la technique d’écriture consistant en une simple ornementation de la mélodie initiale, pour privilégier un détail du thème (un intervalle, une appogiature, une suspension harmonique, etc.) ce qui correspond à une démarche métonymique, ou à une démarche qui cherche à faire allusion à d’autres scènes ce qui met sur la voie de la métaphore (un rythme de danse, une chacone, une marche, un tempo). Si le paradigme en est cette Variation XXII qui reprend le thème qui marque le début de Don Giovanni, les exemples sont multiples et ouverts à la mémoire musicale de tout auditeur, tant Beethoven s’inscrit dans un héritage tout en revendiquant sa liberté de faire feu de tout bois, d’être indompté « ungebändigt » (Freud parle de Bändigung des Triebes pour parler du refoulement d’une pulsion).
De même une carrure harmonique peut être à l’origine de multiples associations d’idées, comme Beethoven le met en scène dans les Variations op.35 en commençant par exposer les composantes de l’harmonie du thème, en plusieurs étapes : « Introduzione col Basso del Thema », il part de la basse, puis passe par « a due », « a tre » et « a quattro », avant de laisser le thème s’épanouir dans ce cadre harmonique. Cette façon d’exposer le thème – d’après une « wirklich ganz neue Manier » – prélude à 15 configurations différentes, suivies d’une fugue, dont l’écriture rigoureuse contrapuntique représente une échappée de rigueur dans le cadre bien établi du genre thème et variations : par cette juxtaposition / imbrication explosive Beethoven pulvérise le genre dont il a hérité. Et cela en s’appropriant son propre thème de l’apothéose de Prométhée, celui qui a osé dérober le feu aux dieux pour façonner une humanité d’êtres sensibles. Beethoven connaissait l’Ode écrite par Goethe en 1774 (publiée d’abord en 1785, puis en 1789 dans le huitième volume de ses œuvres complètes) : cette Ode est une explosion lyrique d’une très grande concentration expressive, dans laquelle Goethe met l’accent sur le défi de Prométhée à Zeus, sur son refus définitif de vivre soumis à sa puissance, prenant conscience que le pouvoir conféré aux dieux n’est que la manifestation de la faiblesse de ceux qui les honorent. Et c’est avec violence que Prométhée exprime sa volonté de créer une humanité nouvelle composée d’hommes faits à son image :
« Me voici, façonnant des hommes, / Selon ma propre image,/ Race qui me sera pareille,/ Pour souffrir et pleurer,/ Pour jouir de la vie et en tirer sa joie,/ Et ne t’accorder nul regard,/ Ainsi que moi! »[22]
Goethe Prometheus, dernière strophe
Ce poème consiste à remplacer « Zeus », mot qui termine le premier vers (« Bedecke deinen Himmel, Zeus« ), par « Ich« , mot qui termine l’ensemble du poème – Prométhée-Goethe s’autorisait donc à occuper la place de dieu, en connaissance de cause : une vie séparée, solitaire, sans recours à l’illusion d’un dieu tutélaire et consolateur, mais en acceptant les principes éternels du Temps et du Destin: « N’ont-ils pas forgé l’Homme en moi,/ Le Destin éternel/ Et le Temps tout-puissant,/ Mes maîtres et les tiens? »[23]
La divine étincelle de Prométhée, cette métaphore de la création moderne diffusée par Winckelmann en 1750, n’était pas inconnue d’un Beethoven qui lui-même se caractérisait comme doté d’un tempérament de feu, ce qu’atteste une lettre à Karl Holz de novembre 1825 (BGA 2097) : je n’ai rien d’un tempérament flegmatique (« denn kein Pflegmaticus bin ich ja »), mais je suis d’accord avec ce que vous dites : j’agis avec trop de fougue (« aber sagt ihr, ich handle zu feurig, freylich »).
2/- Orgueil et vanité
Outre ce feu intérieur qui, en digne émule de Prométhée, pousse Beethoven à créer, à penser par sa façon d’écrire et de composer, le genre thème et variations révèle bien d’autres aspects de sa personnalité – aspects qui procèdent de représentants de pulsions difficiles à réprimer.
Tout particulièrement le besoin de briller, d’être le meilleur, d’être rassuré sur la haute idée qu’il a de lui-même.
Outre la virtuosité exigée dans pratiquement toutes les séries de Variations (à l’exception de celles qui sont spécifiées « faciles », le WoO 64 Sechs leichte Variationen sur un air suisse de 1790 ou 1792, ou le WoO 77 „très facile“,Sechs leichte Variationen für Klavier über ein eigenes Thema, de l’été 1800), le choix du thème des XII Variations pour piano et violoncelle, composées en 1796 (WoO 45) atteste cette haute idée que Beethoven a de lui-même.
Alors qu’il séjourne à Berlin (lors de son unique tournée de concerts en pays germaniques), le jeune Beethoven de 25 ans a l’occasion d’être reçu par le roi mélomane Friedrich Wilhelm II et de rencontrer les plus grands violoncellistes de l’époque : les frères Duport. Ce contexte favorable l’incite à composer pour lui et pour eux les deux premières Sonates pour piano et violoncelle op.5, ainsi que deux séries de Variations, dont l’une sur le thème de Haendel qui consacre le héros conquérant : « See, the Conqu’ring Hero Comes », extrait de l’Oratorio Judas Maccabée de Haendel. Ces Douze Variations pour pianoforte et violoncelle sont publiées par Artaria en 1797, dédiées à la princesse Christine von Lichnowsky (WoO 45). Beethoven s’est donc inspiré du célèbre chœur de l’Oratorio Judas Maccabée de Haendel, créé en 1747 (pour la première exécution Haendel inséra cet air, « See, the Conqu’ring Hero Comes », conçu pour son oratorio Josué terminé en 1748). Cet oratorio exécuté à Vienne en 1779 dans la version modernisée due à Joseph Starzer y fut repris entre 1793 et 1795 à l’initiative du baron van Swieten et de la Société des associés (fondée en 1779 pour faire exécuter des Oratorios de Haendel). Signe de l’intégration de Beethoven dans le monde musical viennois, son choix est également révélateur de ses intentions de se poser en brillant artiste sûr de lui, bien décidé à conquérir victorieusement les faveurs du public mélomane.
Pour réaliser ses Douze Variations, Beethoven a construit un thème très simple, Allegretto en sol majeur, à C/, de 24 mesures soit trois fois huit mesures, ce qui donne une structure A-B-A’ : A en sol majeur, B en mi mineur, A’ en sol majeur. Puis, il en a retenu quelques éléments : la mélodie énoncée au piano, la figure en forme de broderie du début de la partie B, ainsi que l’arpège de l’accord parfait de sol majeur et les accords successifs en valeur longue. Ainsi, les trois premières variations jouent sur la diminution des figures rythmiques, et donc sur l’ornementation. Puis, à partir de la variation IV, en sol mineur, le processus de variation s’étend à de nouvelles variables : la densité sonore de la variation IV, les contrastes d’intensité de la V (« fp dolce » et un accord ff), les accents à contretemps de la VI dans une atmosphère « dolce », la fluidité des triolets du violoncelle dans une intensité pp de la VII, le contraste entre des gammes rapides et ascendantes et une partie centrale en style choral de la VIII en sol mineur, l’extension en majeur du style choral pour la IX. Enfin, les trois dernières variations jouent sur le tempo et sur la métrique, dans le style d’une sonate en trois mouvements : Allegro (toujours à C/) pour la X, Adagioà C pour la XI (équivalent d’un mouvement lent de sonate, de style improvisé) et Allegro à 3/8 pour la XII qui comprend 73 mesures, cette dernière Variation mettant en évidence l’influence des modifications des conditions de déroulement du temps sur la perception d’un thème bien identifié. Beethoven se permet donc des innovations d’écriture qui le posent comme jeune compositeur audacieux.
Parallèlement à cette affirmation du héros conquérant plein d’audace, Beethoven choisit d’exprimer ses désirs amoureux en s’appropriant un thème de La Flûte enchantée de Mozart, celui de l’air de Papageno, « Ein Mädchen oder Weibchen » (n°20, acte II) : accompagné de son Glockenspiel, en fa majeur, Papageno exprime son désir de posséder une gentille femme, pour retrouver le goût de vivre, et pose l’égalité de tout un chacun (hommes et femmes) devant la vie et l’amour.
Le thème construit par Beethoven à partir de cet air est Allegretto à 2/4 en fa majeur et comprend 16 mesures. Les huit premières mesures reprennent le début de l’air de Papageno avec quelques modifications rythmiques, tandis que les huit dernières « interprètent » la mélodie de la seconde partie de l’air écrit par Mozart. Si l’air est facile à identifier (la Flûte enchantée était très connue et « populaire »), la présence de Papageno au cours des variations successives est soulignée par l’imitation du Glockenspiel dès la première variation confiée au piano seul (de même que Papageno se tait quand le Glockenspiel joue, le violoncelle se tait quand le piano imite le Glockenspiel). Le traitement du thème dans chacune des variations témoigne d’une conception très personnelle du genre thème et variations : pour Beethoven, il s’agit de dépasser l’ornementation faite de broderies amplificatrices, en jouant sur des références implicites aux contenus des couplets de l’air par des allusions métonymiques, ou par des métaphores sonores d’une idée ou d’une situation. Ces Variations sont publiées à Vienne chez l’éditeur Jean Traeg en septembre 1798, en parties séparées et sans numéro d’opus (« op.66 » fut ajouté en 1819 dans le premier catalogue des œuvres de Beethoven).
Ces Variations ont fait l’objet de la première critique des compositions de Beethoven par l’Allgemeine musikalische Zeitung I (n°23, du 6 mars 1799 [col.366-368]) : l’auteur rappelait que Beethoven était célèbre pour sa virtuosité au piano, mais il se disait dérouté par la façon qu’il avait de traiter ce genre thème et variations, fort éloignée des règles posées par Haydn.
Le critique ne connaissait sans doute pas encore les 24 Variations pour clavier sur l’Ariette « Venni Amore » de Vincenzo Righini (WoO 65) qui, publiées en 1791 à Mayence, furent publiées à nouveau à Vienne en 1802 par Traeg signe de l’intérêt et de la valeur que leur attribuaient aussi bien Beethoven que son entourage – en particulier l’éditeur qui pensait y trouver une source de profit étant donné la notoriété croissante de Beethoven et le développement de la pratique du piano par des amateurs mélomanes. Dans cette œuvre pour piano seul, Beethoven, virtuose, se posait déjà en héros conquérant. Il s’est d’ailleurs plu à associer cette œuvre à une anecdote en sa faveur (que Wegeler a rapportée dans les Notices biographiques près de cinquante ans plus tard !): au cours du voyage à Mergentheim de l’orchestre de la cour électorale de Bonn (dont Beethoven faisait partie en tant qu’altiste) en 1791, il aurait joué par cœur, lors d’une escale à Aschaffenburg, ses Variations devant le virtuose du piano qu’était l’Abbé Franz Xaver Sterkel (pianiste que Charles Burney dans A General History of Music juge « admirable in point of taste […] though not very learned or consonant to harmonic rules »). Wegeler (qui ne faisait pas partie du voyage, mais était présent à Bonn) raconte que la virtuosité de l’Abbé Sterkel avait été une révélation pour Beethoven qui n’avait jamais entendu jusque-là de véritable virtuose. Comme il hésitait à se mettre au piano, Sterkel évoqua les récentes Variations sur l’Ariette de Righini et se dit curieux de savoir si le compositeur lui-même était capable de les jouer. Beethoven se mit alors au piano. Sterkel ne retrouvant pas la partition, il les joua par cœur, improvisant de surcroît d’autres variations de grande virtuosité à la manière de Sterkel.
Cette anecdote (peut-être enjolivée) atteste qu’avec ces Variations Righini, il ne s’agit plus d’un exercice d’école, mais d’un vrai travail de composition élaboré par un pianiste virtuose et improvisateur, qui ose prendre des libertés et des risques par rapport au point de départ thématique. Ici, les variations ne sont plus seulement ornementation d’un thème toujours reconnaissable, mais elles sont pensées, dans leur variété et leurs enchaînements surprenants, comme le déploiement d’une démarche de grande ampleur engendrée par le traitement combiné et inattendu de différents motifs inclus dans le thème. C’est ainsi que la conception de Beethoven part d’une interprétation du caractère polymorphe du matériau initial, pour proposer des relations subtiles entre les variations et le thème, et entre les variations entre elles, par-delà la référence mélodique, en jouant sur l’opposition de Stimmung, sur la complémentarité, sur la progression rythmique, sur l’intensification dynamique ou expressive (les trilles), sur les modifications de texture sonore (avec des textures étonnantes comme celles des variations 4, 7, 16). L’attention de l’auditeur est sans cesse entretenue, bousculée par des transitions abruptes (entre harmonie et polyphonie, entre naïveté et virtuosité, etc.), par des références humoristiques tels les appels de cors ou le signal de triomphe d’une trompette, par des émotions successives contrastées.
Pour un auditeur du vingt-et-unième siècle, l’agencement de cette succession de variations imprévisibles fait penser au processus du montage cinématographique qui fut inauguré par Eisenstein au cours des années 1920, montage qui produit l’effet émotionnel recherché par le choc d’images qui, en apparence, n’ont rien à voir les unes avec les autres, et qui se succèdent selon un rythme plus ou moins rapide, dessinant ainsi le processus évolutif qui produit l’œuvre et qui en porte le sens, révélant les gestes créatifs impulsifs de l’auteur.
Par cette façon « moderne » de procéder, Beethoven s’éloignait des exigences, établies au dix-huitième siècle, du genre qu’était la composition de variations sur un thème (le plus souvent bien connu).
Peu de temps après ces Variations Righini, un autre témoignage de l’attitude conquérante de Beethoven, cette fois avec une composante agressive évidente comme l’atteste le ton qu’il adopte en annonçant sa nouvelle œuvre à son amie de Bonn Eleonore von Breuning, les Douze Variations pour piano et violon (WoO 40) composées lors de son arrivée à Vienne en fin 1792 sur le thème de la Cavatine de Figaro des Nozze de Mozart, « Se vuol ballare Signor Contino ». Le choix de ce thème reflète une volonté de défi à la Figaro, signifiant qu’il saura trouver sa place à Vienne. Dans la lettre qui accompagne l’envoi de la partition, il justifie les difficultés d’exécution en révélant qu’il cherche à tenir le devant de la scène à Vienne et qu’il veut se venger de ses « ennemis mortels » :
« Vous allez recevoir une dédicace de moi, à l’occasion de laquelle j’aurais souhaité que l’œuvre soit plus grande et plus digne de vous. On me pousse ici à éditer cette petite œuvre, et je profite de cette occasion pour vous donner un témoignage, ma très chère E., de ma haute considération et de mon amitié, et du souvenir inoubliable que je garde de votre maison. (…)
lettre de Vienne de Beethoven à Eleonore alors à Bonn
3/- Partir du banal pour étonner
Pour occuper le devant de la scène, Beethoven a aussi besoin d’étonner ses auditeurs. Et il est très content de s’étonner lui-même, comme il l’écrit à son éditeur à propos de ces Variations WoO 40 au moment de leur publication en juin 1793 (BGA 10):
« Bien cher, hier soir j’ai reçu mes Variations, elles m’étaient vraiment devenues tout à fait étrangères, cela me fit plaisir, c’est une preuve pour moi que ma composition n’est pas tout à fait banale. »
Et il poursuivait sa lettre sur un ton quelque peu impérial pour souligner la nouveauté de sa conception :
« Je dois vous faire remarque encore quelques fautes, que je vous prie de corriger tout de suite, parce qu’elles sont vraiment d’importance. / Tout d’abord, on s’est trompé dans le titre, où il y a avec un Violino ad libitum ; comme le violon est tout à fait inséparable de la partie de piano, et comme il n’est pas possible de jouer les Variations sans violon, il faut donc mettre : avec un Violon obligate [sic], comme je l’ai corrigé moi-même sur un exemplaire. »
Dans ce contexte culturel convenu, plus le thème est banal et plus il est « à la mode », plus Beethoven est content car il peut s’en démarquer et épater : en témoigne l’anecdote à propos de l’origine des Six Variations pour piano sur l’Air « Nel cor più non mi sento » de La Molinarade Paisiello, composées dans la seconde moitié de 1795 et éditées à Vienne par Traeg en mars 1796 (WoO 70) Tema (Andantino) / 6/8 en sol majeur (20 mes.) – 167 mes.
L’occasion de la composition a été racontée par Wegeler dans ses Notices biographiques[24] : Beethoven assistait à une représentation de La Molinara dans la loge d’une dame de rang important ; quand l’air célèbre « Nel cor più non mi sento » fut chanté, la dame aurait dit à Beethoven qu’elle avait possédé des Variations sur cet air, mais qu’elle les avait perdues. Durant la nuit même, Beethoven aurait composé ces Variations, les faisant porter à la dame avec ce billet : « Variazioni usw. Perdute per la… ritrovate per Luigi van Beethoven. Sie sind so leicht, daβ die Dame sie wohl a vista sollte spielen können.“ („Variations etc. perdues mais… retrouvée par Luigi van Beethoven. Elles sont si faciles que la Dame devrait pouvoir les jouer à vue. »)
Les Variations que la Dame se souvenait avoir entendues étaient certainement connues de Beethoven, dans la mesure où ce thème et des Variations composées par Josephine Aurnhammer et par Joseph Gelinek avaient été publiés par Boβler en 1791 dans sa revue Musikalische Korrespondenz der teutschen Filarmonischen Gesellschaft (qui parut entre 1788 et 1792), revue que Beethoven avait à sa disposition à Bonn (des amis étaient abonnés).
L’opéra de Paisiello L’amor contrastato ossia La Molinara représenté à Vienne au Kärntnertortheater le 2 juin 1795 était très connu des Viennois, car créé en 1788 à Naples, il fut à l’affiche du Burgtheater du 13 novembre 1790 au 21 octobre 1792. Cette reprise de 1795 incita Beethoven à composer deux séries de Variations sur des « airs à la mode » : la série WoO 70 sur l’Air « Nel cor più non mi sento » et la série WoO 69 sur l’air « Quant’ è più bello ».
Peu après, en 1796/1797, Beethoven s’empare directement d’un air d’amour très à la mode pour composer Huit Variations pour piano en ut majeur sur le thème de la Romance « Une fièvre brûlante » extraite du Richard Cœur-de-Lion de Grétry – elles sont publiées à Vienne chez Traeg en 1798 (WoO 72) Tema. Allegretto, 3/4, ut majeur – 363 mes.
L’opéra-comique en trois actes de André Ernest Modeste Grétry (1741-1813), sur un livret de Michel Jean Sedaine (1719-1797), créé à Paris en 1784 à la Comédie-Italienne, fut donné à Vienne en 1798 ; mais le 2 février 1795, le « Ballo eroico » Riccardo Cuor di Leone sur une musique de Joseph Weigl, a été représenté au Burgtheater : la Romance de Grétry, « Une fièvre brûlante », en faisait partie (le ballet fut souvent repris – la musique de Weigl fut même jouée seule, le 30 mars 1798). Le choix de Beethoven reflète son adéquation avec les centres d’intérêt du public viennois aussi bien que sa connaissance des œuvres au goût du jour qui étaient souvent publiées en réduction pour piano (ainsi, en 1788, quatre ans après la première représentation de Richard Cœur-de-Lion à Paris, Nicolas Simrock, à Bonn, proposait une réduction pour piano, que Beethoven a certainement connue) ou qui étaient intégrées, en partie, dans d’autres représentations (ainsi, dans son « Ballo eroico », Joseph Weigl avait repris la célèbre Romance, ce qui, vu le succès de ce Ballet, incita Beethoven à la varier). Cette Romance se situe au cœur du Duo de l’acte II, scène 4, entre Richard enfermé dans une tour (près de Vienne, tour où il a été retenu prisonnier au retour de la troisième croisade en 1192) et le pseudo trouvère Blondel de Nesle qui la chante : elle est interrompue trois fois par des paroles de Richard qui reconnaît la mélodie qu’il avait écrite pour sa bien-aimée, et qui comprend que ses proches cherchent à le libérer. Vu le contexte médiéval, Grétry avait choisi une mélodie « dans le vieux style » : dans ses Mémoires ou Essais sur la Musique[25], il explique qu’il espérait ainsi « plaire aux modernes » en reprenant une mélodie médiévale.
Beethoven retient le côté « ancien style » donné par Grétry et s’inspire des variations mêmes de Grétry qui, dans son opéra, a donné neuf versions différentes de la Romance (un solo de violon, un solo de violon avec orchestre auquel s’ajoute deux variations, le refrain instrumental et les couplets chantés du Duo entre Richard et Blondel, le chant de Blondel en coulisse, un morceau d’ensemble – « sa voix a pénétré mon âme » -, et le Finale – « C’est l’amitié fidèle »). Beethoven donne également neuf versions : le thème et les huit variations suivies d’une coda, et il s’inspire de l’instrumentation de Grétry (« à la petite flûte ») traduite sous forme de triolets et de trilles. Le caractère militaire de la sixième variation reflète le contexte de l’opéra-comique.[26] Pourtant, Beethoven a conçu ses variations plus en compositeur qu’en commentateur de l’opéra-comique de Grétry.
Le thème tout simple qu’il construit à partir de cette Romance (32 mes. = 3 x 8) a une forme lied (a b a), la section centrale introduisant une certaine polyphonie, et la pulsation s’installant à la noire. Dans les trois premières variations le mouvement s’accélère, puis une variation mineure marque le milieu de l’œuvre, qui retrouve la tension entre lyrisme « médiéval » et vivacité « moderne ». La Coda confirme cette idée d’accélération du mouvement : après une évocation du thème, elle se termine Presto de manière brillante.
D’une grande banalité, le thème de l’amour…. présenté sous toutes ses déclinaisons (jalousie, douleurs, bonheurs) a servi de prétexte à plusieurs séries de Variations : Beethoven se coulait dans l’air du temps… mais pas seulement ! lui aussi se sentait concerné par les joies et les imprévus de la relation amoureuse, si l’on fait crédit à ce que raconte Wegeler : vrai Adonis, il faisait tomber les cœurs… et il ne fut jamais en manque de partenaire féminine…
Ainsi la banalité des thèmes a été doublement utile à Beethoven : se confronter « au malheur banal » et faire preuve d’audace, surprendre.
4/- Interroger le passé
L’écriture pour le genre thème et variations ne révèle pas seulement les pulsions amoureuses ou les pulsions agressives de Beethoven qui cherche à être le meilleur et à damner le pion à ses ennemis, elle révèle également le besoin de remonter aux sources, d’interroger le passé. Deux voies se présentaient à lui : l’une, dans l’air du temps, était liée aux recherches de Herder sur l’originalité de chacun des peuples et sur l’importance à accorder à la poésie et aux chants populaires ; l’autre, plus personnelle, découlait de l’intérêt pour les « musiques anciennes », leurs modes d’écriture dont les paradigmes étaient la chacone (ou passacaille) aussi bien que la fugue – sachant qu’à l’instar de la variation, l’écriture fuguée part d’un sujet qui se combine à un contre-sujet avant de se déployer selon des règles très strictes qui ne brident pourtant pas l’imagination, comme J.-S. Bach l’a abondamment démontré, ce que Beethoven connaissait parfaitement si l’on en croit l’article que Neefe a fait paraître en 1783 :
« Ludwig van Betthoven [sic]…, jeune garçon de onze ans, doué d’un talent très prometteur. Il joue du piano-forte avec habileté et avec puissance, il déchiffre fort bien, en un mot, il joue en grande partie le Clavier bien tempéré de Jean Sébastien Bach, ouvrage auquel l’a initié M. Neefe. Quiconque connaît ce recueil de préludes et de fugues dans tous les tons – qu’on pourrait presque appeler le nec plus ultra de notre art – saura ce que cela veut dire. »
Neefe 1783
Beethoven a donc varié quelques airs populaires, avant même d’être sollicité par Thomson à partir de 1803 pour les airs « écossais » (terme qui est devenu générique pour les airs populaires) : l’air suisse en 1790 ou 1792 (WoO 64), la danse russe issu du ballet Das Waldmädchen en 1796/1797 (WoO 71), le God save et le Rule Britannia anglais en 1803 (WoO 78 et 79) et les airs « populaires » de différentes origines en 1818-1819 (les duos pour piano et violon ou flûte op.105 et 107). Et il est parti d’un thème de chacone pour ses 32 Variations en ut mineur, « altdeutsch » à la Haendel, en 1806 (WoO 80) au moment où il intégrait des thèmes russes dans ses trois Quatuors à corde op.59, pour inscrire l’étrange, le surprenant, voire le réel au cœur de l’œuvre.
Or, cet intérêt pour les « musiques anciennes » est une dominante de la vie créatrice de Beethoven : s’il appartient à une époque éprise de l’Antiquité gréco-romaine, il est aussi animé par la démarche très personnelle de fouiller dans les bibliothèques musicales de son prince électeur comme celle de van Swieten ou celle de l’archiduc Rodolphe, ou de solliciter les fonds de ses éditeurs pour étudier les compositions de ses prédécesseurs. Ainsi, il n’a eu de cesse d’interroger le passé, comme l’atteste sa lecture de l’Odyssée dont il a recopié plusieurs passages dans son Tagebuch, en particulier l’un concernant l’importance de la connaissance du passé :
Tagebuch 44/ „Um nur nächst vom vergangenen man was werden wollte, so hat das Vergangene doch das Gegenwärtige hervorgebracht – Sie wurden irdisch – erschreckliche Weissagung und durch die Dichtungen, durch ihre – Bedeutenheit – gerettet“ (Odyssée, Le Cyclope IX 14/15)
(Pour être au plus près du passé, il faut penser que le passé a engendré le présent – vous êtes devenues terrestres prophéties effroyables, et sauvées par la poésie et votre signification) : ce qui signifie que les prophéties, les dires du passé, devenus réalité, ont pris sens, par l’intermédiaire de la poésie pour être supportables.
5/- L’humour
L’écriture pour le genre thème et Variations confirme également le goût de Beethoven pour l’humour. Sachant que l’humour résulte de l’épargne d’une dépense affective, cette tendance relève d’une disposition psychique spécifique caractérisée par une difficulté à contenir ses pulsions qui trouvent ainsi un exutoire.
Avant même les Variations op.76 composées en 1809 sur un thème original plein d’humour, parodie de musique turque, Beethoven a manifesté son humour en 1792 dans les Treize Variations en la majeur pour clavier sur l’Ariette « Es war einmal ein alter Mann » du Singspiel Das rote Käppchen de Karl Ditters von Dittersdorf, opérette représentée à Bonn en février 1792, Beethoven faisant partie de l’orchestre… Ces Variations sont publiées à Bonn par Simrock en automne 1793 (WoO 66).
L’air choisi par Beethoven, « Es war einmal ein alter Mann » (« Il était une fois un vieil homme »), est une histoire pleine d’humour en cinq strophes, qui raconte comment la jeune et jolie femme d’un vieux mari jaloux finit par être courtisée par un jeune médecin magnétiseur !
L’agencement du thème de la mélodie humoristique de Dittersdorf a été repris par Beethoven pour l’agencement de l’ensemble des Variations. Ainsi, la mélodie du thème est un enchaînement de phrases répétées dont l’accumulation s’intensifie jusqu’à l’effet de surprise produit par une mesure vide avec un point d’orgue qui crée un suspens après la dominante (la cadence est suspendue !) – suit alors une reprise raccourcie du début de la mélodie. Cet agencement organise la succession de ces 13 Variations : chacune possède son caractère expressif et l’ensemble semble s’achever avec le Capriccio qui, en fait, représente la cadence attendue depuis le début, et est suivi par la dernière Variation, interprétation martiale du thème.
Ainsi, l’humour de la mélodie de Ditterdorf est transposé par Beethoven dans la composition de ses Variations à partir d’une combinaison d’éléments strictement musicaux : les changements de tempo et de métrique de variation en variation, les contrastes de tempo et de métrique à l’intérieur même de variations (5, 9, 12), les références explicites à une virtuosité qui met en valeur les qualités de l’interprète et peut être considérée comme une métaphore de la séduction (la variation 7 ressemble à une Etude, la 9 est un libre jeu d’imitation entre les deux mains, la 11 déploie trilles et tremolo qui créent une texture dense et solide), la fausse conclusion proposée par un « Capriccio », et dans la Variation finale la métamorphose de l’esprit du thème qui de léger devient martial.
Ce plaisir de s’adonner à l’humour éclate dans les Variations op.76 composées dans le contexte de la guerre de 1809 marquée par des mouvements d’armée et par le siège de Vienne. Pour prendre ses distances par rapport à la tension collective, Beethoven s’est amusé à s’approprier une référence musicale fort appréciée des Viennois depuis le siège de la ville par les Turcs à la fin du XVIIe siècle (en 1683) : une musique dite « turque » évoquant la « Marche des Janissaires », qui était une façon d’exorciser la peur en ridiculisant l’ennemi présenté comme primitif et bruyant, animé par une violence de pacotille. La composition de Beethoven avait également un but commercial : la popularité et la simplicité immédiate de ce thème devaient assurer une diffusion rapide de cette œuvre très élaborée derrière son aspect « burlesque ».
Le thème (original) a été construit par Beethoven pour mettre en évidence le côté fruste et primitif de cette musique « turque » : Allegro risoluto à deux temps, il est constitué de deux sections, la première de huit mesures et la seconde de douze mesures, chacune étant reprise. La première section se déroule sur une pédale de ré (comme si les fonctions harmoniques n’existaient pas), chacun des premiers temps étant souligné par un sf dont la brutalité est confirmée par une modulation non préparée. La seconde section, toujours aussi bruyante, introduit un petit mouvement harmonique et une variante rythmique de croches par deux (au lieu d’être par quatre). Les sforzandi évoquent le tambour. En fait, ce thème d’apparence brute, caractérisé par un grand dénuement mélodique et harmonique, possède des éléments que Beethoven met en valeur, de manière diverse, dans chacune des six variations : les tierces, les répétitions de notes, les attaques percussives. Chacune des variations très individualisée redouble le côté primitif de l’ensemble par l’effet de contraste qu’elle introduit. A la fin de l’œuvre, après avoir entraîné l’auditeur dans des dimensions fort éloignées des données de base, Beethoven répète le thème initial : ce geste, quelque peu anachronique à son époque, connotait la musique « ancienne », celle qui dominait au temps de l’invention de cette musique turque – d’autre part, cette reprise permettait à Beethoven de souligner le côté répétitif de l’histoire (le retour à la même situation par-delà les temps d’évolution vers plus de complexité et de raffinement).
Satisfait du résultat, de l’effet produit par ce thème, Beethoven le réutilisa deux ans plus tard dans les Ruines d’Athènes (op.113, n°4, « Marcia alla turca »), pour évoquer l’occupation turque car comme Vienne, Athènes a été victime des Turcs…
6/- L’émotion réactualisée dans le présent
Autre enseignement de la composition de Variations par Beethoven : son besoin de mettre en œuvre sa certitude que la musique réactualise l’émotion, celle même qui a provoqué l’œuvre, ce qui est le thème même du Liederkreis An die ferne Geliebte (A la bien-aimée lointaine) op.98, composé en 1816.
Mais, avant même cette œuvre spécifique, cette intention est très souvent exprimée dans les propos qui accompagnent le cadeau qu’est l’œuvre à Variations. Ainsi, la lettre de novembre 1793 (BGA 11) à Eleonore von Breuning lors de l’envoi de la partition des XII Variations pour piano et violon (WoO 40) :
« Acceptez cette bagatelle, et pensez qu’elle vient d’un ami qui vous tient en très haute estime. O qu’elle vous apporte quelque plaisir, et mes souhaits seront exaucés. Que cela vous permette de réveiller un petit peu toutes ces heures bénies passées dans votre maison ; grâce à cela, peut-être, vous pourrez penser à moi, jusqu’à ce que je revienne, ce qui, dans l’état actuel des choses, ne se fera vraisemblablement pas de sitôt. […]. »
Ou également la dédicace qui accompagne les Variations pour quatre mains (WoO 74) notées sur l’album des sœurs Brunsvick le 23 mai 1799, « Ich denke dein » d’après un poème de Goethe pour lequel Beethoven a composé un thème original :
„Pour l’album des deux comtesses von Brunswick [sic], Je ne souhaite rien tant qu’en jouant et en chantant de temps à autre cette petite offrande musicale, elles se souviennent de leur très dévoué Ludwig van Beethoven. Vienne, 23 mai 1799.“ [« In das Stamm-Buch der beyden Comtessen / von Brunswik [sic] / Ich wünsche nichts so sehr, als dass sie sich zuwei- / len beym durchspielen und singen dieses kleinen/ musikalischen Opfers, erinnern mögen / an / ihren sie wahrhaft / verehrenden / Ludwig van Beethoven. / Wien 23t May 1799.“]
La musique, en particulier sous la forme de Variations, a vocation à la transmission et à l’entretien d’une présence permanente… réservoir de souvenirs et surtout d’une mémoire à l’instar de l’inconscient…
7/- La toute-puissance du démiurge
Enfin, l’écriture pour le genre thème et variations manifeste la tendance de Beethoven à se vouloir démiurge, tout-puissant – « faire converger passé, présent et futur, sublime et profane » comme l’écrit Alfred Brendel à propos des Variations Diabelli op.120.
L’ampleur de cette œuvre qui, partie d’un rien, d’une « rosalie », constitue tout un univers ne peut qu’être placée sous le signe de ce Prométhée créateur d’une humanité nouvelle : elle est bien l’œuvre d’un démiurge. Face à cette création qui associe l’un et le multiple comment ne pas penser aux sentences que Beethoven a soigneusement recopiées pour les avoir en permanence sous ses yeux donc, cette inscription antique trouvée à Saïs en haute Egypte qui pose l’unicité d’un Dieu qu’on ne peut ni nommer, ni représenter, ni connaître :
« Ich Bin, Was da ist »
« Ich bin alles, Was ist, Was / war, und Was seyn wird, / Kein sterblicher Mensch / hat meinen Schleyer / aufgehoben »
« Er ist einzig von ihm selbst, / u. diesem Einzigen sind / alle Dinge ihr Daseyn schuldig »[27]
Comme si Beethoven s’identifiait à celui qui avait prononcé ces paroles. Ou au moins, comme s’il s’était senti investi d’une mission prophétique : parler aux hommes au nom du divin.
A quelle date a-t-il recopié cette inscription dont il ne donne pas la source ? D’après l’étude des filigranes du papier, il semble que ce soit en 1819, donc à l’époque de la composition de la Missa solemnis. Quant à la source que Schindler n’a pas su identifier, il s’agit de citations trouvées dans le texte de Schiller : Die Sendung Moses (Le message de Moïse). Comme en témoigne sa bibliothèque, Beethoven possédait les œuvres complètes de Schiller. Dès son adolescence à Bonn, au temps où il était répétiteur au théâtre de la cour électorale, il avait eu l’occasion de connaître de près plusieurs pièces de théâtre de Schiller, dont Die Räuber (Les Brigands) dès 1783, Die Verschwörung des Fiesko zu Genua (La Conjuration de Fiesque), et Don Carlos faisait partie des références culturelles partagées avec ses amis. Toute sa vie, il a été un grand admirateur de la pensée politique et esthétique de Schiller : si, en 1823, le choix du poème An die Freude intégré dans le Finale de sa Neuvième Symphonie, atteste cette admiration, il témoigne également de la façon dont Beethoven s’est approprié la pensée de Schiller, attaché comme lui à contribuer à « l’éducation esthétique du genre humain »[28], puisqu’il a remanié le poème, pourtant très célèbre, maintes fois déjà mis en musique, pour insister sur la dimension politique et spirituelle à portée universelle des louanges, collectives et individuelles, de la Joie. Ce Finale est d’ailleurs constitué d’un ensemble de variations du thème de la joie, thème original dont Beethoven a mis l’invention en scène pour témoigner de toutes les souffrances dont il procède…
Le fait d’avoir recopié ces sentences et de les avoir conservées toujours présentes à son regard semble indiquer que Beethoven croit, comme Moïse, avoir rencontré la divinité, avoir été confronté directement à elle et en avoir reçu la mission de faire accéder l’humanité à un au-delà d’elle-même, au sublime ou à la transcendance, voire à sa Vérité. La référence implicite à Schiller permet de supposer que Beethoven conférait une dimension spirituelle à la création artistique : il avait fait sienne l’idée, soutenue par Schiller, que la Vérité réside dans l’œuvre d’art elle-même, parce que par le bouleversement émotionnel qu’elle provoque, elle incite à un parcours initiatique « à l’antique » ; ce parcours qui consistait à passer des ténèbres effrayantes à la lumière de la raison, donnait la possibilité de contempler la beauté resplendissante. Or Schiller accordait une valeur supérieure à la musique, comme il l’affirme dans sa « Vingt-deuxième lettre » dans laquelle il démontre la conjugaison des effets des trois arts que sont la musique, l’art plastique et la poésie :
« La musique doit dans sa noblesse suprême devenir forme et agir sur nous avec la calme puissance de l’art antique ; l’art plastique doit dans son achèvement suprême devenir musique et nous émouvoir par sa présence sensible immédiate ; la poésie doit à son point de développement le plus parfait nous saisir vigoureusement comme la musique, mais elle doit en même temps comme l’art plastique nous entourer d’une atmosphère de paisible clarté. »[29]
Schiller
Chez Beethoven, le paradigme de son orgueil de créateur unique est constitué par l’imbrication de la Missa solemnis op.123 avec la série des Trente-trois Variations op.120, deux œuvres magistrales composées en même temps, en quelque sorte l’une dans l’autre entre 1819 et 1823. Alors que le futur archevêque d’Olmutz n’a passé aucune commande à Beethoven pour une Messe, et que l’éditeur Diabelli a lancé une proposition à tous les compositeurs viennois, donc pas spécifiquement à lui, Beethoven décide d’honorer l’investiture du nouvel archevêque d’une Missa solemnis, et il se prend au jeu proposé par Diabelli, mais au lieu d’une variation il en imagine trente-trois constituant une œuvre à part entière. Tandis que la Missa solemnis ne fut pas créée à Vienne du vivant de Beethoven, mais à Saint-Pétersbourg le 26 mars 1824, les Variations Diabelli furent si difficiles à comprendre et à exécuter qu’il fallut attendre l’audace de Hans von Bülow qui finit par les jouer en concert à Berlin le 25 novembre 1856, soit près de quarante ans plus tard.
Cette proximité avec le divin, mise en évidence par Beethoven lui-même tant comme source de son inspiration que comme mission qui lui aurait été confiée, atteste la haute idée qu’il avait de lui-même à la limite de la toute-puissance.
Quel sens donner à ce désir de toute-puissance ?
Est-ce une tentative tant grandiose que désespérée de donner sens à sa surdité, cette souffrance qu’il doit supporter pour sauver l’humanité ?
Ou bien est-ce un déni de la punition qu’il mérite pour avoir transgressé la Loi de la filiation et être devenu meurtrier, parricide, le crime suprême, malgré lui : les derniers vers de La fiancée de Messine de Schiller, recopiés en 1817 dans son Tagebuch (118) témoignent de son obsession du poids de la faute :
„Das Leben ist der Güter höchstes nicht/ Der Uebel größtes aber ist die Schuld“ Schiller Die Braut von Messina. (La vie n’est pas le plus haut des biens, mais la faute est le plus grand des maux).
Comment expier sa faute?
[1] Michael Ladenburger, Ein Skizzenblatt Beethovens – ehemals im Besitz von Stefan Zweig, Faksimile und Kommentar, Beethoven-Haus Bonn, 2016, S.4.
[2] Stefan Zweig, Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, traduction de Jean-Paul Zimmermann, Paris Belfond, 1982, p.195. Publié par Bermann-Fisher à Stockholm en 1944, Die Welt von Gestern et en traduction française par Albin Michel en 1948.
[3]Id., p.404.
[4] Id., p.409.
[5]« Je Suis, Ce qui est » / « Je suis tout, Ce qui est, Ce qui a été et Ce qui sera, Aucun mortel n’a soulevé mon voile » / « Il est seul, ne procède que de lui-même, et de lui l’Unique toutes les choses sont redevables de leur existence »
[6] George Steiner, Fragments (un peu roussis) Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, ed. Pierre-Guillaume de Roux, Paris, 2012 – in chapitre « 7/ Pourquoi je pleure quand Arion chante ? », p.74.
[7] Objets conservés au Beethoven-Haus Bonn – Photo provenant de la documentation de Stephan Ley.
[8] Méphistophélès mentionne que lui et Faust viennent d’Espagne (Vers 2205), lieu par excellence du despotisme à l’époque de Goethe. Egmont se situe aussi sous la domination espagnole.
[9] Septième livre de la première publication des œuvres complètes de Goethe par Georg Joachim Göschen à Leipzig entre 1787 et 1790.
[10] Dans les lettres BGA 465, t.2 p.149, du 21 août 1810 et BGA 474, t.2, p.162, du 15 octobre 1810.
[11] Cf. Werkverzeichnis 2, Opernplan, S.610. (Unv = Unvollendete Werke soit « œuvres inachevées »)
[12] (Oktober 1806 Breuning berichtet über Beethoven: « Beethoven ist bey Fürst Lichnowsky in Schlesien, und wird erst gegen Ende dieses Monats zurückkommen. Seine Verhältnisse sind Jetz nicht die Besten, da seine Oper durch die Kabalen der Gegner selten aufgeführt worden ist, und ihm also fast nichts eingetragen hat. Seine Gemüthsstimmung ist meistens sehr melancholisch, und nach seinem Briefe hat der Aufenthalt auf dem Lande ihn nicht erheitert. »)
[13] Article « Czerny » in Kopitz op.cit. p.218.
[14] Actuellement au Beethoven-Haus (Stefan Zweig l’a possédé avant qu’il ne le lègue à Bodmer qui a déposé sa collection à Bonn).
[15] Cassette en bois, Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a.M., Sammlung F.N. Manskopf (photo in Drei Begräbnisse und ein Todesfall, Beethovens Ende und die Erinnerungskultur seiner Zeit, Verlag Beethoven-Haus Bonn 2002, p.144, n°65).
[16] Soit lettre 591, datée de Vienne 1815, dans la réédition en français des Lettres de Beethoven par Actes Sud, p.604.
[17] Dans des billets ou lettres à Zmeskall, à Amenda en 1799, à Wegeler (16 nov. 1801), ; à Christine Frank-Gerhardi, entre le 21 et le 24 janvier 1801 (BGA 56) LvBthwn ; à Hoffmeister (BGA 84, 8 avril 1802) ; Ferdinand Ries (BGA 96, été 1802, furieux à propos des Marches à Browne), Tobias Haslinger (9 janvier 1817, fév. 1817), Steiner (janvier 1817), à Mähler (1804, BGA 206), à B&H (16 janvier 1805, BGA 209), au chanteur Mayer (1805 BGA 232, 235) ; à Josephine, fin mai 1805, BGA 221, 279 ihr treuer Bethwn., 294, 20 sept. 1807, 307), à Marie Bigot (1807, BGA 271) quand il lui propose une promenade, à Paul Bigot (BGA 272, 308) ; à Gleichenstein (20 avril 1807, BGA 276 : L.v. Bthv.) Ou également inscrit sur un manuscrit autographe de 1814 « Von LvBthwn // um nicht weiter tuschiert zu // werden », WoO 102 Trio vocal Die Stunde schlägt, wir müßen scheiden sur des paroles de Seyfried, Joseph von (1780-1849).
[18] Voir Catalogue de l’exposition Livres de Parole, Torah, Bible, Coran, BNF, 2005, p.63.
[19] Über naive und sentimentalische Dichtung, 1795. [Disponible en édition Reclam, 7756]
[20] Pour cette gageure posée par Beethoven, voir les Bagatelles op.119 et op.126.
[21] BGA 108 [Wien, 18. Oktober 1802].
[22] Goethe Poésies/Gedichte, Des origines au Voyage en Italie, traduites et préfacées par Roger Ayrault, Aubier/Collection bilingue, Paris, 1951, pp.246-247.
[23] Ibid., pp.244-245.
[24] Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven, Koblenz 1838 und 1845, réédité en 2000 par Georg Olms Verlag, Hildesheim – Zürich – New York, note de bas de page, p.80.
[25] Nouvelle édition, Bruxelles – Paris, 1829, vol. 1, p.289.
[26] Voir l’article de Wolfgang Osthoff (Würzburg), « Beethovens Grétry-Variationen WoO 72 » dans la Revue belge de musicologie, vol. XLVII (1993), p.125-142.
[27]« Je Suis, Ce qui est » / « Je suis tout, Ce qui est, Ce qui a été et Ce qui sera, Aucun mortel n’a soulevé mon voile » / « Il est seul, ne procède que de lui-même, et de lui l’Unique toutes les choses sont redevables de leur existence »
[28]Voir Friedrich Schiller, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme), Paris, Aubier, 1992. Ce texte qui date de 1794-1795 a été publié dans la revue Les Heures (n°1 et n°2) que Schiller venait de fonder avec Goethe.
[29]Ibidem, p.289.


